|


 Explorers, Scientists &
Inventors
Explorers, Scientists &
Inventors
 Musicians, Painters &
Artists
Musicians, Painters &
Artists
 Poets, Writers &
Philosophers
Poets, Writers &
Philosophers
 Native Americans & The Wild
West
Native Americans & The Wild
West
 First Ladies
First Ladies
 Popes
Popes
 Troublemakers
Troublemakers
 Historians
Historians
 Archaeologists
Archaeologists
 Royal
Families
Royal
Families
 Tribes & Peoples
Tribes & Peoples
Assassinations in History
Who
got slain, almost slain, when, how,
why, and by whom?
 Go to the
Assassination Archive
Go to the
Assassination Archive

Online History Dictionary A - Z



Voyages in History
When did what
vessel arrive with whom onboard and where
did it sink if it didn't?
 Go to the
Passage-Chart
Go to the
Passage-Chart


The Divine Almanac
Who all roamed the heavens in
olden times? The Who's Who of
ancient gods.
 Check out
the Divine Almanac
Check out
the Divine Almanac

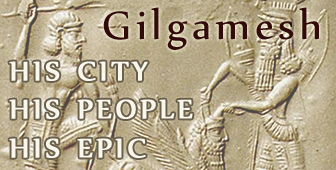
|
|
George Sand - Horace: Chapter 1-5
Notice
Chapter 1 - 5
Chapter 6 - 12
Chapter 13 - 19
Chapter 20 - 23
Chapter 24 - 26
Chapter 27 - 30
Chapter 31 - 33
|
|
I.
Les êtres qui nous inspirent le plus d'affection ne sont
pas toujours ceux que nous estimons le plus. La tendresse
du coeur n'a pas besoin d'admiration et d'enthousiasme:
elle est fondée sur un sentiment d'égalité qui nous fait
chercher dans un ami un semblable, un homme sujet aux
mêmes passions, aux mêmes faiblesses que nous. La vénération
commande une autre sorte d'affection que cette
intimité expansive de tous les instants qu'on appelle l'amitié.
J'aurais bien mauvaise opinion d'un homme qui ne
pourrait aimer ce qu'il admire; j'en aurais une plus mauvaise
encore de celui qui ne pourrait aimer que ce qu'il
admire. Ceci soit dit en fait d'amilié seulement. L'amour
est tout autre: il ne vit que d'enthousiasme, et tout ce
qui porte atteinte à sa délicatesse exaltée le flétrit et le
dessèche. Mais le plus doux de tous les sentiments humains,
celui qui s'alimente des misères et des fautes
connue des grandeurs et des actes héroïques, celui qui
est de tous les âges de notre vie, qui se développe en
nous avec le premier sentiment de l'être, et qui dure
autant que nous, celui qui double et étend réellement
notre existence, celui qui renaît de ses propres cendres
et se renoue aussi serré et aussi solide après s'être brisé;
ce sentiment-là, hélas! ce n'est pas l'amour, vous le savez
bien, c'est l'amitié.
Si je disais ici tout ce que je pense et tout ce que je
sais de l'amitié, j'oublierais que j'ai une histoire à vous
raconter, et j'écrirais un gros traité en je ne sais combien
de volumes; mais je risquerais fort de trouver peu
de lecteurs, en ce siècle où l'amitié a tant passé de mode
qu'on n'en trouve guère plus que d'amour. Je me bornerai
donc à ce que je viens d'en indiquer peur poser ce
préliminaire de mon récit: à savoir, qu'un des amis que
je regrette le plus et qui a le plus mêlé ma vie à la
sienne, ce n'a pas été le plus accompli et le meilleur de
tous; mais, au contraire, un jeune homme rempli de
défauts et de travers, que j'ai même méprisé et baï à de
certaines heures, et pour qui cependant j'ai ressenti une
des plus puissantes et des plus invincibles sympathies
que j'aie jamais connues.
|
Il se nommait Horace Dumontet; il était fils d'un petit
employé de province à quinze cents francs d'appointements,
qui, ayant épousé une héritière campagnarde
riche d'environ dix mille écus, se voyait à la tête, comme
on dit, de trois mille francs de rente. L'avenir, c'est-à-dire
l'avancement, était hypothéqué sur son travail, sa
santé et sa bonne conduite, c'est-à-dire son adhésion
aveugle à tous les actes et à toutes les formes d'un gouvernement
et d'une société quelconque.
Personne ne sera étonné d'apprendre que, dans une
situation aussi précaire et avec une aisance aussi bornée,
M. et Mme Dumontet, le père et la mère de mon ami,
eussent résolu de donner a leur fils ce qu'on appelle de
l'éducation, c'est-à-dire qu'ils l'eussent mis dans un collège
de province jusqu'à ce qu'il eût été reçu bachelier,
et qu'ils l'eussent envoyé à Paris pour y suivre les cours
de la Faculté, à cette fin de devenir en peu d'années
avocat ou médecin. Je dis que personne n'en sera étonné,
parce qu'il n'est guère de famille dans une position analogue
qui n'ait fait ce rêve ambitieux de donner à ses fils
une existence indépendante. L'indépendance, ou ce qu'il
se représente par ce mot emphatique, c'est l'idéal du
pauvre employé; il a souffert trop de privations et souvent,
hélas! trop d'humiliations pour ne pas désirer d'en
affranchir sa progéniture; il croit qu'autour de lui sont
jetés en abondance des lots de toute sorte, et qu'il n'a
qu'à se baisser pour ramasser l'avenir brillant de sa famille.
L'homme aspire à monter; c'est grâce à cet instinct
que se soutient encore l'édifice, si surprenant de
fragilité et de durée, de l'inégalité sociale.
De toutes les professions qu'un adolescent peut embrasser
pour échapper à la misère, jamais, de nos jours,
les parents ne s'aviseront d'aller choisir la plus modeste
et la plus sûre. La cupidité ou la vanité sont toujours
juges; on a tant d'exemples de succès autour de soi! Des
derniers rangs de la société, on voit s'élever aux premières
places des prodiges de tout genre, voire des prodiges
de nullité. «Et pourquoi, disait M. Dumontet à sa
femme, notre Horace ne parviendrait-il pas comme un
tel, un tel, et tant d'autres qui avaient moins de dispositions
et de courage que lui?» Madame Dumontet était
un peu effrayée des sacrifices que lui proposait son mari
pour lancer Horace dans la carrière; mais le moyen de
se persuader qu'on n'a pas donné le jour à l'entant le
plus intelligent et le plus favorisé du ciel qui ait jamais
existé? Madame Dumontet était une bonne femme toute
simple, élevée aux champs, pleine de sens dans la sphère
d'idées que son éducation lui avait permis de parcourir.
Mais, en dehors de ce petit cercle, il y avait tout un
monde inconnu qu'elle ne voyait qu'avec les yeux de son
mari. Quand il lui disait que depuis la Révolution tous
les Français sont égaux devant la loi, qu'il n'y a plus de
privilèges, et que tout homme de talent peut fendre la
presse et arriver, sauf à pousser un pou plus fort que
ceux qui se trouvent placés plus près du but, elle se rendait
à ces bonnes raisons, craignant de passer pour arriérée,
obstinée, et de ressembler en cela aux paysans
dont elle sortait.
Le sacrifice que lui proposait Dumontet n'était rien
moins que celui d'une moitié de leur revenu. «Avec
quinze cents francs, disait-il, nous pouvons vivre et élever
notre fille sous nos yeux, modestement; avec le surplus
de nos rentes, c'est-à-dire avec mes appointements,
nous pouvons entretenir Horace à Taris, sur un bon
pied, pendant plusieurs années.»
Quinze cents francs pour être à Paris sur un bon pied,
à dix-neuf ans, et quand on est Horace Dumontet!...
Madame Dumontet ne reculait devant aucun sacrifice; la
digne femme eût vécu de pain noir et marché sans souliers
pour être utile à son fils et agréable à son mari;
mais elle s'affligeait de dépenser tout d'un coup les économies
qu'elle avait faites depuis son mariage, et qui
s'élevaient à une dizaine de mille francs. Pour qui ne
connaît pas la petite vie de province, et l'incroyable habileté
des mères de famille à rogner et grappiller sur
tontes choses, la possibilité d'économiser plusieurs centaines
d'écus par an sur trois mille francs de rente, sans
faire mourir de faim mari, enfants, servantes et chats,
paraîtra fabuleuse. Mais ceux qui mènent cette vie ou
qui la voient de près savent bien que rien n'est plus fréquent.
La femme sans talent, sans fonctions et sans fortune,
n'a d'autre façon d'exister et d'aider l'existence
des siens, qu'en exerçant l'étrange industrie de se voler
elle-même en retranchant chaque jour, à la consommation
de sa famille, un peu du nécessaire: cela fait une
triste vie, sans charité, sans gaieté, sans variété et sans
hospitalité. Mais qu'importe aux riches, qui trouvent la
fortune publique très-équitablement répartie! «Si ces
gens-là veulent élever leurs enfants comme les nôtres,
disent-ils en parlant des petits bourgeois, qu'ils se privent!
et s'ils ne veulent pas se priver, qu'ils en fassent
des artisans et des manoeuvres!» Les riches ont bien
raison de parler ainsi au point de vue du droit social;
au point de vue du droit humain, que Dieu soit juge!
«Et pourquoi, répondent les pauvres gens du fond de
leurs tristes demeures, pourquoi nos enfants ne marcheraient-ils
pas de pair avec ceux du gros industriel et du
noble seigneur? L'éducation nivelle les hommes, et Dieu
nous commande de travailler à ce nivellement.»
Vous aussi, vous avez bien raison, éternellement raison,
braves parents, au point de vue général; et malgré
les rudes et fréquentes défaites de vos espérances, il est
certain que longtemps encore nous marcherons vers l'égalité
par cette voie de votre ambition légitime et de votre
vanité naïve. Mais quand ce nivellement des droits et des
espérances sera accompli, quand tout homme trouvera
dans la société le milieu où son existence sera non-seulement
possible, mais utile et féconde, il faut bien espérer
que chacun consultera ses forces et se jugera, dans
le calme de la liberté, avec plus de raison et de modestie
qu'on ne le fait, à cette heure, dans la fièvre de l'inquiétude
et dans l'agitation de la lutte. Il viendra un temps,
je le crois fermement, où tous les jeunes gens ne seront
pas résolus à devenir chacun le premier homme de son
siècle ou à se brûler la cervelle. Dans ce temps-là, chacun
ayant des droits politiques, et l'exercice de ces droits
étant considéré comme une des faces de la vie de tout
citoyen, il est vraisemblable que la carrière politique ne
sera plus encombrée de ces ambitions palpitantes qui s'y
précipitent aujourd'hui avec tant d'âpreté, dédaigneuses
de toute autre fonction que celle de primer et de gouverner
les hommes.
Tant il y a que madame Dumontet, qui comptait sur
ses dix mille francs d'économie pour doter sa fille, consentit
à les entamer pour l'entretien de son fils à Paris,
se réservant d'économiser désormais pour marier Camille,
la jeune soeur d'Horace.
Voilà donc Horace sur le beau pavé de Paris, avec son
titre de bachelier et d'étudiant en droit, ses dix-neuf ans
et ses quinze cents livres de pension. Il y avait déjà un
an qu'il y faisait ou qu'il était censé y faire ses études
lorsque je fis connaissance avec lui dans un petit café
près le Luxembourg, où nous allions prendre le chocolat
et lire les journaux tous les matins. Ses manières obligeantes,
son air ouvert, son regard vif et doux, me gagnèrent
à la première vue. Entre jeunes gens on est
bientôt lié, il suffit d'être assis plusieurs jours de suite à la
même table et d'avoir à échanger quelques mots de politesse,
pour qu'au premier matin de soleil et d'expansion
la conversation s'engage et se prolonge du café au fond
des allées du Luxembourg. C'est ce qui nous arriva en
effet par une matinée de printemps. Les lilas étaient en
fleur, le soleil brillait joyeusement sur le comptoir d'acajou
à bronzes dorés de madame Poisson, la belle directrice
du café. Nous nous trouvâmes, je ne sais comment,
Horace et moi, sur les bords du grand bassin,
bras dessus, bras dessous, causant comme de vieux
amis, et ne sachant point encore le nom l'un de l'autre;
car si l'échange de nos idées générales nous avait subitement
rapprochés, nous n'étions pas encore sortis de
cette réserve personnelle qui précisément donne une
confiance mutuelle aux personnes bien élevées. Tout ce
que j'appris d'Horace ce jour-là, c'est qu'il était étudiant
en droit; tout ce qu'il sut de moi, c'est que j'étudiais la
médecine. Il ne me fit de questions que sur la manière
dont j'envisageais la science à laquelle je m'étais voué,
et réciproquement. «Je vous admire, me dit-il au moment
de me quitter, ou plutôt je vous envie: vous travaillez,
vous ne perdez pas de temps, vous aimez la
science, vous avez de l'espoir, vous marchez droit au
but! Quant à moi, je suis dans une voie si différente,
qu'au lieu d'y persévérer je ne cherche qu'à en sortir.
J'ai le droit en horreur; ce n'est qu'un tissu de mensonges
contre l'équité divine et la vérité éternelle. Encore
si c'étaient des mensonges liés par un système logique!
mais ce sont, au contraire, des mensonges qui se contredisent
impudemment les uns les autres, afin que chacun
puisse faire le mal par les moyens de perversité qui lui
sont propres! Je déclare infâme ou absurde tout jeune
homme qui pourra prendre au sérieux l'étude de la chicane;
je le méprise, je le hais!...»
Il parlait avec une véhémence qui me plaisait, et qui
cependant n'était pas tout à fait exempte d'un certain
parti pris d'avance. On ne pouvait douter de sa sincérité
en l'écoutant; mais on voyait qu'il ne fulminait pas ses
imprécations pour la première fois. Elles lui venaient
trop naturellement pour n'être pas étudiées, qu'on me
pardonne ce paradoxe apparent. Si l'on ne comprend
pas bien ce que j'entends par là, on entrera difficilement
dans le secret de ce caractère d'Horace, malaisé à définir,
malaisé à mesurer juste pour moi-même, qui l'ai
tant étudié.
C'était un mélange d'affectation et de naturel si délicatement
unis, que l'on ne pouvait plus distinguer l'un
de l'autre, ainsi qu'il arrive dans la préparation de certains
mets ou de certaines essences, où le goût ni l'odorat
ne peuvent plus reconnaître les éléments primitifs. J'ai
vu des gens à qui, dès l'abord, Horace déplaisait souverainement,
et qui le tenaient pour prétentieux et boursouflé
au suprême degré. J'en ai vu d'autres qui s'engouaient
de lui sur-le-champ et n'en voulaient plus démordre,
soutenant qu'il était d'une candeur et d'un laisser-aller
sans exemple. Je puis vous affirmer que les uns et
les autres se trompaient, ou plutôt, qu'ils avaient raison
de part et d'autre: Horace était affecté naturellement.
Est-ce que vous ne connaissez pas des gens ainsi faits, qui
sont venus au monde avec un caractère et des manières
d'emprunt, et qui semblent jouer un rôle, tout en jouant
sérieusement le drame de leur propre vie? Ce sont des
gens qui se copient eux-mêmes. Esprits ardents et portés
par nature à l'amour des grandes choses, que leur milieu
soit prosaïque, leur élan n'en est pas moins romanesque;
que leurs facultés d'exécution soient bornées, leurs conceptions
n'en sont pas moins démesurées: aussi se drapent-ils
perpétuellement avec le manteau du personnage
qu'ils ont dans l'imagination. Ce personnage est bien
l'homme même, puisqu'il est son rêve, sa création, son
mobile intérieur. L'homme réel marche à côté de l'homme
idéal; et comme nous voyons deux représentations de
nous-mêmes dans une glace fendue par le milieu, nous
distinguons dans cet homme, dédoublé pour ainsi dire,
deux images qui ne sauraient se détacher, mais qui sont
pourtant bien distinctes l'une de l'autre. C'est ce que
nous entendons par le mot de seconde nature, qui est
devenu synonyme d'habitude.
Horace, donc était ainsi. Il avait nourri en lui-même
un tel besoin de paraître avec tous ses avantages, qu'il
était toujours habillé, paré, reluisant, au moral comme
au physique. La nature semblait l'aider à ce travail perpétuel.
Sa personne était belle, et toujours posée dans
des altitudes élégantes et faciles. Un bon goût irréprochable
ne présidait pas toujours à sa toilette ni à ses
gestes; mais un peintre eût pu trouver en lui, à tous
les instants du jour, un effet à saisir, il était grand,
bien fait, robuste sans être lourd. Sa figure était très-noble,
grâce à la pureté des lignes; et pourtant elle
n'était pas distinguée, ce qui est bien différent. La noblesse
est l'ouvrage de la nature, la distinction est celui
de l'art; l'une est née avec nous, l'autre s'acquiert. Elle
réside dans un certain arrangement et dans l'expression
habituelle. La barbe noire et épaisse d'Horace était taillée
avec un dandysme qui sentait son quartier latin d'une
lieue, et sa forte chevelure d'ébène s'épanouissait avec
une profusion qu'un dandy véritable aurait eu le soin
de réprimer. Mais lorsqu'il passait sa main avec impétuosité
dans ce flot d'encre, jamais le désordre qu'elle y
portait n'était ridicule ou nuisible à la beauté du front.
Horace savait parfaitement qu'il pouvait impunément déranger
dix fois par heure sa coiffure, parce que, selon
l'expression qui lui échappa un jour devant moi, ses
cheveux étaient admirablement bien plantés. Il était
habillé avec une sorte de recherche. Il avait un tailleur
sans réputation et sans notions de la vraie fashion, mais
qui avait l'esprit de le comprendre et de hasarder toujours
avec lui un parement plus large, une couleur de
gilet plus tranchée, une coupe plus cambrée, un gilet
mieux bombé en plastron qu'il ne le faisait pour ses autres
jeunes clients. Horace eût été parfaitement ridicule sur le
boulevard de Gand; mais au jardin du Luxembourg et
au parterre de l'Odéon, il était le mieux mis, le plus dégagé,
le plus serré des côtes, le plus étoffé des flancs, le
plus voyant, comme on dit en style de journal des modes.
Il avait le chapeau sur l'oreille, ni trop ni trop peu, et sa
canne n'était ni trop grosse ni trop légère. Ses habits
n'avaient pas ce moelleux de la manière anglaise qui
caractérise les vrais élégants; en revanche, ses mouvements
avaient tant de souplesse, et il portait ses revers
inflexibles avec tant d'aisance et de grâce naturelle, que
du fond de leurs carrosses ou du haut de leurs avant-scènes,
les dames du noble faubourg, voire les jeunes,
avaient pour lui un regard en passant.
Horace savait qu'il était beau, et il le faisait sentir
continuellement, quoiqu'il eût l'esprit de ne jamais parler
de sa figure. Mais il était toujours occupé de celle des
autres. Il en remarquait minutieusement et rapidement
toutes les défectuosités, toutes les particularités désagréables;
et naturellement il vous amenait, par ses observations
railleuses, à comparer intérieurement sa personne
à celle de ses victimes. Il était mordant sur ce
sujet-là; et comme il avait un nez admirablement dessiné
et des yeux magnifiques, il était sans pitié pour les
nez mal faits et pour les yeux vulgaires. Il avait pour les
bossus une compassion douloureuse, et chaque fois qu'il
m'en faisait remarquer un, j'avais la naïveté de regarder
en anatomiste sa charpente dorsale, dont les vertèbres
frémissaient d'un secret plaisir, quoique le visage n'exprimât
qu'un sourire d'indifférence pour cet avantage frivole
d'une belle conformation. Si quelqu'un s'endormait
dans une attitude gênée ou disgracieuse, Horace était
toujours le premier à en rire. Cela me força de remarquer,
lorsqu'il habita ma chambre, ou que je le surpris
dans la sienne, qu'il s'endormait toujours avec un bras
plié sous la nuque ou rejeté sur la tête comme les statues
antiques; et ce fut cette observation, en apparence puérile,
qui me conduisit à comprendre cette affectation naturelle,
c'est-à-dire innée, dont j'ai parlé plus haut. Même
en dormant, même seul et sans miroir, Horace s'arrangeait
pour dormir noblement. Un de nos camarades prétendait
méchamment qu'il posait devant les mouches.
Que l'on me pardonne ces détails. Je crois qu'ils étaient
nécessaires, et je reviens à mes premiers entretiens avec
lui.
II.
Le jour suivant, je lui demandai pourquoi, ayant une
telle répugnance pour le droit, il ne se livrait pas à
l'étude de quelque autre science. «Mon cher Monsieur,
me dit-il avec une assurance qui n'était pas de son âge,
et qui semblait empruntée à l'expérience d'un homme
de quarante ans, il n'y a aujourd'hui qu'une profession
qui conduise à tout, c'est celle d'avocat.
—Qu'est-ce donc que vous appelez tout? lui demandai-je?
—Pour le moment, me répondit-il, la députation est
tout. Mais attendez un peu, et nous verrons bien autre
chose!
—Oui, vous comptez sur une nouvelle révolution?
Mais si elle n'arrive pas, comment vous arrangerez-vous
pour être député? Vous avez donc de la fortune?
—Non pas précisément; mais j'en aurai.
—A la bonne heure. En ce cas, il s'agit pour vous
d'avoir votre diplôme, et vous n'aurez pas besoin d'exercer.
Je le croyais sincèrement dans une position de fortune
assez éminente pour légitimer sa confiance. Il hésita
quelques instants; puis, n'osant me confirmer dans mon
erreur, ni m'en tirer brusquement, il reprit: «Il faut
exercer pour être connu... sans aucun doute, avant deux
ans les capacités seront admises à la candidature; il faut
donc faire preuve de capacité.
—Deux ans? cela me paraît bien peu; d'ailleurs il
vous faut bien le double pour être reçu avocat et pour
avoir fait vos preuves de capacité; encore serez-vous loin
de l'âge...
—Est-ce que vous croyez que l'âge ne sera pas abaissé
comme le cens, à la prochaine session, peut-être?...
—Je ne le crois pas; mais enfin, c'est une question
de temps, et je crois qu'un peu plus tôt ou un peu plus
tard, vous arriverez, si vous en avez la ferme résolution.
—N'est-il pas vrai, me dit-il avec un sourire de béatitude
et un regard étincelant de fierté, qu'il ne faut que
cela dans le monde? Et que, de si bas que l'on parte,
on peut gravir aux sommités sociales, si l'on a dans le
sein une pensée d'avenir?
—Je n'en doute pas, lui répondis-je; le tout est de
savoir si l'on aura plus ou moins d'obstacles à renverser,
et cela est le secret de la Providence.
—Non, mon cher! s'écria-t-il en passant familièrement
son bras sous le mien; le tout est de savoir si l'on
aura une volonté plus forte que tous les obstacles; et
cela, ajouta-t-il en frappant avec force sur son thorax
sonore, je l'ai!
Nous étions arrivés, tout en causant, en face de la
Chambre des pairs. Horace semblait prêt à grandir comme
un géant dans un conte fantastique. Je le regardai, et
remarquai que, malgré sa barbe précoce, la rondeur des
contours de son visage accusait encore l'adolescence.
Son enthousiasme d'ambition rendait le contraste encore
plus sensible.—Quel âge avez-vous donc? lui demandai-je.
—Devinez! me dit-il avec un sourire.
—Au premier abord on vous donnerait vingt-cinq
ans, lui répondis-je. Mais vous n'en avez peut-être pas
vingt.
—Effectivement, je ne les ai pas encore. Et que voulez-vous
conclure?
—Que votre volonté n'est âgée que de deux ou trois
ans, et que par conséquent elle est bien jeune et bien
fragile encore.
—Vous vous trompez, s'écria Horace. Ma volonté est
née avec moi, elle a le même âge que moi.
—Cela est vrai dans le sens d'aptitude et d'innéité;
mais enfin je présume que cette volonté ne s'est pas encore
exercée beaucoup dans la carrière politique! Il ne
peut pas y avoir longtemps que vous songez sérieusement
à être député; car il n'y a pas longtemps que vous savez
ce que c'est qu'un député?
—Soyez certain que je l'ai su d'aussi bonne heure
qu'il est possible à un enfant. A peine comprenais-je le
sens des mots, qu'il y avait dans celui-là pour moi quelque
chose de magique. Il y a là une destinée, voyez-vous;
la mienne est d'être un homme parlementaire.
Oui, oui, je parlerai et je ferai parler de moi!
—Soit! lui répondis-je, vous avez l'instrument: c'est
un don de Dieu. Apprenez maintenant la théorie.
—Qu'entendez-vous par là? le droit, la chicane?
—Oh! si ce n'était que cela! Je veux dire: Apprenez
la science de l'humanité, l'histoire, la politique, les religions
diverses; et puis, jugez, combinez, formez-vous
une certitude...
—Vous voulez dire des idées? reprit-il avec ce sourire
et ce regard qui imposaient par leur conviction triomphante;
j'en ai déjà, des idées, et si vous voulez que je
vous le dise, je crois que je n'en aurai jamais de meilleures;
car nos idées viennent de nos sentiments, et tous
mes sentiments, à moi, sont grands! Oui, Monsieur, le
ciel m'a fait grand et bon. J'ignore quelles épreuves il
me réserve; mais, je le dis avec un orgueil qui ne pourrait
faire rire que des sots, je me sens généreux, je me
sens fort, je me sens magnanime; mon âme frémit et
mon sang bouillonne à l'idée d'une injustice. Les grandes
choses m'enivrent jusqu'au délire. Je n'en tire et n'en
peux tirer aucune vanité, ce me semble; mais, je le dis
avec assurance, je me sens de la race des héros!»
Je ne pus réprimer un sourire; mais Horace, qui
m'observait, vit que ce sourire n'avait rien de malveillant.
«Vous êtes surpris, me dit-il, que je m'abandonne
ainsi devant vous, que je connais à peine, à des sentiments
qu'ordinairement on ne laisse pas percer, même
devant son meilleur ami? Croyez-vous qu'on soit plus
modeste pour cela?
—Non, certes, et l'on est moins sincère.
—Eh bien, donc, sachez que je me trouve meilleur et
moins ridicule que tous ces hypocrites qui, se croyant
in petto des demi-dieux, baissent sournoisement la tête
et affectent une pruderie prétendue de bon goût. Ceux-là
sont des égoïstes, des ambitieux dans le sens haïssable
du mot et de la chose. Loin de laisser étaler cet enthousiasme
qui est sympathique et autour duquel viennent se
grouper toutes les idées fortes, toutes les âmes généreuses
(et par quel autre moyen s'opèrent les grandes révolutions?),
ils caressent en secret leur étroite supériorité,
et, de peur qu'on ne s'en effraie, ils la dérobent aux
regards jaloux, pour s'en servir adroitement le jour où
leur fortune sera faite. Je vous dis que ces hommes-là
ne sont bons qu'à gagner de l'argent et à occuper des
places sous un gouvernement corrompu; mais les hommes
qui renversent les pouvoirs iniques, ceux qui agitent
les passions généreuses, ceux qui remuent sérieusement
et noblement le monde, les Mirabeau, les Danton, les
Pitt, allez voir s'ils s'amusent aux gentillesses de la modestie!»
Il y avait du vrai dans ce qu'il disait, et il le disait avec
tant de conviction qu'il ne me vint pas dans l'idée de le
contredire, quoique j'eusse dès lors par éducation, peut-être
autant que par nature, l'outrecuidance en horreur.
Mais Horace avait cela de particulier, qu'en le voyant et
en l'écoutant, on était sous le charme de sa parole et de
son geste. Quand on le quittait, on s'étonnait de ne pas
lui avoir démontré son erreur; mais quand on le retrouvait,
on subissait de nouveau le magnétisme de son paradoxe.
Je me séparai de lui ce jour-là, très-frappé de son originalité,
et me demandant si c'était un fou ou un grand
homme. Je penchais pour la dernière opinion.
«Puisque vous aimez tant les révolutions, lui dis-je
le lendemain, vous avez dû vous battre, l'an dernier, aux
journées de Juillet?
—Hélas! j'étais en vacances, me répondit-il; mais là
aussi, dans ma petite province, j'ai agi, et si je n'ai pas
couru de dangers, ce n'est pas ma faute. J'ai été de ceux
qui se sont organisés en garde urbaine volontaire, et qui
ont veillé au maintien de la conquête. Nous passions des
nuits de faction, le fusil sur l'épaule, et si l'ancien système
eût lutté, s'il eût envoyé de la troupe contre nous
comme nous nous y attendions, je me flatte que nous
nous serions mieux conduits que tous ces vieux épiciers
qui ont été ensuite admis à faire partie de la garde nationale,
lorsque le gouvernement l'a organisée. Ceux-là
n'avaient pas bougé de leurs boutiques lorsque l'événement
était encore incertain, et c'est nous qui faisions
la ronde autour de la ville, pour les préserver d'une
réaction du dehors. Quinze jours après, lorsque le danger
fut éloigné, ils nous auraient passé leurs baïonnettes
au travers du corps, si nous eussions crié: Vive la
liberté!»
Ce jour-là, ayant causé assez longtemps avec lui, je lui
proposai de rester avec moi jusqu'à l'heure du dîner, et
ensuite de venir dîner rue de l'Ancienne-Comédie, chez
Pinson, le plus honnête et le plus affable des restaurateurs
du quartier latin.
Je le traitai de mon mieux, et il est certain que la cuisine
de M. Pinson est excellente, très-saine et à bon
marché: son petit restaurant est le rendez-vous des jeunes
aspirants à la gloire littéraire et des étudiants rangés.
Depuis que son collègue et rival Dagnaux, officier
de la garde nationale équestre, avait fait des prodiges de
valeur dans les émeutes, toute une phalange d'étudiants,
ses habitués, avait juré de ne plus franchir le seuil de
ses domaines, et s'était rejetée sur les côtelettes plus
larges et les biftecks plus épais du pacifique et bienveillant
Pinson.
Après dîner, nous allâmes à l'Odéon, voir madame
Dorval et Lockroy, dans Antony. De ce jour, la connaissance
fut faite, et l'amitié nouée complètement entre
Horace et moi.
«Ainsi, lui disais-je dans un entr'acte, vous trouvez
l'étude de la médecine encore plus repoussante que celle
du droit?
—Mon cher, répondit-il, je vous avoue que je ne comprends
rien à votre vocation. Se peut-il que vous puissiez
plonger chaque jour vos mains, vos regards et votre esprit
dans celle boue humaine, sans perdre tout sentiment
de poésie et toute fraîcheur d'imagination?
—Il y a quelque chose de pis que de disséquer les
morts, lui dis-je, c'est d'opérer les vivants: là, il faut
plus de courage et de résolution, je vous assure. L'aspect
du plus hideux cadavre fait moins de mal que le premier
cri de douleur arraché à un pauvre enfant qui ne comprend
rien au mal que vous lui faites. C'est un métier de
boucher, si ce n'est pas une mission d'apôtre.
—On dit que le coeur se dessèche à ce métier-là, reprit
Horace; ne craignez-vous pas de vous passionner
pour la science au point d'oublier l'humanité, comme
ont fait tous ces grands anatomistes que l'on vante, et
dont je détourne les yeux comme si je rencontrais le
bourreau?
—J'espère, répondis-je, arriver juste au degré de sang-froid
nécessaire pour être utile, sans perdre le sentiment
de la pitié et de la sympathie humaine. Pour arriver au
calme indispensable, j'ai encore du chemin à faire, et je
ne crois pas, d'ailleurs, que le coeur s'endurcisse.
—C'est possible, mais enfin, les sens s'énervent, l'imagination
se détend, le sentiment du beau et du laid se
perd; on ne voit plus de la vie qu'un certain côté matériel
où tout l'idéal arrive à l'idée d'utilité. Avez-vous
jamais connu un médecin poëte?
—Je pourrais vous demander également si vous connaissez
beaucoup de députés poëtes? Il ne me semble
pas que la carrière politique, telle que je l'envisage de
nos jours, soit propre à conserver la fraîcheur de l'imagination
et le fragile coloris de la poésie.
—Si la société était réformée, s'écria Horace, cette
carrière pourrait être le plus beau développement pour
la vigueur du cerveau et la sensibilité du coeur; mais il
est certain que la route tracée aujourd'hui est desséchante.
Quand je songe que pour être apte à juger des
vérités sociales, où la philosophie devrait être l'unique
lumière, il faut que je connaisse le Code et le Digeste;
que je m'assimile Pothier, Ducaurroy et Rogron; que je
travaille, en un mot, à m'abrutir, et que, afin de me
mettre en contact avec les hommes de mon temps, je
descende à leur niveau... oh! alors je songe sérieusement
à me retirer de la politique.
—Mais, dans ce cas, que feriez-vous de cet enthousiasme
qui vous dévore, de cette grandeur d'âme qui déborde
en vous? Et quel aliment donneriez-vous à cette
volonté de fer dont vous me faisiez un reproche de douter,
il y a peu de jours?»
Il prit sa tête entre ses deux mains, appuya ses coudes
sur la barre qui sépare le parterre de l'orchestre, et
resta plongé dans ses réflexions jusqu'au lever de la
toile; puis il écouta le troisième acte d'Antony avec une
attention et une émotion très-grandes.
«Et les passions! s'écria-t-il lorsque l'acte fut fini.
Pour combien comptez-vous les passions dans la vie?
—Parlez-vous de l'amour? lui répondis-je. La vie,
telle que nous nous la sommes faite, admet en ce genre
tout ou rien. Vouloir être à la fois amant comme Antony
et citoyen comme vous, n'est pas possible. Il faut opter.
—C'est bien justement là ce que je pensais en écoutant
cet Antony si dédaigneux de la société, si outré
contre elle, si révolté contre tout ce qui fait obstacle à
son amour... Avez-vous jamais aimé, vous?
—Peut-être. Qu'importe? Demandez à votre propre
coeur ce que c'est que l'amour.
—Dieu me damne si je m'en doute, s'écria-t-il en
haussant les épaules. Est-ce que j'ai jamais eu le temps
d'aimer, moi? Est-ce que je sais ce que c'est qu'une
femme? Je suis pur, mon cher, pur comme une oie,
ajouta-t-il en éclatant de rire avec beaucoup de bonhomie;
et dussiez-vous me mépriser, je vous dirai que,
jusqu'à présent, les femmes m'ont fait plus de peur que
d'envie. J'ai pourtant beaucoup de barbe au menton et
beaucoup d'imagination à satisfaire. Eh bien! c'est là
surtout ce qui m'a préservé des égarements grossiers où
j'ai vu tomber mes camarades. Je n'ai pas encore rencontré
la vierge idéale pour laquelle mon coeur doit se
donner la peine de battre. Ces malheureuses grisettes
que l'on ramasse à la Chaumière et autres bergeries immondes,
me font tant de pitié, que pour tous les plaisirs
de l'enfer, je ne voudrais pas avoir à me reprocher la
chute d'un de ces anges déplumés. Et puis, cela a de
grosses mains, des nez retroussés; cela fait des pa-ta-qu'est-ce,
et vous reproche son malheur dans des lettres
à mourir de rire. Il n'y a pas même moyen d'avoir avec
cela un remords sérieux. Moi, si je me livre à l'amour,
je veux qu'il me blesse profondément, qu'il m'électrise,
qu'il me navre, ou qu'il m'exalte au troisième ciel et
m'enivre de voluptés. Point de milieu: l'un ou l'autre,
l'un et l'autre si l'on veut; mais pas de drame d'arrière-boutique,
pas de triomphe d'estaminet! Je veux bien
souffrir, je veux bien devenir fou, je veux bien m'empoisonner
avec ma maîtresse ou me poignarder sur son
cadavre; mais je ne veux pas être ridicule, et surtout je
ne, veux pas m'ennuyer un milieu de ma tragédie et la
finir par un trait de vaudeville. Mes compagnons raillent
beaucoup mon innocence; ils font les don Juan sous mes
yeux pour me tenter ou m'éblouir, et je vous assure qu'ils
le font à bon marché. Je leur souhaite bien du plaisir;
mais j'en désire un autre pour mon compte. A quoi songez-vous?
ajouta-t-il en me voyant détourner la tête
pour lui cacher une forte envie de rire.
—Je songe, lui dis-je, que j'ai demain à déjeuner chez
moi une grisette fort aimable, à laquelle je veux vous
présenter.
—Oh! que Dieu me préserve de ces parties-là! s'écria-t-il.
J'ai cinq ou six de mes amis que je suis condamné
à ne plus entrevoir qu'à travers le fantôme léger
de leurs ménagères à la quinzaine. Je sais par coeur le
vocabulaire de ces femelles. Fi, vous me scandalisez,
vous que je croyais plus grave que tous ces absurdes
compagnon! Je les fuis depuis huit jours pour m'attacher
à vous, qui me semblez un homme sérieux, et qui,
à coup sûr, avez des moeurs élégantes pour un étudiant;
et voilà que vous avez une femme, vous aussi! Mon
Dieu, où irai-je me cacher pour ne plus rencontrer de
ces femmes-là?
—Il faudra pourtant vous risquer à voir la mienne. Je
vous dis que j'y tiens, et que j'irai vous chercher si vous
ne venez pas déjeuner demain avec elle chez moi.
—Si vous êtes dégoûté d'elle, je vous avertis que je ne
suis pas l'homme qui vous en débarrasserai.
—Mon cher Horace, je vais vous rassurer en vous déclarant
que si vous étiez tenté de la débarrasser de moi,
il faudrait commencer par me couper la gorge.
—Parlez-vous sérieusement?
—Le plus sérieusement du monde.
—En ce cas, j'accepte votre invitation. J'aurai du
plaisir à voir de plus près un véritable amour...
—Pour une grisette, n'est-ce pas, cela vous étonne?
—Eh bien! oui, cela m'étonne. Quant à moi, je n'ai
jamais vu qu'une femme que j'aurais pu aimer, si elle
avait eu vingt ans de moins. C'était une douairière de
province, une châtelaine encore blonde, jadis belle, et
parlant, marchant, accueillant et congédiant d'une certaine
façon, auprès de laquelle toutes les femmes que
j'avais vues jusque-là me semblèrent des gardeuses de
dindons. Cette dame était d'une ancienne famille; elle
avait la taille d'une guêpe, les mains d'une vierge de
Raphaël, les pieds d'une sylphide, le visage d'une momie
et la langue d'une vipère. Mais je me suis bien promis
de ne jamais prendre une maîtresse belle, aimable
et jeune, à moins qu'elle n'ait ces pieds et ces mains-là,
et surtout ces manières aristocratiques, et beaucoup de
dentelles blanches sur des cheveux blonds.
—Mon cher Horace, lui dis-je, vous êtes encore loin
du temps où vous aimerez, et peut-être n'aimerez-vous
jamais.
—Dieu vous entende! s'écria-t-il. Si j'aime une fois,
je suis perdu. Adieu ma carrière politique; adieu mon
austère et vaste avenir! Je ne sais rien être à demi.
Voyons, serai-je orateur, serai-je poète, serai-je amoureux?
—Si nous commencions par être étudiants? lui dis-je.
—Hélas! vous en parlez à votre aise, répondit-il.
Vous êtes étudiant et amoureux. Moi, je n'aime pas, et
j'étudie encore moins!»
III.
Horace m'inspirait le plus vif intérêt. Je n'étais pas
absolument convaincu de cette force héroïque et de cet
austère enthousiasme qu'il s'attribuait dans la sincérité
de son coeur. Je voyais plutôt en lui un excellent enfant,
généreux, candide, plus épris de beaux rêves que capable
encore de les réaliser. Mais sa franchise et son aspiration
continuelle vers les choses élevées me le faisaient
aimer sans que j'eusse besoin de le regarder comme un
héros. Cette fantaisie de sa part n'avait rien de déplaisant:
elle témoignait de son amour pour le beau idéal.
De deux choses l'une, me disais-je: ou il est appelé à
être un homme supérieur, et un instinct secret auquel il
obéit naïvement le lui révèle, ou il n'est qu'un brave
jeune homme, qui, cette fièvre apaisée, verra éclore en
lui une bonté douce, une conscience paisible, échauffée
de temps à autre par un rayon d'enthousiasme.
Après tout, je l'aimais mieux sous ce dernier aspect.
J'eusse été plus sûr de lui voir perdre cette fatuité candide
sans perdre l'amour du beau et du bien. L'homme
supérieur a une terrible destinée devant lui. Les obstacles
l'exaspèrent, et son orgueil est parfois tenace et
violent, au point de l'égarer et de changer en une puissance
funeste celle que Dieu lui avait donnée pour le
bien. D'une manière ou de l'autre, Horace me plaisait et
m'attachait. Ou j'avais à le seconder dans sa force, ou
j'avais à le secourir dans sa faiblesse. J'étais plus âgé
que lui de cinq à six ans; j'étais doué d'une nature plus
calme; mes projets d'avenir étaient assis et ne me causaient
plus de souci personnel. Dans l'âge des passions,
j'étais préservé des fautes et des souffrances par une affection
pleine de douceur et de vérité. Je sentais que tout
ce bonheur était un don gratuit de la Providence, que
je ne l'avais pas mérité assez pour en jouir seul, et que
je devais faire profiter quelqu'un de cette sérénité de
mon âme, en la posant comme un calmant sur une autre
âme irritable ou envenimée. Je raisonnais en médecin;
mais mon intention était bonne, et, sauf à répéter les
innocentes vanteries de mon pauvre Horace, je dirai que
moi aussi, j'étais bon, et plus aimant que je ne savais
l'exprimer.
La seule chose clairement absurde et blâmable que
j'eusse trouvée dans mon nouvel ami, c'était cette aspiration
vers la femme aristocratique, en lui, républicain
farouche, mauvais juge, à coup sûr, en fait de belles
manières, et dédaigneux avec exagération des formes
naïves et brusques, dont il n'était certes pas lui-même
aussi décrassé qu'il en avait la prétention.
J'avais résolu de lui faire faire connaissance avec Eugénie
plus tôt que plus tard, m'imaginant que la vue de
cette simple et noble créature changerait ses idées ou
leur donnerait au moins un cours plus sage. Il la vit, et
fut frappé de sa bonne grâce, mais il ne la trouva point
aussi belle qu'il s'était imaginé devoir être une femme
aimée sérieusement. «Elle n'est que bien, me dit-il entre
deux portes. Il faut qu'elle ait énormément d'esprit.—Elle
a plus de jugement que d'esprit, lui répondis-je, et
ses anciennes compagnes l'ont jugée fort sotte.
Elle servit notre modeste déjeuner, qu'elle avait préparé
elle-même, et cette action prosaïque souleva de dégoût
le coeur altier d'Horace. Mais lorsqu'elle s'assit entre
nous deux, et qu'elle lui fit les honneurs avec une
aisance et une convenance parfaites, il fut frappé de
respect, et changea tout à coup de manière d'être. Jusque-là
il avait écrasé ma pauvre Eugénie de paradoxes
fort spirituels qui ne l'avaient même pas fait sourire, ce
qu'il avait pris pour un signe d'admiration. Lorsqu'il
put pressentir en elle un juge au lieu d'une dupe, il devint
sérieux, et prit autant de peine pour paraître grave,
qu'il venait d'en prendre pour paraître léger. Il était
trop tard. Il avait produit sur la sévère Eugénie une impression
fâcheuse; mais elle ne lui en témoigna rien, et
à peine le déjeuner fut-il achevé, qu'elle se retira dans
un coin de la chambre et se mit à coudre, ni plus ni
moins qu'une grisette ordinaire. Horace sentit son respect
s'en aller comme il était venu.
Mon petit appartement, situé sur le quai des Augustins,
était composé de trois pièces, et ne me coûtait
pas moins de trois cents francs de loyer. J'étais dans
mes meubles: c'était du luxe pour un étudiant. J'avais
une salle à manger, une chambre à coucher, et, entre
les deux, un cabinet d'étude que je décorais du nom de
salon. C'est là que nous primes le café. Horace, voyant
des cigares, en alluma un sans façon.—Pardon, lui
dis-je en lui prenant le bras, ceci déplaît à Eugénie; je
ne fume jamais que sur le balcon. Il prit la peine de demander
pardon à Eugénie de sa distraction; mais au
fond il était surpris de me voir traiter ainsi une femme
qui était en train d'ourler mes cravates.
Mon balcon couronnait le dernier étage de la maison.
Eugénie l'avait ombragé de liserons et de pots de senteur,
qu'elle avait semés dans deux caisses d'oranger.
Les orangers étaient fleuris, et quelques pots de violettes
et de réséda complétaient les délices de mon divan.
Je fis a Horace les honneurs du morceau de vieille tenture
qui me servait de tapis d'Orient, et du coussin de
cuir sur lequel j'appuyais mon coude pour fumer ni plus
ni moins voluptueusement qu'un pacha. La vitre de la
fenêtre séparait le divan de la chaise sur laquelle Eugénie
travaillait dans le cabinet. De cette façon, je la
voyais j'étais avec elle, sans l'incommoder de la fumée
de mon tabac. Quand elle vit Horace sur le tapis au lieu
de moi, elle baissa doucement et sans affectation le rideau
de mousseline de la croisée entre elle et nous, feignant
d'avoir trop de soleil, mais effectivement par un sentiment
de pudeur qu'Horace comprit fort bien. Je m'étais
assis sur une des caisses d'oranger, derrière lui. Il y
avait de la place bien juste pour deux personnes et pour
quatre ou cinq pots de fleurs sur cet étroit belvédère;
mais nous embrassions d'un coup d'oeil la plus belle
partie du cours de la Seine, toute la longueur du Louvre,
jaune au soleil et tranchant sur le bleu du ciel, tous
les ponts et tous les quais jusqu'à l'Hôtel-Dieu. En face
de nous, la Sainte-Chapelle dressait ses aiguilles d'un
gris sombre et son fronton aigu au-dessus des maisons de
la Cité; la belle tour de Saint-Jacques-la-Boucherie élevait
un peu plus loin ses quatre lions géants jusqu'au
ciel, et la façade de Notre-Dame formait le tableau, à
droite, de sa masse élégante et solide. C'était un beau
coup d'oeil; d'un côté, le vieux Paris, avec ses monuments
vénérables et son désordre pittoresque; de l'autre,
le Paris de la renaissance, se confondant avec le Paris
de l'Empire, l'oeuvre de Médicis, de Louis XIV et de Napoléon.
Chaque colonne, chaque porte était une page de
l'histoire de la royauté.
Nous venions de lire dans sa nouveauté Notre-Dame
de-Paris; nous nous abandonnions naïvement, comme
tout le monde alors, ou du moins comme tous les jeunes
gens, au charme de poésie répandu fraîchement par
cette oeuvre romantique sur les antiques beautés de
notre capitale. C'était comme un coloris magique à travers
lequel les souvenirs effacés se ravivaient; et, grâce
au poête, nous regardions le faite de nos vieux édifices,
nous en examinions les formes tranchées et les effets
pittoresques avec des yeux que nos devanciers les étudiants
de l'Empire et de la Restauration, n'avaient certainement
pas eus. Horace était passionné pour Victor
Hugo. Il en aimait avec fureur toutes les étrangetés,
toutes les hardiesses. Je ne discutais point, quoique je
ne fusse pas toujours de son avis. Mon goût et mon instinct
me portaient vers une forme moins accidentée,
vers une peinture aux contours moins âpres et aux ombres
moins dures. Je le comparais à Salvator Rosa, qui a
vu avec les yeux de l'imagination plus qu'avec ceux de
la science. Mais pourquoi aurais-je fait contre Horace la
guerre aux mots et aux figures? Ce n'est pas à dix-neuf
ans qu'on recule devant l'expression qui rend une sensation
plus vive, et ce n'est pas à vingt-cinq ans qu'on la
condamne. Non, l'heureuse jeunesse n'est point pédante;
elle ne trouve jamais de traduction trop énergique pour
rendre ce qu'elle éprouve avec tant d'énergie elle-même,
et c'est bien quelque chose pour un poète que de donner
à sa contemplation une certaine forme assez large et assez
frappante pour qu'une génération presque entière
ouvre les yeux avec lui et se mette à jouir des mêmes
émotions qui l'ont inspiré!
Il en a été ainsi: les plus récalcitrants d'entre nous,
ceux qui avaient besoin, pour se rafraîchir la vue, de
lire, en fermant Notre-Dame-de-Paris, une page de
Paul et Virginie, ou, comme a dit un élégant critique,
de repasser bien vite le plus cristallin des sonnets de
Pétrarque, n'en ont pas moins mis sur leurs yeux délicats
ces lunettes aux couleurs bigarrées qui faisaient voir
tant de choses nouvelles; et après qu'ils ont joui de ce
spectacle plein d'émotions, les ingrats ont prétendu que
c'étaient là d'étranges lunettes. Étranges tant que vous
voudrez; mais, sans ce caprice du maître, et avec vos
yeux nus, auriez-vous distingué quelque chose?
Horace faisait à ma critique de minces concessions,
j'en faisais de plus larges à son enthousiasme; et, après
avoir discuté, nos regards, suivant au vol les hirondelles
et les corbeaux qui rasaient nos têtes, allaient se reposer
avec eux sur les tours de Notre-Dame, éternel objet de
notre contemplation. Elle a eu sa part de nos amours,
la vieille cathédrale, comme ces beautés délaissées qui
reviennent de mode, et autour desquelles la foule s'empresse
dès qu'elles ont retrouvé un admirateur fervent
dont la louange les rajeunit.
Je ne prétends pas faire de ce récit d'une partie de ma
jeunesse un examen critique de mon époque: mes forces
n'y suffiraient pas; mais je ne pouvais repasser certains
jours dans mes souvenirs sans rappeler l'influence que
certaines lectures exercèrent sur Horace, sur moi, sur
nous tous. Cela fait partie de notre vie, de nous-mêmes,
pour ainsi dire. Je ne sais point séparer dans ma mémoire
les impressions poétiques de mon adolescence de
la lecture de René et d'Atala.
Au milieu de nos dissertations romantiques, on sonna
à la porte. Eugénie m'en avertit en frappant un petit
coup contre la vitre, et j'allai ouvrir. C'était un élève en
peinture de l'école d'Eugène Delacroix, nommé Paul
Arsène, surnommé le petit Masaccio à l'atelier où j'allais
tous les jours faire un cours d'anatomie à l'usage
des peintres.
«Salut au signor Masaccio, lui dis-je en le présentant
à Horace, qui jeta un regard glacial sur sa blouse malpropre
et ses cheveux mal peignés. Voici un jeune maître
qui ira loin, à ce qu'on assure, et qui vient en attendant
me chercher pour la leçon.
—Non pas encore, me répondit Paul Arsène; vous
avez plus d'une heure devant vous; je venais pour vous
parler de choses qui me concernent particulièrement. Auriez-vous
le loisir de m'écouter?
—Certainement, répondis-je; et si mon ami est de
trop, il retournera fumer sur le balcon.
—Non, reprit le jeune homme, je n'ai rien de secret
à vous dire, et, comme deux avis valent mieux qu'un, je
ne serai pas fâché que monsieur m'entende aussi.
—Asseyez-vous, lui dis-je en allant chercher une quatrième
chaise dans l'autre chambre.
—Ne faites pas attention,» dit le rapin en grimpant sur
la commode; et, ayant mis sa casquette entre son coude
et son genou, il essuya d'un mouchoir à carreaux sa
figure inondée de sueur et parla en ces termes, les jambes
pendantes et le reste du corps dans l'altitude du
Pensieroso:
«Monsieur, j'ai envie de quitter la peinture et d'entrer
dans la médecine, parce qu'on me dit que c'est un
meilleur état; je viens donc vous demander ce que vous
en pensez.
—Vous me faites une question, lui dis-je, à laquelle
il est plus difficile de répondre que vous ne pensez. Je
crois toutes les professions très-encombrées, et par conséquent
tous les états, comme vous dites, très-précaires.
De grandes connaissances et une grande capacité ne
sont pas des garanties certaines d'avenir; enfin je ne
vois pas en quoi la médecine vous offrirait plus de chances
que les arts. Le meilleur parti à prendre c'est celui
que nos aptitudes nous indiquent; et puisque vous avez,
assure-t-on, les plus remarquables dispositions pour la
peinture, je ne comprends pas que vous en soyez déjà
dégoûté.
—Dégoûté, moi! oh! non, répliqua le Masaccio; je
ne suis dégoûté de rien du tout, et si l'on pouvait gagner
sa vie à faire de la peinture, j'aimerais mieux cela
que toute autre chose; mais il paraît que c'est si long,
si long! Mon patron dit qu'il faudra dessiner le modèle
pendant deux ans au moins avant de manier le pinceau.
Et puis, avant d'exposer, il paraît qu'il faut encore travailler
la peinture au moins deux ou trois ans. Et quand
on a exposé, si on n'est pas refusé, on n'est souvent pas
plus avancé qu'auparavant. J'étais ce matin au Musée, je
croyais que tout le monde allait s'arrêter devant le tableau
de mon patron; car enfin c'est un maître, et un
fameux, celui-là! Eh bien! la moitié des gens qui passaient
ne levaient seulement pas la tête, et ils allaient
tous regarder un monsieur qui s'était fait peindre en
habit d'artilleur et qui avait des bras de bois et une
figure de carton. Passe pour ceux-là: c'étaient de pauvres
ignorants; mais voilà qu'il est venu des jeunes
gens, élèves en peinture de différents ateliers, et que
chacun disait son mot: ceux-ci blâmaient, ceux-là admiraient;
mais pas un n'a parlé comme j'aurais voulu.
Pas un ne comprenait. Je me suis dit alors: A quoi bon
faire de l'art pour un public qui n'y voit et qui n'y entend
goutte. C'était bon dans les temps! Moi je vais
prendre un autre métier pourvu que ça me rapporte de
L'argent.
—Voilà un sale crétin! me dit Horace en se penchant
vers mon oreille. Son âme est aussi crasseuse que sa
blouse!»
Je ne partageais pas le mépris d'Horace. Je ne connaissais
presque pas le Masaccio, mais je le savais intelligent
et laborieux. M. Delacroix en faisait grand cas,
et ses camarades avaient de l'estime et de l'amitié pour
lui. Il fallait qu'une pensée que je ne comprenais pas fût
cachée sous ces manifestations de cupidité ingénue; et
comme il avait déclaré, en commençant, n'avoir rien de
secret à me dire, je prévoyais bien que ce secret ne sortirait
pas aisément. Il ne fallait, pour se convaincre de
l'obstination du Masaccio, et en même temps pour pressentir
en lui quelque motif non vulgaire, que regarder
sa figure et observer ses manières.
C'était le type peuple incarné dans un individu; non
le peuple robuste et paisible qui cultive la terre, mais le
peuple artisan, chétif, hardi, intelligent et alerte. C'est
dire qu'il n'était pas beau. Cependant il était de ceux dont
les camarades d'atelier disent: «Il y a quelque chose
de fameux à faire avec cette tête-là!» C'est qu'il y avait
dans sa tête, en effet, une expression magnifique, sous
la vulgarité des traits. Je n'en ai jamais vu de plus énergique
ni de plus pénétrante. Ses yeux étaient petits et
même voilés, sous une paupière courte et bridée; cependant
ces yeux là lançaient des flammes, et le regard était
si rapide qu'il semblait toujours prêt à déchirer l'orbite.
Le nez était trop court, et le peu de distance entre le
coin de l'oeil et la narine donnait au premier aspect l'air
commun et presque bas à la face entière; mais cette
impression ne durait qu'un instant. S'il y avait encore
de l'esclave et du vassal dans l'enveloppe, le génie de
l'indépendance couvait intérieurement et se trahissait
par des éclairs. La bouche épaisse, ombragée d'une naissante
moustache noire, irrégulièrement plantée; la figure
large, le menton droit, serré et un peu fendu au milieu;
les zygomas élevés et saillants; partout des plans
fermes et droits, coupés de lignes carrées, annonçaient
une volonté peu commune et une indomptable droiture
d'intention. Il y avait à la commissure des narines des
délicatesses exquises pour un adepte de Lavater; et le
front, qui était d'une structure admirable dans le sens
de la statuaire, ne l'était pas moins au point de vue
phrénologique. Pour moi, qui étais dans toute la ferveur
de mes recherches, je ne me lassais point de le regarder;
et lorsque je faisais mes démonstrations anatomiques
à l'atelier, je m'adressais toujours instinctivement
à ce jeune homme, qui était pour moi le type de l'intelligence,
du courage et de la bonté.
Aussi je souffrais, je l'avoue, de l'entendre parler d'une
manière si triviale.—Comment, Arsène, lui dis-je, vous
quitteriez la peinture pour un peu plus de profit dans
une autre carrière?
—Oui, Monsieur, je le ferais comme je vous le dis,
répondit-il sans le moindre embarras. Si maintenant j'étais
assuré de gagner mille francs nets par an, je me ferais
cordonnier.
—C'est un art comme un autre, dit Horace avec un
sourire de mépris.
—Ce n'est point un art, répliqua froidement le Masaccio.
C'est le métier de mon père, et je n'y serais pas plus
maladroit qu'un autre. Mais cela ne me donnerait pas
l'argent qu'il me faut.
—Il vous faut donc bien de l'argent, mon pauvre garçon?
lui dis-je.
—Je vous le dis, il me faudrait gagner mille francs;
et, au lieu de cela, j'en dépense la moitié.
—Comment pouvez-vous songer en ce cas à étudier la
médecine! Il vous faudrait avoir une trentaine de mille
francs devant vous, tant pour les années où l'on étudie
que pour celles où l'on attend la clientèle. Et puis...
—Et puis vous n'avez pas fait vos classes, dit Horace,
impatienté de ma patience.
—-Cela c'est vrai, dit Arsène; mais je les ferais, ou
du moins je ferais l'équivalent. Je me mettrais dans ma
chambre avec une cruche d'eau et un morceau de pain,
et il me semble bien que j'apprendrais dans une semaine
ce que les écoliers apprennent dans un mois. Car les écoliers,
en général, n'aiment pas à travailler; et quand on
est enfant, on joue, et on perd du temps. Quand on a
vingt ans, et plus de raison, et quand d'ailleurs on est
forcé de se dépêcher, on se dépêche. Mais d'après ce que
vous me dites du reste de l'apprentissage, je vois bien
que je ne puis pas être médecin. Et pour être avocat?
Horace éclata de rire.
«Vous allez vous faire mal à l'estomac, lui dit tranquillement
le Masaccio, frappé de l'affectation d'Horace
en cet instant.
—Mon cher enfant, repris-je, éloignez tous ces projets,
à votre âge ils sont irréalisables. Vous n'avez devant
vous que les arts et l'industrie. Si vous n'avez ni argent
ni crédit, il n'y a pas plus de certitude d'un côté que de
l'autre. Quelque parti que vous preniez, il vous faut du
temps, de la patience et de la résignation.»
Arsène soupira. Je me réservai de l'interroger plus tard.
«Vous êtes né peintre, cela est certain, continuai-je;
c'est encore par là que vous marcherez plus vite.
—Non, Monsieur, répliqua-t-il; je n'ai qu'à entrer
demain dans un magasin de nouveautés, je gagnerai de
l'argent.
—Vous pouvez même être laquais, ajouta Horace, indigné
de plus en plus.
—Cela me déplairait beaucoup, dit Arsène; mais s'il
n'y avait que cela!...
—Arsène! Arsène! m'écriai-je, ce serait un grand
malheur pour vous et une perte pour l'art. Est-il possible
que vous ne compreniez pas qu'une grande faculté est
un grand devoir imposé par la Providence?
—Voilà une belle parole, dit Arsène, dont les yeux
s'enflammèrent tout à coup. Mais il y a d'autres devoirs
que ceux qu'on remplit envers soi-même. Tant pis!
Allons, je m'en vais dire à l'atelier que vous viendrez à
trois heures, n'est-ce pas?»
Et il sauta à bas de la commode, me serra la main sans
rien dire, salua à peine Horace, et s'enfonça comme un
chat dans la profondeur de l'escalier, s'arrêtant à chaque
étage pour faire rentrer ses talons dans ses souliers
délabrés.
IV.
Paul Arsène revint me voir; et quand nous fûmes
seuls, j'obtins, non sans peine, la confidence que je pressentais.
Il commença par me faire en ces termes le récit
de sa vie:
«Comme je vous l'ai dit, Monsieur, mon père est
cordonnier en province. Nous étions cinq enfants; je suis
le troisième. L'aîné était un homme fait lorsque mon
père, déjà vieux, et pouvant se retirer du métier avec un
peu de bien, s'est remarié avec une femme qui n'était ni
belle ni bonne, ni jeune ni riche, mais qui s'est emparée
de son esprit, et qui gaspille son honneur et son argent.
Mon père, trompé, malheureux, d'autant plus épris
qu'elle lui donne plus de sujets de jalousie, s'est jeté
dans le vin, pour s'étourdir, comme on fait dans notre
classe quand on a du chagrin. Pauvre père! nous avons
bien patienté avec lui, car il nous faisait vraiment pitié.
Nous l'avions connu si sage et si bon! Enfin, un temps
est venu où il n'était plus possible d'y tenir. Son caractère
avait tellement changé, que pour un mot, pour
un regard, il se jetait sur nous pour nous frapper. Nous
n'étions plus des enfants, nous ne pouvions pas souffrir
cela. D'ailleurs nous avions été élevés avec douceur, et
nous n'étions pas habitués à avoir l'enfer dans notre famille.
Et puis, ne voilà-t-il pas qu'il a pris de la jalousie
contre mon frère aîné! Le fait est que la belle-mère lui
avait fait des avances, parce qu'il était beau garçon et
bon enfant; mais il l'avait menacée de tout raconter à
mon père, et elle avait pris les devants, comme dans la
tragédie de Phèdre, que je n'ai jamais vu jouer depuis
sans pleurer. Elle avait accusé mon pauvre frère de ses
propres égarements d'esprit. Alors mon frère s'est vendu
comme remplaçant, et il est parti. Le second, qui prévoyait
que quelque chose de semblable pourrait bien lui
arriver, est venu ici chercher fortune, en me promettant
de me faire venir aussitôt qu'il aurait trouvé un moyen
d'exister. Moi, je restais à la maison avec mes deux
soeurs, et je vivais assez tranquillement, parce que j'avais
pris le parti de laisser crier la méchante femme sans
jamais lui répondre. J'aimais à m'occuper; je savais
assez bien ce que j'avais appris en classe; et quand je
n'aidais pas mon père à la boutique, je m'amusais à lire
ou à barbouiller du papier, car j'ai toujours eu du goùt
pour le dessin. Mais comme je pensais que cela ne me
servirait jamais à rien, j'y perdais le moins de temps
possible. Un jour, un peintre qui parcourait le pays pour
faire des études de paysage, commanda chez nous une
paire de gros souliers, et je fus chargé d'aller lui prendre
mesure. Il avait des albums étalés sur la table de sa
petite chambre d'auberge; je lui demandai la permission
de les regarder; et comme ma curiosité lui donnait à
penser, il me dit de lui faire, d'idée, un bonhomme sur
un bout de papier qu'il me mit dans les mains ainsi
qu'un crayon. Je pensai qu'il se moquait de moi; mais
le plaisir de charbonner avec un crayon si noir sur un
papier si coulant l'emporta sur l'amour-propre. Je fis ce
qui me passa par la tête; il le regarda, et ne rit pas. Il
voulut même le coller dans son album, et y écrire mon
nom, ma profession et le nom de mon endroit. «Vous
avez tort de rester ouvrier, me dil-il: vous êtes né pour
la peinture. A votre place, je quitterais tout pour aller
étudier dans quelque grande ville.» Il me proposa même
de m'emmener; car il était bon et généreux, ce jeune
homme-là. Il me donna son adresse à Paris, afin que, si
le coeur m'en disait, je pusse aller le trouver. Je le remerciai,
et n'osai ni le suivre ni croire aux espérances
qu'il me donnait. Je retournai à mes cuirs et à mes
formes, et un an se passa encore sans orage entre mon
père et moi.
«La belle-mère me haïssait: comme je lui cédais toujours,
les querelles n'allaient pas loin. Mais un beau jour
elle remarqua que ma soeur Louison, qui avait déjà
quinze ans, devenait jolie, et que les gens du quartier
s'en apercevaient. La voilà qui prend Louison en haine,
qui commence à lui reprocher d'être une petite coquette,
et pis que cela. La pauvre Louison était pourtant aussi
pure qu'un enfant de dix ans, et avec cela, fière comme
était notre pauvre mère. Louison, désespérée, au lieu de
filer doux comme je le lui conseillais, se pique, répond,
et menace de quitter la maison. Mon père veut la soutenir;
mais sa femme a bientôt pris le dessus. Louison
est grondée, insultée, frappée, Monsieur, hélas! et la petite
Suzanne aussi, qui voulait prendre le parti de sa
soeur, et qui criait pour ameuter le voisinage. Alors je
prends un jour ma soeur Louison par un bras, et ma petite
soeur Suzanne de l'autre, et nous voilà partis tous
les trois, à pied, sans un sou, sans une chemise, et pleurant
au soleil sur le grand chemin. Je vas trouver ma
tante Henriette, qui demeure à plus de dix lieues de
notre ville, et je lui dis d'abord:
«Ma tante, donnez-nous à manger et à boire, car
nous mourons de faim et de soif; nous n'avons pas seulement
la force de parler. Et après que ma tante nous eut
donné à dîner, je lui dis:
—Je vous ai amené vos nièces: si vous ne voulez pas
les garder, il faut qu'elles aillent de porte en porte demander
leur pain, ou qu'elles retournent à la maison
pour périr sous les coups. Mon père avait cinq enfants,
et il ne lui en reste plus. Les garçons se tireront d'affaire
en travaillant; mais si vous n'avez pas pitié des filles, il
leur arrivera ce que je vous dis.»
Alors ma tante répondit:—Je suis bien vieille, je suis
bien pauvre; mais plutôt que d'abandonner mes nièces,
j'irai mendier moi-même. D'ailleurs elles sont sages,
elles sont courageuses, et nous travaillerons toutes les
trois. Cela dit et convenu, j'acceptai vingt francs que la
pauvre femme voulut absolument me donner, et je partis
sur mes jambes pour venir ici. Je fus tout de suite trouver
mon second frère, Jean, qui me fit donner de l'ouvrage
dans la boutique où il travaillait comme cordonnier,
et ensuite j'allai voir mon jeune peintre pour lui
demander des conseils. Il me reçut très-bien, et voulut
m'avancer de l'argent que je refusai. J'avais de quoi manger
en travaillant; mais cette diable de peinture qu'il m'avait
mise en tête n'en était pas sortie, et je ne commençais
jamais ma journée sans soupirer en pensant combien
j'aimerais mieux manier le crayon et le pinceau que l'alène.
J'avais fait quelques progrès, car, malgré moi, à mes
heures de loisir, le dimanche, j'avais toujours barbouillé
quelques figures ou copié quelques images dans un vieux
livre qui me venait de ma mère. Le jeune peintre m'encourageait,
et je n'eus pas la force de refuser les leçons
qu'il voulut me donner gratis. Mais il fallait subsister
pendant ce temps-là, et avec quoi? Il connaissait un
homme de lettres qui me donna des manuscrits à copier.
J'avais une belle main, comme on dit, mais je ne
savais pas l'orthographe. On m'essaya, et dans les quatre
ou cinq lignes qu'on me dicta, on ne trouva pas de
fautes. J'avais assez lu de livres pour avoir appris un peu
la langue par routine; mais je ne savais pas les principes,
et je n'osais pas trop le dire, de peur de manquer
d'ouvrage. Je ne fis pourtant pas de fautes dans mes copies,
et ce fut à force d'attention. Cette attention me faisait
perdre beaucoup de temps, et je vis que j'aurais plus
tôt fait d'apprendre la grammaire et de m'exercer tout
seul à faire des thèmes. En effet, la chose marcha vite;
mais, comme je pris beaucoup sur mon sommeil, je
tombai malade. Mon frère me retira dans son grenier, et
travailla pour deux. Le peu d'argent que j'avais gagné
en copiant le manuscrit de l'auteur servit à payer le
pharmacien. Je ne voulus pas faire savoir ma position à
mon jeune peintre. J'avais vu par mes yeux qu'il était
lui-même souvent aux expédients, n'ayant encore ni réputation,
ni fortune. Je savais que son bon coeur le porterait
à me secourir; et comme il l'avait fait déjà malgré
moi, j'aimais mieux mourir sur mon grabat que de l'induire
encore en dépense. Il me crut ingrat, et, trouvant
une occasion favorable pour faire le voyage d'Italie,
objet de tous ses désirs, il partit sans me voir, emportant
de moi une idée qui me fait bien du mal.
Quand je revins à la santé, je vis mon pauvre frère
amaigri, exténué, nos petites épargnes dépensées, et la
boutique fermée pour nous; car, pour me soigner, Jean
avait manqué bien des journées. C'était au mois de juillet
de l'année passée, par une chaleur de tous les diables.
Nous causions tristement de nos petites affaires, moi encore
couché et si faible, que je comprenais à peine ce
que Jean me disait. Pendant ce temps-là, nous entendions
tirer le canon, et nous ne songions pas même à demander
pourquoi. Mais la porte s'ouvre, et deux de nos camarades
de la boutique, tout échevelés, tout exaltés,
viennent nous chercher pour vaincre ou périr, c'était leur
manière de dire. Je demande de quoi il s'agit.
«De renverser la royauté et d'établir la république,»
me disent-ils. Je saute à bas de mon lit: en deux secondes,
je passe un mauvais pantalon et une blouse en
guenilles, qui me servait de robe de chambre. Jean me
suit. «Mieux vaut mourir d'un coup de fusil que de
faim,» disait-il. Nous voilà partis.
Nous arrivons à la porte d'un armurier, où des jeunes
gens comme nous distribuaient des fusils à qui en voulait.
Nous en prenons chacun un, et nous nous postons
derrière une barricade. Au premier feu de la troupe, mon
pauvre Jean tombe roide mort à côté de moi. Alors je
perds la raison, je deviens furieux. Ah! je ne me serais
jamais cru capable de répandre tant de sang. Je m'y suis
baigné pendant trois jours jusqu'à la ceinture, je puis
dire; car j'en étais couvert, et non pas seulement de
celui des autres, mais du mien qui coulait par plusieurs
blessures; mais je ne sentais rien. Enfin, le 2 août, je
me suis trouvé à l'hôpital, sans savoir comment j'y étais
venu. Quand j'en suis sorti, j'étais plus misérable que jamais,
et j'avais le coeur navré; mon frère Jean n'était plus
avec moi, et la royauté était rétablie.
J'étais trop faible pour travailler, et puis ces journées
de juillet m'avaient laissé dans la tête je ne sais quelle
fièvre. Il me semblait que la colère et le désespoir pouvaient
faire de moi un artiste; je rêvais des tableaux
effrayants; je barbouillais les murs de figures que je
m'imaginais dignes de Michel-Ange. Je lisais les Iambes
de Barbier, et je les façonnais dans ma tête en images
vivantes. Je rêvais, j'étais oisif, je mourais de faim, et
ne m'en apercevais pas. Cela ne pouvait pas durer bien
longtemps, mais cela dura quelques jours avec tant de
force, que je n'avais souci de rien autour de moi. Il me
semblait que j'étais contenu tout entier dans ma tête, que
je n'avais plus ni jambes, ni bras, ni estomac, ni mémoire,
ni conscience, ni parents, ni amis. J'allais devant
moi par les rues, sans savoir où je voulais aller. J'étais
toujours ramené, sans savoir comment, au tour des tombes
de Juillet. Je ne savais pas si mon pauvre frère était enterré
là, mais je me figurais que lui ou les autres martyrs,
c'était la même chose, et que, presser cette terre de
mes genoux, c'était rendre hommage à la cendre de mon
frère. J'étais dans un état d'exaltation qui me faisait sans
cesse parler tout haut et tout seul. Je n'ai conservé aucun
souvenir de mes longs discours; il me semble que le plus
souvent je parlais en vers. Cela devait être mauvais et
bien ridicule, et les passants devaient me prendre pour
un fou. Mais moi, je ne voyais personne, et je ne m'entendais
moi-même que par instants. Alors je m'efforçais
de me taire, mais je ne le pouvais pas. Ma figure était
baignée de sueur et de larmes, et ce qu'il y a de plus
étrange, c'est que cet état de désespoir n'était pas sans
quelque douceur. J'errais toute la nuit, ou je restais
assis sur quelque borne, au clair de la lune, en proie à
des rêves sans fin et sans suite, comme ceux qu'on fait
dans le sommeil. Et pourtant je ne dormais pas, car je
marchais, et je voyais sur les murs ou sur le pavé mon
ombre marcher et gesticuler à côté de moi. Je ne comprends
pas comment je ne fus pas une seule fois ramassé
par la garde.
Je rencontrai enfin un étudiant que j'avais vu quelquefois
dans l'atelier de mon jeune peintre. Il ne fut pas
fier, quoique j'eusse l'air d'un mendiant, et il m'accosta
le premier. Je n'y mis pas de discrétion, je ne savais
pas si j'étais bien ou mal mis. J'avais bien autre chose
dans la cervelle, et je marchai à côté de lui sur les
quais, lui parlant peinture; car c'était mon idée fixe. Il
parut s'intéresser à ce que je lui disais. Peut-être aussi
n'était-il pas fâché de se montrer avec un des bras-nus
des glorieuses journées, et de faire croire par là aux badauds
qu'il s'était battu. À cette époque-là, les jeunes
gens de la bourgeoisie tiraient une grande vanité de pouvoir
montrer un sabre de gendarme qu'ils avaient acheté
à quelque voyou après la fête, ou une égratignure qu'ils
s'étaient faite en se mettant à la fenêtre précipitamment,
pour regarder. Celui-là me parut un peu de la trempe
des vantards: il prétendait m'avoir vu et parlé à telle et
telle barricade, où je ne me souvenais nullement de l'avoir
rencontré. Enfin, il me proposa de déjeuner avec
lui, et j'acceptai sans fierté; car il y avait je ne sais
combien de jours que je n'avais rien pris, et ma cervelle
commençait à déménager sérieusement. Après le déjeuner,
il s'en allait visiter le cabinet de M. Dusommerard,
à l'ancien hôtel de Cluny; il me proposa de l'accompagner,
et je le suivis machinalement.
La vue de toutes les merveilles d'art et de rareté entassées
dans cette collection me passionna tellement que
j'oubliai tous mes chagrins en un instant. Il y avait dans
un coin plusieurs élèves en peinture qui copiaient des
émaux pour la collection gravée que fait faire à ses frais
M. Dusommerard. Je jetai les yeux sur leur travail; il me
sembla que j'en pourrais bien faire autant, et même que
je verrais plus juste que quelques-uns d'entre eux. Dans
ce moment, M. Dusommerard rentra, et fut salué par
mon introducteur l'étudiant, qui le connaissait un peu.
Ils se tinrent quelques minutes à distance de moi, et je
vis bien à leurs regards que j'étais l'objet de leur explication.
Comme le déjeuner m'avait rendu un peu de sang-froid,
je commençais à comprendre que ma mauvaise
tenue était choquante, et que l'antiquaire aurait bien pu
me prendre pour un voleur, si l'autre ne lui eût répondu
de moi. M. Dusommerard est très-bon; il n'aime pas les
faiseurs d'embarras, mais il oblige volontiers les pauvres
diables qui lui montrent du zèle et du désintéressement.
Il s'approcha de moi, m'interrogea; et voyant
mon désir de travailler pour lui, et prenant aussi sans
doute en considération le besoin que j'en avais, il me
remit aussitôt quelque argent pour acheter des crayons,
à ce qu'il disait, mais en effet pour me mettre en état
de pourvoir aux premières nécessités. Il me désigna les
objets que j'aurais à copier. Dès le lendemain, j'étais habillé
proprement et installé à la place où je devais travailler.
Je fis de mon mieux, et si vite que M. Dusommerard
fut content et m'employa encore. J'ai eu beaucoup
à m'en louer, et c'est grâce à lui que j'ai vécu jusqu'à ce
jour; car non-seulement il m'a fait faire beaucoup de copies
d'objets d'art, mais encore il m'a donné des recommandations
moyennant lesquelles je suis entré dans plusieurs
boutiques de joaillier pour peindre des fleurs et
des oiseaux pour bijoux d'émail, et des têtes pour imitation
de camées.
Grâce à ces expédients, j'ai pu suivre ma vocation et
entrer dans les ateliers de M. Delacroix, pour qui je me
suis senti de l'admiration et de l'inclination à la première
vue. Je ne suis pas demandeur, et jamais je n'aurais
songé à ce qu'il m'a accordé de lui-même. La première
fois que j'allai lui dire que je désirais participer à
ses leçons, je crus devoir en même temps lui porter quelques
croquis. Il les regarda, et me dit:—Ce n'est vraiment
pas mal. On m'avait prévenu qu'il n'était pas causeur,
et que, s'il me disait cela, je devais me tenir pour
bien content. Aussi, je le fus, et je m'en allais, lorsqu'il
me rappela pour me demander si j'avais de quoi payer
l'atelier. Je répondis que oui en rougissant jusqu'au blanc
des yeux. Mais soit qu'il devinât que ce ne serait pas
sans peine, soit que quelqu'un lui eût parlé de moi, il
ajouta: «C'est bien, vous paierez au massier.»
Cela voulait dire, comme je le sus bientôt, que je
mettrais seulement à la masse l'argent qui sert à payer
le loyer de la salle et les modèles, mais que le maître ne
recevrait rien pour lui, et que j'aurais ses leçons gratis.
Aussi, je porte ce maître-là dans mon coeur, voyez-vous!
Voilà bientôt six mois que cela dure, et je me trouverais
bien heureux si cela pouvait durer toujours. Mais
cela ne se peut plus; il faut que ma position change, et
qu'au lieu de marcher patiemment dans la plus belle carrière,
je me mette à courir au plus vite dans n'importe
laquelle.
Ici le Masaccio se troubla visiblement; il ne raconta
plus dans l'abondance et la naïveté de ses pensées. Il
chercha des prétextes, et il n'en trouva aucun de plausible
pour motiver l'irrésolution où il était tombé. Il me
montra une lettre de sa soeur Louison, qui contenait de
fraîches nouvelles de la tante Henriette. Cette bonne
vieille parente était devenue tout à fait infirme, et ne servait
plus que de porte-respect à ses deux nièces, qui travaillaient
à la journée pour la faire vivre. Les médecins
la condamnaient, et on ne pouvait espérer de la conserver
au delà de trois ou quatre mois.
«Quand nous l'aurons perdue, disait Paul Arsène,
que deviendront mes soeurs? Resteront-elles seules dans
une petite ville où elles n'ont point d'autres parents que
la tante Henriette, exposées à tous les dangers qui entourent
deux jolies filles abandonnées? D'ailleurs mon
père ne le souffrirait pas; et il ne serait pas de son devoir
de le souffrir; et alors leur sort serait pire; car non-seulement
elles seraient exposées aux mauvais traitements
de la belle-mère, mais encore elles auraient sous
les yeux les mauvais exemples de cette femme, qui n'est
pas seulement méchante. Le seul parti que j'aie à
prendre est donc ou d'aller rejoindre mes soeurs en province
et de m'y établir comme ouvrier, pour ne les plus
quitter, ou de les faire venir ici, et de les y soutenir jusqu'à
ce qu'elles puissent, par leur travail, se soutenir
elles-mêmes.
—Tout cela est fort juste et fort bien pensé, lui dis-je;
mais si vos soeurs sont fortes et laborieuses comme vous
le dites, elles ne seront pas longtemps à votre charge. Je
ne vois donc pas que vous soyez forcé de vous créer un
état qui donne des appointements fixes aussi considérables
que vous le disiez l'autre jour. Il ne s'agit que de
trouver l'argent nécessaire pour faire venir Louison et
Suzanne, et pour les aider un peu dans les commencements.
Eh bien, vous avez des amis qui pourront vous
avancer cette somme sans se gêner, et moi-même...
—Merci, Monsieur, dit Arsène... Mais je ne veux
pas... On sait quand on emprunte, on ne sait pas quand
on rendra. Je dois déjà trop aux bontés d'autrui, et les
temps sont durs pour tout le monde, je le sais; pourquoi
ferais-je peser sur les autres des privations que je peux
supporter? J'aime la peinture, je suis forcé de l'abandonner,
tant pis pour moi. Si vous faites un sacrifice
pour que je continue à peindre, vous vous trouverez
peut-être empêché le lendemain d'en faire un pour un
homme plus malheureux que moi; car enfin, pourvu
qu'on vive honnêtement, qu'importe qu'on soit artiste ou
manoeuvre? Il ne faut pas être délicat pour soi-même. Il
y a tant de grands artistes qui se plaignent, à ce qu'on
dit: il faut bien qu'il y ait de pauvres savetiers qui ne
disent rien.»
Tout ce que je pus lui dire fut inutile; il demeura inébranlable.
Il lui fallait gagner mille francs par an et entrer
en fonctions, fût-ce en service comme laquais, le
plus tôt possible. Il ne s'agissait plus pour lui que de
trouver sa nouvelle condition.
«Mais si je me chargeais, lui dis-je, de vous donner
plus d'ouvrage à domicile que vous n'en avez, soit en vous
faisant copier encore des manuscrits, soit en vous donnant
des dessins à faire, persisteriez-vous à quitter la
peinture?
—Si cela se pouvait! dit-il ébranlé un instant; mais,
ajouta-t-il, cela vous donnera de la peine et cela ne sera
jamais fixe.
—Laissez-moi toujours essayer, repris-je. Il me serra
encore la main et partit, emportant sa résolution et son
secret.»
V.
Horace me fréquentait de plus en plus. Il me témoignait
une sympathie à laquelle j'étais sensible, quoique
Eugénie ne la partageât point. Il lui arriva plusieurs fois
de rencontrer chez moi le petit Masaccio, et malgré le
bien que je lui disais de ce jeune homme, loin de partager
la bonne opinion que j'en avais, il éprouvait pour lui
une antipathie insurmontable. Cependant il le traitait
avec plus d'égards depuis qu'il l'avait vu essayer le portrait
d'Eugénie, et que l'esquisse était si bien venue,
avec une ressemblance si noble et un dessin si large,
qu'Horace, engoué de toute supériorité intellectuelle, ne
pouvait s'empêcher de lui montrer une sorte de déférence.
Mais il n'en était que plus indigné de cette inexplicable
absence d'ambition noble qui contrastait avec
l'exubérance de la sienne propre. Il s'emportait en véhémentes
déclamations à cet égard, et Paul Arsène, l'écoutant
avec un sourire contenu au bord des lèvres, se
contentait, pour toute réponse, de dire en se tournant
vers moi:—Monsieur, votre ami parle bien!
Du reste, Paul ne manifestait ni bonne ni mauvaise
disposition à son égard. Il était de ces gens qui marchent
si droit à leur but que jamais ils ne s'arrêtent aux distractions
du chemin. Il ne disait rien d'inutile; il ne se
prononçait presque sur rien, alléguant toujours son ignorance,
soit qu'elle fût réelle, soit qu'elle lui servît de
prétexte souverain pour couper court à toute discussion.
Toujours renfermé en lui-même, il ne faisait acte de volonté
que pour calmer les autres sans pédantisme, ou les
obliger sans ostentation; et, en attendant qu'il prit le
parti qu'il roulait dans sa tête, il étudiait le modèle, apprenait
l'anatomie, et faisait des dessins pour porcelaine
avec autant de soin et de zèle que s'il n'eût pas songé à
changer de carrière. Ce calme dans le présent avec cette
agitation pour l'avenir me frappait d'admiration. C'est
un des assemblages de facultés les plus rares qui soient
dans l'homme; la jeunesse surtout est portée à s'endormir
dans le présent sans souci du lendemain ou à dévorer
le présent dans l'attente fiévreuse de l'avenir.
Horace semblait l'antipode volontaire et raisonné de
ce caractère. Peu de jours m'avaient suffi pour me convaincre
qu'il ne travaillait pas, quoiqu'il prétendît réparer
en quelques heures de veille toute l'oisiveté de la
semaine. Il n'en était rien. Il n'avait pas été trois fois
dans sa vie au cours de droit; il n'avait peut-être pas
ouvert plus souvent ses livres; et un jour que j'examinais
les rayons de sa chambre, je n'y trouvai que des romans
et des poèmes. Il m'avoua que tous ses livres de
droit étaient vendus.
Cet aveu en entraîna d'autres. Je craignais que ce besoin
d'argent ne fût l'effet d'une conduite légère; il se
justifia en me disant que ses parents n'avaient aucune
fortune; et sans me faire connaître le chiffre du revenu
qui lui était assigné, il m'assura que sa bonne mère était
dans une étrange illusion en se persuadant qu'elle lui envoyait
de quoi vivre à Paris.
Je n'osai pousser plus loin mon interrogatoire; mais je
jetai un regard involontaire sur la garde-robe élégante et
bien fournie de mon jeune ami: rien ne lui manquait. Il
avait plus de gilets, d'habits et de redingotes que moi,
qui jouissais d'un héritage de trois mille francs de rente.
Je devinai que le tailleur allait devenir le fléau de cette
existence. Je ne me trompai pas. Bientôt je vis le front
d'Horace se rembrunir, sa parole devenir plus brève et
son ton plus incisif. Il fallut plus d'une semaine pour le
confesser. Enfin je lui arrachai l'aveu de son outrage.
L'infâme tailleur s'était permis de présenter son mémoire,
le misérable! Cela méritait des coups de canne!
C'était encore un signe de vertu, que cette indignation;
Horace n'en était pas au degré de perversité où l'on se
vante de ses dettes et où l'on rit avec fanfaronnade à
l'idée de voir fondre sur les parents une note de trois ou
quatre mille francs. D'ailleurs il chérissait profondément
sa mère, quoiqu'il la trouvât bornée; et il était bon fils,
quoiqu'il eût un secret mépris pour la dépendance où son
père vivait à l'égard du gouvernement.
Le voyant tomber dans le spleen, je pris sur moi de
dire au tailleur quelques mots qui le tranquillisèrent; et
Horace, après m'avoir remercié avec une effusion extrême,
reprit sa sérénité.
Mais son oisiveté ne cessa point, et son genre de vie,
pour n'avoir rien que de très-ordinaire dans un étudiant,
me causa une vive surprise à mesure que je l'observai.
Comment concilier, en effet, cette ardeur de gloire, ces
rêves d'activité parlementaire et de supériorité politique,
avec la profonde inertie et la voluptueuse nonchalance
d'un tel tempérament? Il semblait que la vie dût être
cent fois trop longue pour le peu qu'il y avait à faire. Il
perdait les heures, les jours et les semaines avec une insouciance
vraiment royale. C'était quelque chose de beau
à contempler que ce fier jeune homme aux formes athlétiques,
à la noire chevelure, à l'oeil de flamme, couché
du matin à la nuit sur le divan de mon balcon, fumant
une énorme pipe (dont il fallait tous les jours renouveler
la cheminée, parce qu'en la secouant sur les barreaux du
balcon, il ne manquait jamais de laisser tomber la capsule
dans la rue), et feuilletant un roman de Balzac ou
un volume de Lamartine, sans daigner lire un chapitre
ou un morceau entier. Je le laissais là pour aller travailler,
et quand je revenais de la clinique ou de l'hôpital,
je le retrouvais assoupi à la même place, presque
dans la même attitude. Eugénie, condamnée à subir cet
étrange tête-à-tête, et n'ayant, du reste, pas à s'en
plaindre personnellement, car il daignait à peine lui
adresser la parole (la regardant plutôt comme un meuble
que comme une personne), était indignée de cette paresse
princière. Quant à moi, je commençais à sourire
lorsque, les yeux encore appesantis par une rêverie somnolente,
il reprenait ses divagations sur la gloire, la politique
et la puissance.
Cependant aucune idée de blâme ou de mépris ne se
mêlait à mon doute. Tous les jours, après le dîner, nous
nous retrouvions, Horace et moi, au Luxembourg, au
café ou à l'Odéon, au milieu d'un groupe assez nombreux,
composé de ses amis et des miens; et là, Horace
pérorait avec une rare facilité. Sur toutes choses il était
le plus compétent, quoiqu'il fût le plus jeune; en toutes
choses il était le plus hardi, le plus passionné, le plus
avancé, comme on disait alors, et comme on dit, je crois,
encore aujourd'hui. Ceux, même qui ne l'aimaient pas,
parmi les auditeurs, étaient forcés de l'écouter avec intérêt,
et ses contradicteurs montraient en général plus de
méfiance et de dépit que de justice et de bonne foi.
C'est que là Horace reprenait tous ses avantages: la discussion
était sur son terrain; et chacun s'avouait intérieurement
que s'il n'était pas logicien infaillible, du
moins il était orateur fécond, ingénieux et chaud. Ceux
qui ne le connaissaient pas croyaient le renverser, en
disant que c'était un homme sans fond, sans idées, qui
avait travaillé immensément, et dont toute l'inspiration
n'était que le résultat d'une culture minutieuse. Pour moi,
qui savais si bien le contraire, j'admirais cette puissance
d'intuition, à laquelle il suffisait d'effleurer chaque chose
en passant pour se l'assimiler et pour lui donner aussitôt
toutes sortes de développements au hasard de l'improvisation.
C'était à coup sûr une organisation privilégiée,
et pour laquelle on pouvait augurer qu'il serait toujours
temps, puisqu'il lui en fallait si peu pour s'élargir et se
compléter.
Sa présence assidue chez moi était un véritable supplice
pour Eugénie. Comme toutes les personnes actives
et laborieuses, elle ne pouvait avoir sous les yeux le
spectacle de l'inaction prolongée, sans en ressentir un
malaise qui allait jusqu'à la souffrance. N'étant point
actif par nature, mais par raisonnement et par nécessité,
je n'étais pas aussi révolté qu'elle, d'ailleurs je me plaisais
à croire que cette inaction n'était qu'une défaillance
passagère dans les forces de mon jeune ami, et que bientôt
il donnerait, comme il disait, un vigoureux coup de
collier.
Cependant, comme deux mois s'étaient écoulés sans
apporter aucun changement à cette manière d'être, je crus
de mon devoir d'aider au réveil du lion, et j'essayai un
jour d'aborder ce point délicat, en prenant le café avec
lui chez Poisson. La journée avait été orageuse, et de
grands éclairs faisaient par intervalles bleuir la verdure
des marronniers du Luxembourg. La dame du comptoir
était belle comme à l'ordinaire, plus qu'à l'ordinaire
peut-être; car la mélancolie habituelle de son visage était
en harmonie avec cette soirée pleine de langueur et à
demi sombre.
Horace tourna plusieurs fois les yeux vers elle, et revenant
à moi: «Je m'étonne, dit-il, qu'étant capable
de devenir sérieusement épris d'une femme de ce genre,
vous n'ayez pas conçu une grande passion pour celle-ci.
—Elle est admirablement belle, lui dis-je; mais j'ai
le bonheur de ne jamais avoir d'yeux que pour la femme
que j'aime. Ce serait plutôt à moi de m'étonner qu'ayant
le coeur libre, vous ne fassiez pas plus d'attention à ce
profil grec et à cette taille de nymphe.
—La Polymnie du Musée est aussi belle, répondit Horace,
et elle a sur celle-ci de grands avantages. D'abord
elle ne parle point, et celle-ci me désenchanterait au
premier mot qu'elle dirait. Ensuite celle du Musée n'est
pas limonadière, et en troisième lieu elle ne s'appelle
point madame Poisson. Madame Poisson! quel nom!
Vous allez encore blâmer mon aristocratie; mais vous-même,
voyons! Si Eugénie s'était appelée Margot ou Javotte...
—J'eusse mieux aimé Margot ou Javotte que Léocadie
ou Phoedora. Mais laissez-moi vous dire, Horace,
que vous me cachez quelque chose: vous devenez amoureux?»
Horace me tendit son bras.—Docteur, s'écria-t-il en
riant, tâtez-moi le pouls; ce doit être un amour bien
tranquille, puisque je ne m'en aperçois pas. Mais pourquoi
avez-vous une pareille idée?
—Parce que vous ne songez plus à la politique.
—Où prenez-vous cela? J'y pense plus que jamais.
Mais ne peut-on marcher à son but que par une seule
voie?
—Oh! quelle est donc celle où vous marchez? Je sais
bien que pour moi le far-niente serait le bonheur. Mais
pour qui aime la gloire...
—La gloire vient trouver ceux qui l'aiment d'un
amour délicat et fier. Pour moi, plus je réfléchis, plus je
trouve l'étude du droit inconciliable avec mon organisation,
et le métier d'avocat impossible à un homme qui
se respecte; j'y ai renoncé.
—En vérité! m'écriai-je, étourdi de l'aisance avec
laquelle il m'annonçait une pareille détermination; et
qu'allez-vous faire?
—Je ne sais, répondit-il d'un air indifférent; peut-être
de la littérature. C'est une voie encore plus large
que l'autre; ou plutôt c'est un champ ouvert où l'on peut
entrer de toutes parts. Cela convient à mon impatience
et à ma paresse. Il ne faut qu'un jour pour se placer au
premier rang; et quand l'heure d'une grande révolution
sonnera, les partis sauront reconnaître dans les lettres,
bien mieux que dans le barreau, les hommes qui leur
conviennent.
Comme il disait cela, je vis passer dans une glace une
figure qui me sembla être celle de Paul Arsène; mais,
avant que j'eusse tourné la tête pour m'en assurer, elle
avait disparu.
«Et quelle partie choisirez-vous dans les lettres?
demandai-je à Horace.
—Vers, prose, roman, théâtre, critique, polémique,
satire, poëme, tonte forme est à mon choix, et je n'en
vois aucune qui m'effraie.
—La forme bien, mais le fond?
—Le fond déborde, répondit-il, et la forme est le vase
étroit où il faut que j'apprenne à contenir mes pensées.
Soyez tranquille, vous verrez bientôt que cette oisiveté
qui vous effraie couve quelque chose. Il y a des abîmes
sous l'eau qui dort.»
Mes yeux, flottant autour de moi, retrouvèrent de nouveau
Paul Arsène, mais dans un accoutrement inusité.
Cette fois sa chemise était fort blanche et assez fine; il
avait un tablier blanc, et pour achever la métamorphose,
il portait un plateau chargé de tasses.
«Voilà, dit Horace, dont les yeux avaient suivi la
même direction que les miens, un garçon qui ressemble
effroyablement au Masaccio.»
Quoiqu'il eût coupé ses longs cheveux et sa petite
moustache, il m'était impossible de douter un seul instant
que ce ne fût le Masaccio en personne. J'eus le
coeur affreusement serré, et faisant un effort, j'appelai le
garçon.
«Voilà, Monsieur! répondit-il aussitôt; et, s'approchant
de nous, sans le moindre embarras, il nous présenta
le café.
—Est-il possible! Arsène? m'écriai-je, vous avez pris
ce parti?
—En attendant un meilleur, répondit-il, et je ne m'en
trouve pas mal.
—Mais vous n'avez pas un instant de reste pour dessiner?
lui dis-je, sachant bien que c'était la seule objection
qui pût l'émouvoir.
—Oh! cela, c'est un malheur! mais il est pour moi
seul, répondit-il, ne me blâmez pas, Monsieur. Ma
vieille tante va mourir, et je veux faire venir mes soeurs
ici; car, voyez-vous quand on a tâté de ce coquin de
Paris, on ne peut plus s'en aller vivre en province. Au
moins ici j'entendrai parler d'art et de peinture aux jeunes
étudiants: et quand M. Delacroix exposera, je pourrai
m'esquiver une heure pour aller voir ses tableaux.
Est-ce que les arts vont périr, parce que Paul Arsène ne
s'en mêle plus? Il n'y a que les tasses qui menacent ruine,
ajouta-t-il gaiement en retenant le plateau prêt à s'échapper
de sa main encore mal exercée.
—Ah çà, Paul Arsène, s'écria Horace en éclatant de
rire, ou vous êtes un petit juif, ou vous êtes amoureux
de la belle madame Poisson.»
Il fit cette plaisanterie, selon son habitude, avec si peu
de précaution, que madame Poisson, dont le comptoir
était tout près, l'entendit et rougit jusqu'au blanc des
yeux. Arsène devint pâle comme la mort et laissa tomber
le plateau; M. Poisson accourut au bruit, donna un
coup d'oeil au dégât, et alla au comptoir pour l'inscrire
sur un livre ad hoc. Le garçon de café est comptable de
tout ce qu'il casse. En voyant l'émotion de sa femme,
nous entendîmes le patron lui dire d'une voix âpre:
«Vous serez donc toujours prête à sauter et à crier
au moindre bruit? Vous avez des nerfs de marquise.»
Madame Poisson détourna la tête et ferma les yeux,
comme si la vue de cet homme lui eût fait horreur. Ce
petit drame bourgeois se passa en trois minutes; Horace
n'y fit aucune attention: mais ce fut pour moi comme
un trait de lumière.
L'intérêt sincère et profond que j'éprouvais pour le
pauvre Masaccio me fit souvent retourner au café Poisson;
j'y fis de plus longues séances que de coutume, et
j'y augmentai ma consommation, afin de ne point éveiller
désagréablement l'attention du maître, qui me parut
jaloux et brutal. Mais quoique je m'attendisse sans cesse
à voir quelque tragédie dans ce ménage, il se passa plus
d'un mois sans que l'ordre farouche en parût troublé.
Arsène remplissait ses fonctions de valet avec une rare
activité, une propreté irréprochable, une politesse
brusque et de bonne humeur qui captivait la bienveillance
de tous les habitués et jusqu'à celle de son rude
patron.
«Vous le connaissez?» me dit un jour ce dernier en
voyant que je causais un pou longuement avec lui. Arsène
m'avait recommandé de ne point dire qu'il eût été
artiste, de peur de lui aliéner la confiance de son maître,
et conformément aux instructions qu'il m'avait données,
je répondis que je l'avais vu dans un restaurant où on le
regrettait beaucoup.
«C'est un excellent sujet, me répondit M. Poisson;
parfaitement honnête, point causeur, point donneur,
point ivrogne, toujours content, toujours prêt. Mon établissement
a beaucoup gagné depuis qu'il est à mon service.
Eh bien! Monsieur, croiriez-vous que madame
Poisson, qui est d'une faiblesse et d'une indulgence absurdes
avec tous ces gaillards-là, ne peut point souffrir
ce pauvre Arsène!»
M. Poisson parlait ainsi debout, à deux pas de ma
petite table, le coude appuyé, majestueusement sur la
face externe du comptoir d'acajou où sa femme trônait
d'un air aussi ennuyé qu'une reine véritable. La figure
ronde et rouge de l'époux sortait de sa chemise à jabot
de mousseline, et son embonpoint débordait un pantalon
de nankin ridiculement tendu sur ses flancs énormes.
Horace l'avait surnommé le Minautore. Tandis qu'il déplorait
l'injustice de sa femme envers ce pauvre Arsène,
je crus voir un imperceptible sourire errer sur les lèvres
de celle-ci. Mais elle ne répliqua pas un mot, et lorsque
je voulus continuer cette conversation avec elle, elle me
répondit avec un calme imperturbable:
«Que voulez-vous, Monsieur? ces gens-là (elle parlait
des garçons de café en général) sont les fléaux de
notre existence. Ils ont des manières si brutales et si
peu d'attachement! Ils tiennent à la maison et jamais
aux personnes. Mon chat vaut mieux, il tient à la maison
et à moi.»
Et parlant ainsi d'une voix douce et traînante, elle
passait sa main de neige sur le dos tigré du magnifique
angora qui se jouait adroitement parmi les porcelaines
du comptoir.
Madame Poisson ne manquait point d'esprit, et je remarquai
souvent qu'elle lisait de bons romans. Comme
habitué, j'avais acheté le droit de causer avec elle, et
mes manières respectueuses inspiraient toute confiance
au mari. Je lui fis souvent compliment du choix de ses
lectures; jamais je n'avais vu entre ses mains un seul de
ces ouvrages grivois et à demi obscènes qui font les délires
de la petite bourgeoisie. Un jour qu'elle terminait
Manon Lescaut, je vis une larme rouler sur sa joue, et
je l'abordai en lui disant que c'était le plus beau roman
du coeur qui eût été fait en France. Elle s'écria:
«Oh! oui, Monsieur! c'est du moins le plus beau que
j'aie lu. Ah! perfide Manon! sublime Desgrieux!» et ses
regards tombèrent sur Arsène, qui déposait de l'argent
dans sa sébile; fut-ce par hasard ou par entraînement?
il était difficile de prononcer. Jamais Arsène ne levait
les yeux sur elle; il circulait des tables au comptoir avec
une tranquillité qui aurait dérouté le plus fin observateur.
More History
|