|


 Explorers, Scientists &
Inventors
Explorers, Scientists &
Inventors
 Musicians, Painters &
Artists
Musicians, Painters &
Artists
 Poets, Writers &
Philosophers
Poets, Writers &
Philosophers
 Native Americans & The Wild
West
Native Americans & The Wild
West
 First Ladies
First Ladies
 Popes
Popes
 Troublemakers
Troublemakers
 Historians
Historians
 Archaeologists
Archaeologists
 Royal
Families
Royal
Families
 Tribes & Peoples
Tribes & Peoples
Assassinations in History
Who
got slain, almost slain, when, how,
why, and by whom?
 Go to the
Assassination Archive
Go to the
Assassination Archive

Online History Dictionary A - Z



Voyages in History
When did what
vessel arrive with whom onboard and where
did it sink if it didn't?
 Go to the
Passage-Chart
Go to the
Passage-Chart


The Divine Almanac
Who all roamed the heavens in
olden times? The Who's Who of
ancient gods.
 Check out
the Divine Almanac
Check out
the Divine Almanac

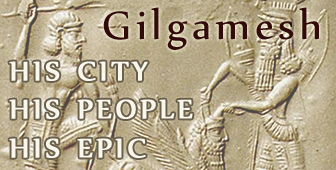
|
|
George Sand - Horace: Chapter 20-23
Notice
Chapter 1 - 5
Chapter 6 - 12
Chapter 13 - 19
Chapter 20 - 23
Chapter 24 - 26
Chapter 27 - 30
Chapter 31 - 33
|
|
XX.
A cette époque, l'association politique la plus importante
et la mieux organisée était celle des Amis du
peuple. Plusieurs des chefs qui la représentaient avaient
joué déjà un rôle dans la charbonnerie; ceux-là et
d'autres plus jeunes en ont joué un plus brillant depuis
1830. Parmi ces hommes, qui ont surgi et grandi durant
cette période de dix années, et qui ont déjà des noms
historiques, la société des Amis de peuple comptait
Trélat, Guinard, Raspail, etc.; mais celui qui exerçait
le plus de prestige sur les jeunes gens des Écoles tels
que Laravinière, et sur les jeunes républicains populaires
tels que Paul Arsène, c'était Godefroy Cavaignac.
Presque seul, il n'avait pas cette suffisance puérile qui
perce chez la plupart des hommes remarquables de
notre temps, et qui fait chez eux de l'affectation une
seconde nature. Sa grande taille, sa noble figure,
quelque chose de chevaleresque répandu dans ses manières
et dans son langage, sa parole heureuse et
franche, son activité, son courage et son dévouement,
tout cela eût suffi pour enflammer la tête du belliqueux
Jean, et pour échauffer le coeur du généreux Arsène,
quand même Godefroy n'eût pas émis les idées sociales
les plus complètes, les plus logiques, je dirai même les
plus philosophiques qui aient pris une forme à cette
époque dans les sociétés populaires. Ce président, des
Amis du peuple a seul professé dans ces clubs ce qu'on
peut appeler les doctrines; doctrines qui, à beaucoup
d'égards, ne satisfaisaient pas encore le secret instinct
d'Arsène et les vastes aspirations de son âme vers
l'avenir, mais qui, du moins, marquaient un progrès
immense, incontestable, sur le libéralisme de la Restauration.
Suivant Arsène, et suivant le jugement toujours
sévère et méfiant du peuple, les autres républicains
étaient un peu trop occupés de renverser le pouvoir,
et point assez d'asseoir les bases de la république;
lorsqu'ils l'essayaient, c'était plutôt des règlements et
une discipline qu'ils imaginaient, que des lois morales
et une société nouvelle.
|
Cavaignac, tout en faisant cette belle opposition qu'il a si largement et si
fortement développée l'année suivante jusque devant la pâle et menteuse
opposition de la chambre, s'occupait à mûrir des idées, à poser des principes.
Il songeait à l'émancipation du peuple, à l'éducation publique gratuite, au
libre vote de tous les citoyens, à la modification progressive de la propriété,
et il ne renfermait pas, comme certains républicains d'aujourd'hui, ces deux
principes nets et vastes dans l'hypocrite question d'organisation
du travail et de réforme électorale; mots bien élastiques,
si l'on n'y prend garde, et dont le sens est susceptible
de se resserrer autant que de s'étendre. En
1832, on ne craignait pas comme aujourd'hui de passer
pour communiste, ce qui est devenu l'épouvantail de
toutes les opinions de ce temps-ci. Un jury acquitta
Cavaignac, après qu'il eut dit, entre autres choses d'une
admirable hardiesse: «Nous ne contestons pas le droit
de propriété. Seulement nous mettons au-dessus
celui que la société conserve, de le régler suivant le
plus grand avantage commun.» Dans ce même discours,
le plus complet et le plus élevé parmi tous ceux
des procès politiques de l'époque1, Cavaignac dit encore:
«Nous lui contestons (à votre société officielle) le
monopole des droits politiques; et ne croyez pas que
ce soit seulement pour le revendiquer en faveur des
capacités. Selon nous, quiconque est utile est capable.
Tout service entraîne un droit.»
Arsène assistait à ce procès; il écouta avec une émotion
contenue; et, tandis que la plupart des auditeurs,
subjugués par le magnétisme qu'exerce toujours sur les
masses le débit et l'aspect de l'orateur, éclataient en
applaudissements passionnés, il garda un profond silence;
mais il était le plus pénétré de tous, et il n'entendit
pas, ce jour-là, les autres plaidoiries2. Il s'absorba
entièrement dans les idées que Godefroy avait
éveillées en lui, et il se retira plein de celle-ci, qu'il
vint me répéter mot à mot:
«La religion, comme nous l'entendons, nous, c'est
le droit sacré de l'humanité. Il ne s'agit plus de présenter
au crime un épouvantail après la mort, au
malheureux une consolation de l'autre côté du tombeau.
Il faut fonder en ce monde la morale et le bien-être,
c'est-à-dire l'égalité. Il faut que le titre d'homme
vaille à tous ceux qui le portent un même respect religieux
pour leurs droits, une pieuse sympathie pour
leurs besoins. Notre religion, à nous, c'est celle qui
changera d'affreuses prisons en hospices pénitentiaires,
et qui, au nom de l'inviolabilité humaine, abolira la
peine de mort... Nous n'adoptons plus une foi qui met
tout au ciel, qui réduit l'égalité devant Dieu, à cette
égalité posthume que le paganisme proclamait aussi
bien que le christianisme; etc.»
«Théophile, s'écria Arsène en mettant sa main dans
la mienne, voilà de grandes paroles et une idée neuve,
du moins pour moi. Elle me donne tant à réfléchir, que
tout, mon passé, c'est-à-dire tout ce que j'ai cru jusqu'à
ce jour, se bouleverse à mes propres yeux.
—Ce n'est pas une idée qui soit absolument propre
à l'orateur que vous venez d'entendre, lui répondis-je:
c'est une idée qui appartient au siècle, et qui a été déjà
émise sous plusieurs formes. On pourrait même dire
que c'est l'idée qui a dominé nos révolutions depuis
cent ans, et l'humanité tout entière depuis qu'elle
existe, par une instinctive révélation de son droit, plus
puissante que les théories religieuses de l'ascétisme et
du renoncement. Mais c'est toujours une chose neuve et
grande que de voir le droit humain, pris à son point de
vue religieux, proclamé par un révolutionnaire. Il y
avait bien assez longtemps que vos républicains oubliaient
de donner à leurs théories la sanction divine qu'elles
doivent avoir. Moi, qui suis légitimiste, ajoutai-je en
souriant...
—Ne parlez pas comme cela, reprit vivement Paul
Arsène, vous n'êtes pas légitimiste dans le sens qu'on
attache à ce mot; vous sentez que la légitimité est dans
le droit du peuple.
—C'est la vérité, Arsène, je le sens profondément;
et quoique mon père fût attaché, de fait et par délicatesse
de conscience, aux hommes du passé, plus il approchait
de la tombe, plus il s'élevait à la conception et
au respect des institutions de l'avenir. Croyez-vous
que Chateaubriand ne se soit pas dit cent fois que
Dieu est au-dessus des rois, dans le même sens que
Cavaignac vous proclamait aujourd'hui le droit de la
société au-dessus de celui des riches?
—A la bonne heure, dit Arsène. Il est donc vrai que
nous avons droit au bonheur en cette vie, que ce n'est
pas un crime de le chercher, et que Dieu même nous en
fait un devoir? Cette idée ne m'avait pas encore frappé.
J'étais partagé entre un sentiment révolutionnaire qui
me rendait presque athée, et des retours vers la dévotion
de mon enfance qui me rendaient compatissant jusqu'à
la faiblesse. Ah! si vous saviez comme j'ai été froidement
cruel aux trois journées au milieu de mon délire!
Je tuais des hommes, et je leur disais: Meurs, toi
qui as fait mourir! Sois tué, toi qui tues! Cela me paraissait
l'exercice d'une justice sauvage; mais je m'y
sentais forcé par une impulsion surnaturelle. Et puis,
quand je fus calmé, quand je m'agenouillai sur les
tombes de juillet, je pensai à Dieu, à ce Dieu de soumission
et d'humilité qu'on m'avait enseigné, et je ne
savais plus où réfugier ma pensée. Je me demandais si
mon frère était damné pour avoir levé la main contre la
tyrannie, et si je le serais pour avoir vengé mon frère et
mes frères les hommes du peuple. Alors j'aimais mieux
ne croire rien; car je ne pouvais comprendre qu'au nom
de Jésus crucifié, il fallût se laisser mettre en croix par
les délégués de ses ministres. Voilà où nous en sommes,
nous autres enfants de l'ignorance: athées ou superstitieux,
et souvent l'un et l'autre à la fois. Mais à quoi
songent donc nos instituteurs, les chefs républicains, de
ne pas nous parler de ce qui est le fond même de notre
être, le mobile de toutes nos actions! Nous prennent-ils
pour des brutes, qu'ils ne nous promettent jamais que
la satisfaction de nos besoins matériels? Croient-ils que
nous n'ayons pas des besoins plus nobles, celui d'une
religion, tout aussi bien qu'ils peuvent l'avoir? Ou bien
est-ce qu'ils ne l'ont pas eux? Est-ce qu'ils seraient plus
grossiers, plus incrédules que nous? Allons, ajouta-t-il,
Godefroy Cavaignac sera mon prêtre, mon prophète;
j'irai lui demander ce qu'il faut croire sur tout cela.
—Il ne pourra que vous dire d'excellentes choses,
cher Arsène, lui répondis-je; mais ne croyez pas, encore
une fois, que le seul foyer des idées nouvelles soit
dans cette opinion. Élevez votre esprit à une conception
plus vaste du temps où nous vivons. Ne vous donnez
pas exclusivement à tel ou tel homme comme à la vérité
incarnée; car les hommes sont mobiles. Quelquefois en
croyant progresser, ils reculent; en croyant s'améliorer,
ils s'égarent. Il y en a même qui perdent leur générosité
avec leur jeunesse, et qui se corrompent étrangement!
Mais attachez-vous à ces mêmes idées dont
vous cherchez la solution. Instruisez-vous en buvant à
différentes sources. Voyez, lisez, comparez, et réfléchissez.
Votre conscience sera le lien logique entre plusieurs
notions contradictoires en apparence. Vous verrez
que les hommes probes ne diffèrent pas tant sur le fond
des choses que sur les mots; qu'entre ceux-là un peu
d'amour-propre jaloux est quelquefois le seul obstacle à
l'unité de croyances; mais qu'entre ceux-là et les
hommes du pouvoir, il y a l'immense abîme qui sépare
la privation de la jouissance, le dévouement de l'égoïsme,
le droit de la force.
—Oui, il faudrait s'instruire, dit Arsène. Hélas! si
j'avais le temps! Mais quand j'ai passé ma journée entière
à faire des chiffres, je n'ai plus la force de lire;
mes yeux se ferment malgré moi, ou bien j'ai la fièvre;
et, au lieu de suivre avec l'esprit ce que je lis avec les
yeux, je poursuis mes propres divagations en tournant
des pages que j'ai remplies moi-même. Il y a longtemps
que j'ai envie d'apprendre ce que c'est que le fouriérisme.
Aujourd'hui, Cavaignac l'a cité, ainsi que la Revue
Encyclopédique et les saint-simoniens. Il a dit de
ces derniers, qu'au milieu de leurs erreurs, ils avaient
soutenu avec dévouement des idées utiles, et développé
le principe d'association. Eugénie, j'irai les entendre
prêcher.»
Eugénie était là sur son terrain; c'était une adepte
assez fervente de la réhabilitation des femmes. Elle
commença à endoctriner son ami le Masaccio, ce qu'elle
n'avait pas fait encore; car elle était de ces esprits délicats
et prudents qui ne risquent pas leur influence à
moins d'une occasion sûre. Elle savait attendre comme
elle savait choisir. Elle ne m'avait pas parlé dix fois de
ses croyances saint-simoniennes; mais elle ne l'avait
jamais fait sans produire sur moi une grande impression.
Je connaissais mieux qu'elle peut-être, par l'examen
et par la lecture, le fort et le faible de cette philosophie;
mais j'admirais toujours avec quelle pureté d'intention
et quelle finesse de tact elle savait éliminer tacitement
des discussions où s'élaborait la doctrine des
adeptes secondaires, tout ce qui révoltait ses instincts
nobles et pudiques, pour conclure souvent à priori, des
secrètes élucubrations des maîtres, ce qui répondait à
sa fierté naturelle, à sa droiture et à son amour de la
justice. Je me disais parfois que cette femme forte et intelligente
appelée par les apôtres à formuler les droits
et les devoirs de la femme, c'eût été Eugénie. Mais,
outre que sa réserve et sa modestie l'eussent empêchée
de monter sur un théâtre où l'on jouait trop souvent la
comédie sociale au lieu du drame humanitaire, les saint-simoniens,
dans la déviation inévitable où leurs principes
se trouvaient alors, l'eussent jugée, ceux-ci trop rigide,
ceux-là trop indépendante. Le moment n'était pas venu.
Le saint-simonisme accomplissait une première phase,
qui devait laisser une lacune avant la seconde. Eugénie
le sentait, et prévoyait qu'il faudrait encore dix ans,
vingt ans d'arrêt peut-être, avant que la marche progressive
du saint-simonisme pût être reprise.
Paul Arsène, frappé de ce qu'elle lui fit entrevoir
dans une première conversation, alla écouter les prédications
saint-simoniennes. Il se lia avec de jeunes apôtres;
et sans avoir précisément le temps de s'instruire,
il se mit au courant de la discussion, et s'y forma un
jugement, des sympathies, des espérances. Ce fut une
rapide et profonde révolution dans la vie morale de cet
enfant du peuple, qui jusque-là n'était pas sans préjugés,
et qui dès lors les perdit ou acquit du moins la force de
les combattre en lui-même. L'amour qu'il nourrissait encore,
faute d'avoir pu l'étouffer (car il y avait fait son
possible), se retrempa à cette source d'examen qu'il
n'avait pas encore abordée, et prit un caractère encore
plus calme et plus noble, un caractère religieux pour
ainsi dire.
En effet, jusque-là Marthe n'avait été pour lui que
l'objet d'une passion tenace, invincible. Il l'avait maudite
cent fois, cette passion qui puisait des forces nouvelles
dans tout ce qui eût dû la détruire; mais comme
elle régnait là sur une grande âme, bien qu'elle y fût
mystérieuse, incompréhensible pour celui-là même qui
la ressentait, elle n'y produisait que des résultats magnanimes,
une générosité sans exemple et sans bornes.
Aussi quels affreux combats cette âme fière et rigide se
livrait ensuite à elle-même! Comme Arsène rougissait
d'être ainsi l'esclave d'un attachement que l'austérité un
peu étroite de son éducation populaire lui apprenait à
réprouver! Lui dont les moeurs étaient si pures, épris à
ce point de l'ex-maîtresse de M. Poisson, de la maîtresse
actuelle d'un autre! Jamais il n'eût voulu profiter de
l'espèce de faiblesse et d'entraînement que cette conduite
de Marthe lui laissait entrevoir, pour arracher, en
secret, à la reconnaissance, à l'amitié exaltée, des faveurs
qu'il aurait voulu devoir seulement à l'amour exclusif
et durable. Mais malgré le peu d'espoir qui lui restait,
il se surprenait toujours à désirer la fin de cet
amour pour Horace, et à caresser le rêve d'un mariage
légal avec Marthe. C'est là que l'attendaient pour le faire
souffrir ses anciens préjugés, le blâme de ses pareils,
l'indignation de sa soeur Louise, l'effroi de sa soeur Suzanne,
la crainte du ridicule, une sorte de mauvaise
honte, toute puissante parfois sur des caractères élevés;
car elle leur est enseignée par l'opinion, comme le respect
de soi-même et des autres. C'est alors qu'Arsène
essayait d'arracher son amour de son sein, comme une
flèche empoisonnée. Mais sa nature évangélique s'y refusait:
il était forcé d'aimer. La haine et le mépris
qu'il appelait à son secours ne voulaient pas entrer
dans ce coeur plein d'indulgence, parce qu'il était plein
de justice.
Durant cet hiver qu'il passa loin de Marthe et qu'il
consacra à étudier du mieux qu'il put la religion, la nature
et la société, sous les nouveaux aspects qui s'ouvraient
devant lui de toutes parts; tour à tour et à la fois
fouriériste, républicain, saint-simonien et chrétien (car
il lisait aussi l'Avenir et vénérait ardemment M. Lamennais),
Arsène, s'il ne put réussir à bâtir une philosophie
de toutes pièces, épura son âme, éleva son esprit, et développa
son grand coeur d'une manière prodigieuse. J'en
étais frappé chaque jour davantage, et, d'une semaine à
l'autre, j'admirais ces progrès rapides. J'avais fini par
découvrir sa retraite; et, affrontant l'accueil revêche de
sa soeur aînée, j'allais quelquefois, le soir, le surprendre
au milieu de ses méditations. Tandis que les deux soeurs
travaillaient en échangeant les idées les plus niaises, lui,
assis au bout de la table, la tête dans ses mains, un livre
ouvert entre ses coudes, et les yeux à demi fermés, étudiait
ou rêvait à la lueur d'une triste lampe dont la clarté
arrivait à peine jusqu'à lui. A voir son teint jaune, ses
yeux fatigués, son attitude morne, on l'eût pris pour un
homme usé par la fatigue et la misère; mais dès qu'il
parlait, son regard reprenait du feu, son front de la sérénité,
et son langage révélait une énergie de mieux en
mieux trempée. Je l'emmenais faire un tour de promenade
sur les quais, et là, tout en fumant nos cigares de
la régie, nous devisions ensemble. Quand nous avions
passé en revue les idées générales, nous en venions à
nos sentiments individuels; et il me disait souvent, à propos
de Marthe: «L'avenir est à moi; le règne d'Horace
ne saurait durer longtemps. Le pauvre enfant ne comprend
pas le bonheur qu'il possède, il n'en jouit pas, il
n'en profitera pas; et vous verrez que Marthe apprendra
ce que c'est qu'un véritable amour, en éprouvant tout
ce qui manque de grandeur et de vérité à celui qu'elle
inspire maintenant. Voyez-vous, mon ami, j'ai remporté
une grande victoire le jour où j'ai compris que ce qu'on
appelle les fautes d'une femme étaient imputables à la
société et non à de mauvais penchants. Les mauvais penchants
sont rares, Dieu merci; ils sont exceptionnels, et Marthe
n'en a que de bons. Si elle a choisi Horace au lieu
de moi, c'est qu'alors je n'étais pas digne d'elle et qu'Horace
lui a semblé plus digne. Incertain et farouche, tout
en m'offrant à elle avec dévouement, je ne savais pas lui
dire ce qu'elle eût aimé à entendre. Le souvenir de ses
malheurs m'inspirait de la pitié seulement; elle le sentait,
et elle voulait du respect. Horace a su lui exprimer
de l'enthousiasme; elle s'y est trompée, mais la faute
n'en est point à elle. Maintenant, je saurais bien lui dire
ce qui doit fermer ses anciennes blessures, rassurer sa
conscience, et lui donner en moi la confiance qu'elle n'a
pas eue. Mon austérité lui a fait peur, elle a craint mes
reproches; elle n'a eu pour moi que cette froide estime
qu'inspire un homme sage et passablement humain. Elle
avait besoin d'un appui, d'un sauveur, d'un initiateur à
une vie nouvelle, toute d'exaltation et de charité. Je le
répète, Horace, avec ses beaux yeux et ses grands mots,
lui est apparu en révélateur de l'amour. Elle l'a suivi.
Mea culpa!»
Je trouvais Arsène injuste envers lui-même, à force de
générosité. Il fallait bien faire, dans l'aveuglement de
Marthe, la part d'une certaine faiblesse et d'une sorte de
vanité qui est, chez les femmes, le résultat d'une mauvaise
éducation et d'une fausse manière de voir. Chez
Marthe particulièrement, c'était l'effet d'une absence totale
d'instruction et de jugement dans cet ordre d'idées,
si nécessaires et si négligées d'ailleurs chez les femmes
de toutes les classes.
Marthe avait tout appris dans les romans. C'était
mieux que rien, on peut même dire que c'était beaucoup;
car ces lectures excitantes développent au moins le sentiment
poétique et ennoblissent les fautes. Mais ce n'était
pas assez. Le récit émouvant des passions, le drame de
la vie moderne, comme nous le concevons, n'embrasse
pas les causes, et ne peint que des effets plus contagieux
que profitables aux esprits sevrés de toute autre culture.
J'ai toujours pensé que les bons romans étaient fort utiles,
mais comme un délassement et non comme un aliment
exclusif et continuel de l'esprit.
Je faisais part de cette observation au Masaccio, et il
en tirait la conséquence que Marthe était d'autant plus
innocente qu'elle était plus bornée à certains égards. Il
se promettait de l'instruire un jour de la vraie destinée
qui convient aux femmes; et lorsqu'il me développait ses
idées sur ce point, j'admirais qu'il eût su, ainsi qu'Eugénie,
rejeter du saint-simonisme tout ce qui n'était pas
applicable à notre époque, pour en tirer ce sentiment
apostolique et vraiment divin de la réhabilitation et de
l'émancipation du genre humain dans la personne femme.
J'admirais aussi la belle organisation de ce jeune homme
qui, aux facultés perceptives de l'artiste, joignait d'une
manière si imprévue les facultés méditatives. C'était à la
fois un esprit d'analyse et de synthèse; et quand je le
regardais marcher à côté de moi, avec ses habits râpés,
ses gros souliers, son air commun et ses manières peuple,
je me demandais, en véritable anatomiste phrénologue
que j'étais, pourquoi je voyais les livrées du luxe
et les grâces de l'élégance orner autour de nous tant
d'êtres disgraciés du ciel, portant au front des signes
évidents de la dégradation intellectuelle, physique et
morale.
XXI.
Le bon Laravinière n'était pas, à beaucoup près, un
aussi grand philosophe. Sa tête était plus haute que
large, c'est dire qu'il avait plus de facultés pour l'enthousiasme
que pour l'examen. Il n'y avait de place dans cette
cervelle ardente que pour une seule idée, et la sienne
était l'idée révolutionnaire. Brave et dévoué avec passion,
il se reposait du soin de l'avenir sur les nombreuses idoles
dont il avait meublé son Panthéon républicain: Cavaignac,
Carrel, Arago, Marrast, Trélat, Raspail, le brillant
avocat Dupont, et tutti quanti, composaient le comité
directeur de sa conscience sans qu'il eût beaucoup songé
à se demander si ces hommes supérieurs sans doute,
mais incertains et incomplets comme les idées du moment,
pourraient s'accorder ensemble pour gouverner
une société nouvelle. Le bouillant jeune homme voulait le
renversement de la puissance bourgeoise, et son idéal était
de combattre pour en hâter la chute. Tout ce qui était de
l'opposition avait droit à son respect, à son amour. Son
mot favori était: «Donnez-moi de l'ouvrage.»
Il se prit pour Arsène d'une vive amitié, non qu'il
comprît toute la beauté de son intelligence, mais parce
que sous les rapports de bravoure intrépide et de dévouement
absolu où il pouvait le juger, il le trouva à la
hauteur de son propre courage et de sa propre abnégation.
Il s'étonna beaucoup de voir qu'il cultivait, avec une
sorte de soin, une passion qui n'était pas payée de retour;
mais il céda affectueusement à ce qu'il appelait la
fantaisie d'Arsène, en allant demeurer sous le même toit
que la belle Marthe, et en provoquant une sorte de confiance
et d'intimité de la part d'Horace. C'était un rôle
assez délicat pour un homme aussi franc que lui. Pourtant
il s'en tira d'une manière aussi loyale que possible,
en ne témoignant point à Horace une amitié qu'il ne ressentait
en aucune façon. Suivant les instructions d'Arsène,
il fut obligeant, sociable et enjoué avec lui; rien
de plus. L'amour-propre confiant d'Horace fit le reste. Il
s'imagina que Laravinière était attiré vers lui par son
esprit et le charme qu'il exerçait sur tant d'autres. Cela
eût pu être; mais cela n'était pas. Laravinière le traitait
comme un mari qu'on ne veut pas tromper, mais que l'on
ménage et que l'on se concilie pour cultiver l'amitié ou
l'agréable société de sa femme. Dans toutes les conditions
de la vie cela se pratique en tout bien tout honneur, et
non-seulement Laravinière n'avait pas de prétentions
pour lui-même, mais encore il avait fait ses réserves avec
Arsène, en lui déclarant que, ne voulant pas agir en
traître, il ne parlerait jamais à Marthe ni contre son
amant, ni en faveur d'un autre. Arsène l'entendait bien
ainsi; il lui suffisait d'avoir tous les jours des nouvelles
de Marthe, et d'être averti à temps de la rupture qu'il
prévoyait et qu'il attendait entre elle et Horace, pour
conserver cette forte et calme espérance dont il se nourrissait.
Laravinière voyait donc Marthe tous les jours, tantôt
seule, tantôt en présence d'Horace, qui ne lui faisait pas
l'honneur d'être jaloux de lui; et tous les soirs il voyait
Arsène, et parlait avec lui de Marthe un quart d'heure
durant, à la condition qu'ils parleraient ensuite de la république
pendant une demi-heure.
Quoique Jean ne se fût pas posé en surveillant, il lui
fut impossible de ne pas observer bientôt l'aigreur et le
refroidissement d'Horace envers la pauvre Marthe, et il
en fut choqué. Il n'avait pas plus réfléchi sur la nature et
le sort de la femme qu'il ne l'avait fait sur les autres
questions fondamentales de la société; mais, chez cet
homme, les instincts étaient si bons, que la réflexion
n'eût rien trouvé à corriger. Il avait pour les femmes un
respect généreux, comme l'ont en général les hommes
braves et forts. La tyrannie, la jalousie et la violence
sont toujours des marques de faiblesse. Jean n'avait jamais
été aimé. Sa laideur lui inspirait une extrême réserve
auprès des femmes qu'il eût trouvées dignes de son
amour; et quoique à la rudesse de son langage et de ses
manières, on ne l'eût jamais soupçonné d'être timide, il
l'était au point de n'oser lever les yeux sur Marthe qu'à
la dérobée. Cette méfiance de lui-même était parfaitement
déguisée sous un air d'insouciance, et il ne parlait jamais
de l'amour sans une espèce d'emphase satirique dont il
fallait rire malgré soi. Les femmes en concluaient généralement
qu'il était une brute; et cet arrêt une fois prononcé
contre lui, il eût fallu au pauvre Jean un grand
courage et une grande éloquence pour le faire révoquer.
Il le sentait bien, et le besoin d'amour qu'il avait refoulé
au fond de son coeur était trop délicat pour qu'il voulût
l'exposer aux doutes moqueurs qu'eût provoqués une
première explication. Faute de pouvoir abjurer un instant
le rôle qu'il s'était fait, il s'était donc condamné à
ne fréquenter que des femmes trop faciles pour lui inspirer
un attachement sérieux, mais qu'il traitait cependant
avec une douceur et des égards auxquels elles n'étaient
guère habituées.
Ceci est l'histoire de bien des hommes. Une fierté singulière
les empêchait de se montrer tels qu'ils sont, et
ils portent toute leur vie la peine d'une innocente dissimulation
dans laquelle on les oblige à persister. Mais
comme le naturel perce toujours, malgré l'espèce de mépris
railleur que notre bousingot professait pour les sentiments
romanesques, il ne pouvait voir humilier et affliger
une femme, quelle qu'elle fût, sans une profonde
indignation. S'il voyait une prostituée frappée dans la
rue par un de ces hommes infâmes qui leur sont associés,
il prenait parti héroïquement pour elle, et la protégeait
au péril de sa vie. A plus forte raison avait-il peine à se
contenir lorsqu'il voyait une femme délicate recevoir de
ces blessures qui sont plus cruelles au coeur d'un être
noble que les coups ne le sont aux épaules d'un être
avili. Dès les commencements de son séjour dans la maison
Chaignard, il vit sur les joues de Marthe la trace de
ses larmes; il surprit souvent Horace dans des accès de
colère que ce dernier avait bien de la peine à réprimer
devant lui. Peu à peu Horace, s'habituant à le considérer
comme un témoin sans conséquence, s'habitua aussi à
ne plus se contraindre, et Laravinière ne put rester longtemps
impassible spectateur de ses emportements. Un
jour il le trouva dans une véritable fureur: Horace avait
passé la nuit au bal de l'Opéra; il avait les nerfs agacés,
et regardait comme une injure de la part de Marthe,
comme un empiétement sur sa liberté, comme une tentative
de despotisme, qu'elle lui eût adressé quelques
reproches sur cette absence prolongée. Marthe n'était
pas jalouse, ou, du moins, si elle l'était, elle n'en laissait
jamais rien paraître; mais elle avait été inquiète toute la
nuit, parce qu'Horace lui avait promis de rentrer à deux
heures. Elle avait craint une querelle, un accident, peut-être
une infidélité. Quoi qu'elle eût souffert, elle ne se plaignait
que de ne pas avoir été avertie, et sa figure altérée
disait assez les angoisses de son insomnie cruelle.
«N'est-ce pas odieux, je vous le demande, dit Horace
en s'adressant à Laravinière, d'être traité comme un enfant
par sa bonne, comme un écolier par son précepteur?
Je n'ai pas le droit de sortir et de rentrer à l'heure qu'il
me plaît! Il faut que je demande une permission; et si je
m'oublie un peu, je trouve que le délai expiré est devant
moi comme un arrêt, comme la mesure exacte et compassée
du temps où il m'est permis de me distraire. Voilà
qui est plaisant! je me ferai signer un permis avec un
dédit de tant par minute.
—Vous voyez bien qu'elle souffre! lui dit Laravinière
à demi-voix.
—Parbleu! et moi, croyez-vous que je sois sur des
roses? reprit Horace à voix haute. Est-ce que des souffrances
puériles et injustes doivent être caressées, tandis
que des souffrances poignantes et légitimes comme les
miennes s'enveniment de jour en jour?
—Je vous rends donc bien malheureux, Horace! dit
Marthe en levant sur lui, d'un air de douleur sévère, ses
grands yeux d'un bleu sombre. En vérité, je ne croyais
pas travailler ici à votre malheur.
—Oui, vous me rendez malheureux, s'écria-t-il, horriblement
malheureux! Si vous voulez que je vous le dise
en présence de Jean, votre éternelle tristesse rend mon
intérieur odieux. C'est à tel point que quand j'en sors,
je respire, je m'épanouis, je reviens à la vie; et que,
quand j'y rentre, ma poitrine se resserre et je me sens
mourir. Votre amour, Marthe, c'est la machine pneumatique,
cela étouffe. Voilà pourquoi, depuis quelque temps,
vous me voyez moins souvent.
—Je crois que vous faites une erreur de date, répondit
Marthe, à qui la fierté blessée rendit le courage. Ce n'est
pas ma tristesse continuelle qui vous a forcé à vous absenter;
c'est votre absence continuelle qui m'a forcée à
être triste.
—Vous l'entendez, Laravinière! dit Horace, qui avait
besoin de trouver une excuse dans la conscience d'autrui,
et à qui l'air soucieux de Jean faisait craindre un jugement
sévère. Ainsi c'est parce que je sors, parce que je
mène la vie qui sied à un homme, parce que je fais de
mon indépendance l'usage qui me convient, que je suis
condamné à trouver, en rentrant, un visage bouleversé,
un sourire amer, des doutes, des reproches, de la froideur,
des accusations, des sentences! Mais c'est le plus
affreux supplice qui soit au monde!
—Je vois, dit Laravinière en se levant, que vous êtes
tous les deux fort à plaindre. Écoutez; si vous voulez
m'en croire, vous vous quitterez.
—C'est tout ce qu'il désire! s'écria Marthe en mettant
ses deux mains sur son visage.
—Et c'est ce que vous demandez formellement par la
bouche de Laravinière, reprit Horace avec emportement.
—Un instant, dit Laravinière. Ne me faites pas jouer
ici un personnage que je désavoue. Je n'ai reçu en particulier
les confidences d'aucun de vous, et ce que je viens
de dire, je l'ai dit de mon propre mouvement, parce que
c'est mon opinion. Vous ne vous convenez pas, vous ne
vous êtes jamais convenu; vous marchez de l'engouement
à la haine, et vous feriez mieux de mettre le pardon
et l'amitié entre vous.
—J'accorde que ce beau discours soit une inspiration
et une improvisation de Laravinière, dit Horace; au
moins, Marthe, vous me direz si c'est l'expression de
votre pensée?
—Il a pu aisément la supposer, la deviner peut-être,
répondit-elle avec dignité, en vous entendant m'accuser
de votre malheur.»
Ce n'est pas ainsi qu'Horace l'entendait. Il voulait bien
que Marthe fût délaissée par lui; mais il ne voulait pas
être quitté par elle. La force qu'elle montrait en ce moment,
et que la présence d'un tiers lui avait inspirée,
causa à Horace un des plus violents accès de dépit qu'il
eût encore éprouvés. Il se leva, brisa sa chaise, donna
un libre cours à sa colère et à son chagrin. L'ancienne
jalousie même se réveilla, le nom abhorré de M. Poisson
revint sur ses lèvres comme une vengeance; et celui
d'Arsène allait s'en échapper, lorsque Laravinière, prenant
le bras de Marthe, lui dit avec force:
—Vous avez choisi pour votre défenseur un enfant
sans raison et sans dignité; à votre place, Marthe, je ne
resterais pas un instant de plus chez lui.
—Emmenez-la donc chez vous, Monsieur! dit Horace
avec un mépris sanglant, j'y consens de grand coeur;
car je comprends maintenant ce qui se passe entre elle
et vous.
—Chez moi, Monsieur, reprit Jean, avec calme, elle
serait honorée et respectée, tandis que chez vous elle
est humiliée et insultée. Ah! grand Dieu! ajouta-t-il
avec une émotion subite, si j'avais été aimé d'une femme
comme elle, seulement un jour, je ne l'aurais oublié de
ma vie...
Et la voix lui manqua tout à coup, comme si tout son
coeur eût été prêt à s'échapper dans une parole. Il y avait
tant de vérité dans son accent, que la jalousie feinte ou
subite d'Horace s'évanouit à l'instant même; l'émotion
de Laravinière le gagna par un effet sympathique; et
obéissant à une de ces réactions auxquelles nous portent
souvent les scènes violentes, il fondit en larmes; et lui
tendant la main avec effusion:
«Jean, lui dit-il, vous avez raison. Vous avez un grand
coeur, et moi je suis un lâche, un misérable. Demandez
pardon pour moi à cette pauvre femme dont je ne suis
pas digne.»
Cette franche et noble résolution termina la querelle,
et gagna même le coeur sincère de Jean.
«A la bonne heure, dit-il en mettant la main de
Marthe dans celle d'Horace, vous êtes meilleur que je ne
croyais, Horace; il est beau de savoir reconnaître ses
torts aussi vite et aussi généreusement que vous venez
de le faire. Certainement Marthe ne demande qu'à les
oublier.»
Et il s'enfuit dans sa chambre, soit pour n'être pas
témoin de la joie de Marthe, soit pour cacher l'essor d'une
sensibilité qu'il était habitué à réprimer.
Malgré ce beau dénouement, des scènes semblables se
répétèrent bientôt, et devinrent de plus en plus fréquentes.
Horace aimait la dissipation; il y cédait avec
une légèreté effrénée. Il ne pouvait plus passer une seule
soirée chez lui; il ne vivait qu'au parterre des Italiens et
de l'Opéra. Là il était condamné à ne point briller; mais
c'était pour lui une jouissance que de lever les yeux sur
ces femmes qui étalent, dans les loges, leur beauté ou
leur luxe devant une foule de jeunes gens pauvres, avides
de plaisir, d'éclat et de richesse. Il connaissait par leurs
noms toutes les femmes à la mode dont les titres, l'argent
et l'orgueil semblaient mettre une barrière infranchissable
à sa convoitise. Il connaissait leurs loges, leurs
équipages et leurs amants; il se tenait au bas de l'escalier
pour les voir défiler devant lui lentement, les épaules
mal cachées par des fourrures qui tombaient parfois tout
à fait en l'effleurant, et qui bravaient audacieusement
l'audace de ses regards. Jean-Jacques Rousseau n'a rien
dit de trop en peignant l'impudence singulière des femmes
du grand monde; mais c'était une brutalité philosophique
dont Horace ne songeait guère à être complice.
Son ambition hardie n'était pas blessée de ces regards
froids et provoquants par lesquels cette espèce de femmes
semble vous dire: «Admirez, mais ne touchez pas.» Le
regard effronté d'Horace semblait leur répondre: «Ce
n'est pas à moi que vous diriez cela.» Enfin, les émotions
de la scène, la puissance de la musique, la contagion
des applaudissements, tout, jusqu'à la fantasmagorie
du décor et l'éclat des lumières, enivrait ce jeune homme,
qui, après tout, n'avait en cela d'autre tort que d'aspirer
aux jouissances offertes et retirées sans cesse par la société
aux pauvres, comme l'eau à la soif de Tantale.
Aussi, lorsqu'il rentrait dans sa mansarde obscure et
délabrée, et qu'il trouvait Marthe froide et pâle, assoupie
de fatigue auprès d'un feu éteint, il éprouvait un malaise
où le remords et le dépit se combattaient douloureusement.
Alors, à la moindre occasion, l'orage recommençait;
et Marthe, n'espérant pas guérir d'une passion aussi funeste,
désirait et appelait la mort avec énergie.
Dans ces sortes de secrets domestiques, dès qu'on a
laissé tomber le premier voile on éprouve de part et
d'autre le besoin d'invoquer le jugement d'un tiers; on
le recherche, tantôt comme un confident, tantôt comme
un arbitre. Laravinière fut médiateur dans les commencements.
Il était fâché de se sentir entraîné à prendre
part dans la querelle, et il avouait à Arsène que, malgré
ses résolutions de neutralité, il était obligé de contracter
avec Horace une sorte d'amitié. En effet, ce dernier lui
témoignait une confiance et lui prouvait souvent une générosité
de coeur qui l'engageait de plus en plus. Horace
avait, en dépit de tous ses défauts, des qualités séduisantes;
il était aussi prompt à se radoucir qu'il l'était à
s'emporter. Une parole sage trouvait toujours le chemin
de sa raison; une parole affectueuse trouvait encore plus
vite celui de son coeur. Au milieu d'un débordement inouï
d'orgueil et de vanité, il revenait tout à coup à un repentir
modeste et ingénu. Enfin, il offrait tour à tour le
spectacle des dispositions et des instincts les plus contraires,
et la dispute que nous avons rapportée en gros
ci-dessus résume toutes celles qui suivirent, et que Laravinière
fut appelé à terminer.
Cependant, lorsque ces disputes se furent renouvelées
un certain nombre de fois, Laravinière, obéissant, ainsi
qu'Arsène le lui avait conseillé, à la spontanéité de ses
impressions, se sentit porté à moins d'indulgence envers
Horace. Il y a, dans le retour fréquent d'un même tort,
quelque chose qui l'aggrave et qui lasse la patience des
âmes justes. Peu à peu Laravinière fut tellement fatigué
de la facilité avec laquelle Horace s'accusait lui-même et
demandait pardon, que son admiration pour cette facilité
se changea en une sorte de mépris. Il arriva enfin à ne
voir en lui qu'un hâbleur sentimental, et à sentir sa conscience
dégagée de cette affection dont il n'avait pu se
défendre. Cet arrêt définitif était bien sévère, mais il était
inévitable de la part d'un caractère aussi ferme et aussi
égal que l'était celui de Jean.
«Mon pauvre camarade, dit-il à Horace un jour que
celui-ci invoquait encore son intervention, je ne peux pas
vous laisser ignorer davantage que je ne m'intéresse plus
du tout à vos amours. Je suis fatigué de voir d'un côté
une folie et de l'autre une faiblesse incurable. Je devrais
dire peut-être faiblesse et folie de part et d'autre; car il
y a de la monomanie chez Marthe, à vous aimer si constamment,
et chez vous il y a une faiblesse misérable dans
toutes ces parades de violence dont vous nous régalez.
Je vous ai cru d'abord égoïste, et puis je vous ai cru
bon. Maintenant je vois que vous n'êtes ni bon ni mauvais;
vous êtes froid, et vous aimez à vous démener dans
un orage de passions factices; vous avez une nature de
comédien. Quand nous sommes là à nous émouvoir de
vos trépignements, de vos déclamations et de vos sanglots,
vous vous amusez à nos dépens, j'en suis certain.
Oh! ne vous fâchez pas, ne roulez pas les yeux comme
Bocage dans Buridan, et ne serrez pas le poing. J'ai vu
cela si souvent, qu'à tout ce que vous pourriez faire ou
dire je répondrais connu! Je suis un spectateur usé, et
désormais aussi froid qu'un homme qui a ses entrées au
théâtre. Je sais que vous êtes puissant dans le drame;
mais je sais toutes vos pièces par coeur. Si vous voulez
que je vous écoute, reprenez votre sérieux, jetez votre
poignard, et parlez-moi raison. Dites-moi prosaïquement
que vous n'aimez plus votre maîtresse parce qu'elle vous
ennuie, et autorisez-moi à le lui faire comprendre avec
tous les égards et les ménagements qui lui sont dus. C'est
alors seulement que je vous rendrai mon estime et que
je vous croirai un homme d'honneur.
—Eh bien, dit Horace avec une rage concentrée, je
consens à vous parler froidement, très-froidement; car
je sais me vaincre, et commence par vous dire sérieusement
et tranquillement que vous me rendrez raison de
toutes les insultes que vous venez de me faire...
—Allons au fait, reprit Jean. C'est la dixième fois depuis
un mois que vous me provoquez; et c'eût été vous
rendre service que de vous prendre au mot; mais j'ai un
meilleur emploi à faire de mon sang que de le compromettre
avec un maladroit comme vous. Rappelez-vous
donc que je fais sauter votre fleuret toutes les fois que
nous nous amusons à l'escrime, et en conséquence souffrez
que je refuse votre nouveau défi.
—Je saurai vous y contraindre, dit Horace pâle comme
la mort.
—Vous m'insulterez publiquement? vous me donnerez
un soufflet? mais avec un croc-en-jambe et un revers
de mon frère-jean... Dieu m'en préserve, Horace! ces
façons-la sort bonnes avec les mouchards et les gendarmes.
Tenez, quoique je ne vous aime plus, j'ai encore
pour vous quelque chose qui me ferait supporter de vous
un acte de folie plutôt que d'y répondre. Taisez-vous donc.
Je vous préviens que je ne me défendrai pas, et qu'il y
aurait lâcheté de votre part à m'attaquer.
—Mais qui donc ici attaque et provoque? qui donc est
lâche, trois fois lâche, de vous ou de moi? Vous m'accablez
d'outrages, vous me traitez avec le dernier mépris,
et vous dites que vous ne m'accorderez point de réparation!
Ah! dans ce moment, je comprends le duel des
Malais, qui déchirent leurs propres entrailles en présence
de leur ennemi.
—Voilà une belle phrase, Horace, mais c'est encore de
la déclamation; car je ne suis pas votre ennemi; et je
jure que je ne veux pas vous insulter. Je vous donne une
leçon amicale, et vous pouvez bien la recevoir, puisque
vous êtes venu si souvent la chercher. Il y a longtemps
que je vous l'épargne et que j'accepte de votre part des
excuses dont je ne crois pas avoir jamais abusé contre
vous.
—Vous en abusez horriblement dans ce moment-ci;
vous me faites rougir de l'abandon et de la loyauté de
coeur que j'ai eus avec vous.
—Je n'en abuse pas, puisque c'est pour vous empêcher
de vous humilier de nouveau que je vous défends
d'y revenir.
—Mon Dieu! mon Dieu! qu'ai-je donc fait, s'écria
Horace en pleurant de rage et en se tordant les mains,
pour être traité de la sorte?
—Ce que vous avez fait, je vais vous le dire, répondit
Laravinière. Vous avez fait souffrir et dépérir une pauvre
créature qui vous adore et que vous n'estimez seulement
pas.
—Moi! je n'estime pas Marthe! Osez-vous dire que
je n'estime pas la femme à qui j'ai donné ma jeunesse,
ma vie, la virginité de mon coeur?
—Je ne pense pas que ce soit à titre de sacrifice que
vous l'ayez fait, et, dans tous les cas, je suis peu disposé
à vous en plaindre.
—Parce que vous ne comprenez rien à l'amour. C'est
vous qui êtes un être froid et sans intelligence des passions.
—C'est possible, dit Jean avec un sourire mêlé d'amertume;
mais je ne fais pas le semblant du contraire. Eh
bien, expliquez-moi donc, en ce cas, en quoi vous êtes si
à plaindre?
—Jean, s'écria Horace, vous ne savez pas ce que c'est
que d'aimer pour la première fois, et d'être aimé pour la
seconde ou troisième.
—Ah! nous y voilà, dit Laravinière en haussant les
épaules. La Vierge Marie était seule digne de monsieur
Horace Dumontet! Connu! mon cher. Vous l'avez dit
assez souvent devant moi à cette pauvre Marthe. Mais
dire ces choses-là, voyez-vous, en avoir seulement la
pensée, prouve qu'on était digne tout au plus de mademoiselle
Louison. Quelle vanité et quelle erreur sont les
vôtres! Il y a certaines femmes perdues qui valent mieux
que certains adolescents.
—Jean, vous êtes un grossier, un brutal, un insolent
personnage.
—Oui, mais je dis la vérité. Il y a des coeurs purs
sous des robes souillées, et des coeurs corrompus sous
des gilets magnifiques.»
Horace déchira son gilet de velours cramoisi et en jeta
les lambeaux à la figure du Laravinière. Jean les esquiva,
et les poussant du bout de son pied:
«C'est cela, dit-il; comme si vous n'étiez pas assez
endetté avec votre tailleur!
—Je le suis avec vous, Monsieur, dit Horace. Je ne
l'avais pas oublié; mais je vous remercie de me le rappeler.
—Si vous vous en souvenez, tant mieux, dit Laravinière
avec insouciance; il y a dans les prisons de pauvres
patriotes qui en profiteront pour acheter des cigares.
Allons, rallumez le vôtre, et parlons un peu sans nous
fâcher. Que vous ayez eu envers Marthe des torts incontestables,
vous ne pouvez pas le nier; et moi, sachant
que vous êtes un enfant gâté, que vous avez pour vous
l'esprit, les belles paroles et une superbe figure, je vous
excuse jusqu'à un certain point. Je sais bien que c'est le
privilège des beaux garçons, comme celui des belles
femmes, d'avoir des caprices; je ne peux pas exiger que
vous ayez la sagesse d'un homme comme moi, qui ressemble
à un sanglier plus qu'à un chrétien, et dont la
face a été labourée un jour qu'il grêlait des hallebardes.
Mais ce que je ne vous pardonne pas, c'est d'aimer à
faire souffrir; c'est de ne pas rompre une liaison dont
vous êtes dégoûté; c'est de manquer de franchise, en
un mot, et de ne pas vouloir guérir le mal que vous avez
fait.
—Mais je l'aime, cette femme que je fais souffrir! je
ne puis m'en séparer! je ne m'habituerais pas à vivre
sans elle!
—Quand même cela serait vrai (et j'en doute, puisque
vous vous arrangez de manière à rester avec elle le
moins que vous pouvez), votre devoir serait de vaincre
un amour qui lui est nuisible.
—Quand je le voudrais, elle n'y consentirait jamais.
—En êtes-vous bien sûr?
—Elle se tuera si je l'abandonne.
—Si vous l'abandonnez froidement et brutalement,
c'est possible; mais si vous le faites par loyauté, par dévouement,
au nom de l'honneur, au nom de votre amour
même...
—Jamais! jamais Marthe ne se résignera à me perdre,
je le sais trop.
—Voilà de la fatuité. Autorisez-moi à lui parler avec
la même franchise que je viens d'avoir avec vous, et
nous verrons.
—Jean! encore un coup, vous avez des vues sur elle!
—Moi? Il faudrait pour cela trois choses: 1° qu'il n'y
eût plus un seul miroir dans l'univers; 2° que Marthe
perdît la vue; 3° qu'elle et moi n'eussions aucun souvenir
de ma figure.
—Mais quelle obstination avez-vous à nous séparer?
—Je vais vous le dire sans détour: j'ai des vues pour
un autre.
—Vous êtes chargé de la séduire ou de l'enlever?
Pour quel prince russe ou pour quel don Juan du Café
de Paris?
—Pour le fils d'un cordonnier, pour Paul Arsène.
—Comment, vous le voyez?
—Tous les jours.
—Et vous m'en avez fait mystère?... Voilà qui est
étrange!
—C'est fort simple, au contraire. Je savais que vous
ne l'aimez pas, et je ne voulais pas vous entendre mal
parler de lui, parce que je l'aime.
—Ainsi vous êtes le Mercure de ce Jupiter, qui déjà
s'est changé en pluie de gros sous pour me supplanter?
—Triple insulte pour lui, pour elle et pour moi.
Grand merci! C'était dans votre rôle? Vous l'avez très-bien
dit! Si j'étais claqueur, je me pâmerais d'admiration.
—Mais enfin, Laravinière, c'est à me rendre fou!
Vous agissez ici contre moi, vous me trahissez, vous parlez
pour un autre. Et moi qui me fiais à vous!
—Et vous aviez raison, Monsieur. Je n'ai jamais prononcé
le nom d'Arsène devant Marthe. Et quant à vous
brouiller avec elle, je n'ai jamais fait que le contraire.
Aujourd'hui je renonce à vous réconcilier: mon coeur et
ma conscience me le défendent. Ou je quitte la maison
aujourd'hui pour ne plus revoir ni vous ni Marthe, ou je
l'engage, avec votre autorisation, à rompre un engagement
qui vous pèse et qui la tue.»
Horace, vaincu par la rude franchise et la fermeté impitoyable
de Laravinière, mis au pied du mur, et ne sachant
plus comment faire pour regagner l'estime de cet
homme dont il craignait le jugement, promit de réfléchir
à sa proposition, et demanda quelques jours pour prendre
un parti définitif. Mais les jours s'écoulèrent, et il ne sut
se décider à rien.
XXII.
Il ne mentait pas en disant que Marthe lui était nécessaire.
Il avait horreur de la solitude, et il avait besoin
du dévouement d'autrui, deux choses qui lui rendaient
Marthe plus précieuse encore qu'il n'osait le dire à Laravinière;
car celui-ci n'était plus disposé à se faire illusion
sur son compte, et, s'il eût deviné le véritable motif de
cette persévérance, il l'eût taxé d'égoïsme et d'exploitation.
Marthe était plus facile à tromper ou à contenter.
Il lui suffisait qu'Horace lui dit un mot de crainte ou de
regret à l'idée de séparation, pour qu'elle acceptât héroïquement
toutes les souffrances attachées à cette union
malheureuse.
«Il a plus besoin de moi qu'on ne pense, disait-elle;
sa santé n'est pas si forte qu'elle le paraît. Il a de fréquentes
indispositions par suite d'une irritabilité des
nerfs qui m'a fait parfois craindre, sinon pour sa vie, du
moins pour sa raison. A la moindre douleur, il s'exaspère
d'une façon effrayante. Et puis il est distrait, nonchalant;
il ne sait pas s'occuper de lui-même: si je n'étais pas là,
au milieu de ses rêveries et de ses divagations, il oublierait
de dormir et de manger. Sans compter qu'il n'aurait
jamais la précaution et l'attention de mettre tous les jours
vingt sous de côté pour dîner. Enfin, il m'aime, malgré
toutes ses boutades. Il m'a dit cent fois, dans ces moments
d'abandon et de repentir où l'on est vraiment soi-même,
qu'il préférait souffrir encore mille fois plus de son amour
que de guérir en cessant d'aimer.»
C'est ainsi que Marthe parlait à Laravinière; car ce
dernier, voyant qu'Horace ne se décidait à rien, avait
rompu la glace avec elle, après avoir bien et dûment
averti Horace de ce qu'il allait faire. Horace, qui l'avait
pris, pour ses amère critiques, en une véritable aversion,
prévoyant qu'il faudrait désormais en venir à des
querelles sérieuses pour l'éloigner, l'avait mis ironiquement
au défi de lui voler le coeur de Marthe, et lui donnait
désormais carte blanche auprès d'elle. Quoiqu'il fût
outré de l'aplomb dédaigneux avec lequel Jean procédait
ouvertement contre lui, il ne le craignait pas. Il le savait
maladroit, timide, plus scrupuleux et plus compatissant
qu'il ne voulait le paraître; et il sentait bien que d'un
mot il détruirait, dans l'esprit de son indulgente amie,
tout l'effet du plus long discours possible de Laravinière.
Il en fut ainsi, et il se donna la peine de regagner son
empire sur Marthe, comme s'il se fût agi de gagner un
pari. Combien d'amours malheureuses se sont ainsi prolongées
et comme ranimées avec effort dans des coeurs
lassés ou éteints, par la crainte de donner un triomphe
à ceux qui en prédisaient la fin prochaine! Le repentir
et le pardon, dans ces cas-là, ne sont pas toujours très-désintéressés,
et il y a plus de loyauté qu'on ne pense à
braver le scandale d'une rupture devenue nécessaire.
Laravinière travaillait donc en pure perte. Depuis
qu'il avait résolu de sauver Marthe, elle était plus que
jamais ennemie de son propre salut. Il vit bientôt qu'au
lieu de l'amener au dessein qu'il avait conçu, il la fortifiait
dans le dessein contraire. Il avoua à Arsène qu'au
lieu de le servir, il avait empiré sa situation; et il rentra
dans sa neutralité, se consolant avec l'idée que Marthe
apparemment n'était pas aussi malheureuse qu'il l'avait
jugé.
Il eût, à celle époque, quitté l'hôtel de M. Chaignard,
si des raisons étrangères à nos deux amants ne lui eussent
rendu ce domicile plus sûr et plus propice qu'aucun autre
à certains projets qui l'occupaient secrètement. Pourquoi
ne le dirais-je pas aujourd'hui, que le brave Jean n'est
plus à la merci des hommes, et que ceux qui partagèrent
son sort sont, aussi bien que lui, soit par la
mort, soit par l'absence, à l'abri de toute persécution?
Jean conspirait. Avec qui, je l'ai toujours ignoré, et je
l'ignore encore. Peut-être conspirait-il tout seul; je ne
pense pas qu'il fût exploité, séduit, ni entraîné par personne.
Avec le caractère ardent que je lui connaissais et
l'impatience d'agir qui le dévorait, j'ai toujours pensé
qu'il était homme plutôt à gourmander la prudence des
chefs de son parti et à outrepasser leurs intentions, qu'à
se laisser devancer par eux dans une entreprise à main
armée. Ma situation ne me permettait pas d'être son
confident. A quel point Arsène le fut, je ne l'ai pas su
davantage, et je n'ai pas cherché à le savoir. Ce qu'il y
a de certain, c'est qu'Horace, entrant brusquement
dans la chambre de Laravinière, un jour que celui-ci
avait oublié de s'enfermer, il le trouva environné de
fusils de munition qu'il venait de tirer d'une grande
malle, et qu'il inspectait en homme versé dans l'entretien
des armes. Dans la même malle, il y avait des cartouches,
de la poudre, du plomb, un moule, tout ce
qui était nécessaire pour envoyer le possesseur de ces
dangereuses reliques devant un jury, et de là en place
de Grève ou au Mont-Saint-Michel. Horace était précisément
dans une heure de spleen et d'abandon. Il avait
encore de ces moments-là avec Laravinière, quoiqu'il se
fût promis de n'en plus avoir.
«Oui-da! s'écria-t-il en le voyant refermer précipitamment
son coffre, jouez-vous ce jeu-là? Eh bien! ne
vous en cachez pas. Je sympathise avec cette manière de
voir; et si vous voulez, en temps et lieu, me confier une
de ces clarinettes, je suis très-capable d'en jouer aussi.
—Dites-vous ce que vous pensez, Horace? répondit
Jean en attachant sur lui ses petits yeux verts et brillants
comme ceux d'un chat. Vous m'avez si souvent
raillé amèrement pour mon emportement révolutionnaire,
que je ne sais pas si je puis compter sur votre
discrétion. Cependant, quelque peu de sympathie que
vous inspirent mon projet et ma personne, quand vous
vous rappellerez qu'il y va de ma tête, vous ne vous
amuserez pas, j'espère, à me plaisanter tout haut sur
mon goût pour les armes à feu.
—J'espère, moi, que vous n'avez aucune crainte à
cet égard; et je vous répète que, loin de vous critiquer,
je vous approuve et vous envie. Je voudrais, moi aussi,
avoir une espérance, une conviction assez forte pour me
faire hacher à coups de sabre derrière une barricade.
—Eh! si le coeur vous en dit, vous pouvez vous
adresser à moi. Voyez, Horace, est-ce que ne voilà pas
une plume avec laquelle un jeune poëte comme vous
pourrait écrire une belle page et se faire un nom immortel?»
En parlant ainsi, il soulevait une carabine assez jolie
qu'il s'était réservée pour son usage particulier. Horace
la prit, la pesa dans sa main, en fit jouer la batterie,
puis s'assit en la posant sur ses genoux, et tomba dans
une rêverie profonde.
«A quoi bon vivre dans ce temps-ci? s'écria-t-il
lorsque Laravinière, achevant de serrer ses dangereux
trésors, lui ôta doucement son arme favorite; n'est-ce
pas une vie d'avortement et d'agonie? N'est-ce pas un
leurre infâme que cette société nous fait, lorsqu'elle
nous dit: Travaillez, instruisez-vous, soyez intelligents,
soyez ambitieux, et vous parviendrez à tout! et il n'y
aura pas de place si haute à laquelle vous ne puissiez
vous asseoir! Que fait-elle, cette société menteuse et
lâche, pour tenir ses promesses? Quels moyens nous
donne-t-elle de développer les facultés qu'elle nous demande
et d'utiliser les talents que nous acquérons pour
elle? Rien! Elle nous repousse, elle nous méconnaît,
elle nous abandonne, quand elle ne nous étouffe pas. Si
nous nous agitons pour parvenir, elle nous enferme ou
nous tue; si nous restons tranquilles, elle nous méprise
ou nous oublie. Ah! vous avez raison, Jean, grandement
raison de vous préparer à un glorieux suicide!
—Oh! si vous croyez que je songe à ma gloire et à
celle de mes amis, vous vous trompez beaucoup, dit
Laravinière. Je suis très-content de la société en ce qui
me concerne. J'y jouis d'une indépendance absolue, et
j'y savoure une fainéantise délicieuse. Je la traverse en
véritable bohémien, et je n'y ai qu'une affaire, qui est
de conspirer pour son renversement; car le peuple
souffre, et l'honneur appelle ceux qui se sont dévoués
pour lui. Il en sera ce que Dieu voudra!
—Le peuple, voilà un grand mot, reprit Horace; mais,
soit dit sans vous offenser, je crois que vous vous souciez
aussi peu de lui qu'il se soucie de vous. Vous aimez
la guerre et vous la cherchez; voilà tout, mon cher président:
chacun obéit à ses instincts. Voyons, pourquoi
aimeriez-vous le peuple?
—Parce que j'en suis.
—Vous en êtes sorti, vous n'en êtes plus. Le peuple
seul si bien que vous avez des intérêts différents des
siens, qu'il vous laisse conspirer tout seul, ou peu s'en
faut.
—Vous ne savez rien de cela, Horace, et je n'ai pas
à m'expliquer là-dessus; mais soyez sûr que je suis sincère
quand je dis: «J'aime le peuple.» Il est vrai que
j'ai peu vécu avec lui, que je suis une espèce de bourgeois,
que j'ai des goûts épicuriens qui me gêneront si
nous avons un jour un régime spartiate qui prohibe la
bière et le caporal. Mais qu'importe tout cela? Le peuple,
c'est le droit méconnu, c'est la souffrance délaissée,
c'est la justice outragée. C'est une idée, si vous voulez;
mais c'est l'idée grande et vraie de notre temps. Elle
est assez belle pour que nous combattions pour elle.
—C'est une idée que l'on retournera contre vous
quand vous l'aurez proclamée.
—Et pourquoi donc, à moins que je ne la désavoue?
Et pourquoi le ferais-je? comment pourrais-je changer?
Est-ce qu'une idée meurt comme une passion, comme
un besoin? La souveraineté de tous sera toujours un
droit: l'établir ne sera pas l'affaire d'un jour. Il y a
bien de l'ouvrage pour toute ma vie, quand même je
ne trouverais pas la mort au commencement.»
Ce n'était pas la première fois qu'ils débattaient leurs
théories à cet égard. Jean y avait toujours eu le dessous,
quoiqu'il eût pour lui la vérité et la conviction; il
n'avait pas l'intelligence assez prompte et assez subtile
pour repousser toutes les objections et toutes les moqueries
de son adversaire. Horace voulait aussi la république,
mais il la voulait au profit des talents et des
ambitions. Il disait que le peuple trouverait le sien à remettre
ses intérêts aux mains de l'intelligence et du savoir;
que le devoir d'un chef serait de travailler au
progrès intellectuel et au bien-être du peuple; mais il
n'admettait pas que ce même peuple dût avoir des
droits sur l'action des hommes supérieurs, ni qu'il pût
en faire un bon usage. Beaucoup d'aigreur entrait souvent
dans ces discussions, et le grand argument d'Horace
contre les démocrates bourgeois, c'est qu'ils parlaient
toujours, et n'agissaient jamais.
Quand il eut acquis la preuve que Laravinière jouait
un rôle actif, ou était prêt à le jouer, il conçut pour lui
plus d'estime, et se repentit de l'avoir blessé. Tout en
continuant de contester le principe d'une révolution en
faveur du peuple, il crut à cette révolution, et désira
n'y prendre part, afin d'y trouver de la gloire, des émotions,
et un essor pour son ambition trompée par le régime
constitutionnel. Il demanda à Jean sa confiance, se
réconcilia avec lui; et, soit qu'il y eût alors une apparence
de sympathie chez les masses, soit que Laravinière
se fit des illusions gratuites, Horace crut à un
mouvement efficace, s'engagea par serment auprès de
Jean à s'y jeter au premier appel, et se tint prêt à tout
événement. Il se procura un fusil, et fit des cartouches
avec une ardeur et une joie enfantines. Dès lors il fut
plus calme, plus sédentaire, et d'une humeur plus
égale. Ce rôle de conspirateur l'occupait tout entier. Ce
rôle ranimait son espoir abattu; il le vengeait secrètement
de l'indifférence de la société envers lui; il lui donnait
une contenance vis-à-vis de lui-même, une attitude
vis-à-vis de Jean et de ses camarades. Il aimait à inquiéter
Marthe, à la voir pâlir lorsqu'il lui faisait pressentir
les dangers auxquels il brûlait de s'exposer. Il se pleurait
aussi un peu d'avance, et répandait des fleurs sur
sa tombe; il fit même son épitaphe en vers. Quand il
rencontra madame la vicomtesse de Chailly à l'Opéra, et
qu'elle le salua fort légèrement, il s'en consola en pensant
qu'elle viendrait peut-être l'implorer lorsqu'il serait
un homme puissant, un grand orateur ou un publiciste
influent dans la république.
Soit que les événements qui approchaient ne fussent
pas prévus par d'autres que par lui, soit que des circonstances
cachées en eussent retardé l'accomplissement,
Laravinière n'avait eu autre chose à faire qu'à fourbir
ses fusils, dans l'attente d'une révolution, lorsque le
choléra vint éclater dans Paris, et distraire douloureusement
les masses de toute préoccupation politique.
J'étais à l'ambulance, roulé dans mon manteau, par
une de ces froides nuits du printemps qui semblaient
donner plus d'intensité au fléau, et j'attendais, en volant
à l'ennemi un quart d'heure de mauvais sommeil, qu'on
vint m'appeler pour de nouveaux accidents, lorsque je
sentis une main se poser sur mon épaule. Je me réveillai
brusquement, et me levant par habitude, je fus prêt à
suivre la personne qui me réclamait, avant d'avoir ouvert
tout à fait mes yeux appesantis par la fatigue. Ce fut seulement
lorsqu'elle passa auprès de la lanterne rouge suspendue
à l'entrée de l'ambulance, que je crus la reconnaître,
malgré le changement qui s'était opéré en elle.
«Marthe! m'écriai-je, est-ce donc vous! Et pour qui
venez-vous me chercher, grand Dieu?
—Pour qui voulez-vous que ce soit? dit-elle en joignant
les mains. Oh! venez tout de suite, venez avec
moi!»
J'étais déjà en route avec elle.
«Est-il gravement attaqué? lui demandai-je chemin
faisant.
—Je n'en sais rien, me dit-elle; mais il souffre beaucoup,
et son esprit est tellement frappé, que je crains
tout. Il y a plusieurs jours qu'il a des pressentiments, et
aujourd'hui il m'a dit à plusieurs reprises qu'il était
perdu. Cependant il a bien dîné, il a été au spectacle, et
en rentrant il a soupé.
—Et quels accidents?
—Aucun; mais il souffre, et il m'a dit avec tant de
force de courir à l'ambulance, que la frayeur s'est emparée
de moi tout à coup, et je puis à peine me soutenir.
—En effet, Marthe, vous avez le frisson. Appuyez-vous
sur mon bras.
—Oh! c'est seulement un peu de froid!
—Vous êtes à peine vêtue pour une nuit aussi froide,
enveloppez-vous de mon manteau.
—Non, non, cela nous retarderait, marchons!
—Pauvre Marthe! vous êtes maigrie, lui dis-je tout
en marchant vite, et en regardant à la lueur blafarde des
réverbères, ses joues amincies, que creusait encore
l'ombre de ses cheveux noirs flottants au gré de la bise.
—Je suis pourtant très-bien portante,» me dit-elle d'un
air préoccupé. Puis tout à coup, par une liaison d'idées
qui ne s'était pas encore faite en elle: Dites-moi donc
plutôt, s'écria-t-elle vivement, comment se porte Eugénie.
—Eugénie va bien, lui dis-je; elle ne souffre que
d'avoir perdu votre amitié.
—Ah! ne dites pas cela! répondit-elle avec un accent
déchirant. Mon Dieu! épargnez-moi ce reproche-là!
Dieu sait que je ne le mérite pas! Dites-moi plutôt
qu'elle m'aime toujours.
—Elle vous aime toujours tendrement, chère Marthe.
—Et vous aimez toujours Horace? reprit Marthe, oubliant
tout ce qui lui était personnel, et me tirant par le
bras pour me faire courir.
Je courus, et nous fûmes bientôt près de lui. Il fit un
cri perçant en me voyant, et se jetant dans mes bras:
«Ah! maintenant je puis mourir, s'écria-t-il avec
chaleur; j'ai retrouvé mon ami.» Et il retomba sur son
fauteuil, pâle et brisé, comme s'il était près d'expirer.
Je fus très-effrayé de cette prostration. Je tâtai son
pouls, qui était à peine sensible. Je l'examinai, je le fis
coucher, je l'interrogeai attentivement, et je me disposai
à passer la nuit près de lui.
Il était malade en effet. Son cerveau était en proie à
une exaspération douloureuse, tous ses nerfs étaient
agités; il avait une sorte de délire, il parlait de mort,
de guerre civile, de choléra, d'échafaud; et mêlant, dans
ses rêves, les diverses idées qui le possédaient, il me
prenait tantôt pour un croque-mort qui venait le jeter
dans la fatale tapissière, tantôt pour le bourreau qui le
conduisait au supplice. A ces moments d'exaltation succédaient
des évanouissements, et quand il revenait à
lui-même, il me reconnaissait, pressait mes mains avec
énergie, et s'attachant à moi, me suppliait de ne pas
l'abandonner, et de ne pas le laisser mourir. Je n'en
avais pas la moindre envie, et je me mettais à la torture
pour deviner son mal; mais quelque attention que j'y
apportasse, il m'était impossible d'y voir autre chose
qu'une excitation nerveuse causée par une affection morale.
Il n'y avait pas le moindre symptôme de choléra,
pas de fièvre, pas d'empoisonnement, pas de souffrance
déterminée. Marthe s'empressait autour de lui avec un
zèle dont il ne semblait pas s'apercevoir, et, en la regardant,
j'étais si frappé de son air de dépérissement, et
d'angoisse, que je la suppliai d'aller se coucher. Je ne
pus l'y faire consentir. Cependant, à la pointe du jour,
Horace s'étant calmé et endormi, elle tomba à son tour
assoupie sur un fauteuil au pied du lit. J'étais au chevet,
vis-à-vis d'elle, et je ne pouvais m'empêcher de comparer
la figure d'Horace, pleine de force et de santé, avec
celle de cette femme que j'avais vue naguère si belle, et
qui n'était plus devant mes yeux que comme un spectre.
J'allais m'endormir aussi, lorsque, sans réveiller personne,
Laravinière entra sur la pointe du pied, et vint
s'asseoir près de moi. Il avait passé lui-même la nuit
auprès d'un de ses amis atteint du choléra, et, en rentrant,
il avait appris que Marthe était allée à l'ambulance
pour Horace. «Qu'a t-il donc?» me demanda-t-il en
se penchant vers lui pour l'examiner. Quand je lui eus
avoué que je n'y voyais rien de grave, et que cependant
il m'avait occupé et inquiété toute la nuit, Jean haussa
les épaules. «Voulez-vous que je vous dise ce que c'est?
me dit-il en baissant la voix encore davantage: c'est une
panique, rien de plus. Voilà deux ou trois fois qu'il nous
a fait des scènes pareilles; et si j'avais été ici ce soir,
Marthe n'aurait pas été, tout effrayée, vous déranger.
Pauvre femme! elle est plus malade que lui.
—C'est ce qui me semble. Mais vous me paraissez,
vous, bien sévère pour mon pauvre Horace?
—Non; je suis-juste. Je ne prétends pas qu'Horace
soit ce qu'on appelle un lâche; je suis même sûr qu'il
est brave, et qu'il irait résolument au feu d'une bataille
ou d'un duel. Mais il a ce genre de lâcheté commun à
tous les hommes qui s'aiment un peu trop: il craint la
maladie, la souffrance, la mort lente, obscure et douloureuse
qu'on trouve dans son lit. Il est ce que nous appelons
douillet. Je l'ai vu une fois tenir tête, dans la rue,
à des gens de mauvaise mine qui voulaient l'attaquer, et
que sa bonne contenance a fait reculer; mais je l'ai vu
aussi tomber en défaillance pour une petite coupure
qu'il s'était faite au bout du doigt en taillant sa plume.
C'est une nature de femme, malgré sa barbe de Jupiter
Olympien. Il pourrait s'élever à l'héroïsme, il ne supporte
pas un bobo.
—Mon cher Jean, répondis-je, je vois tous les jours
des hommes dans toute la force de l'âge et de la volonté,
qui passent pour fermes et sages, et que la pensée du
choléra (et même de bien moindres maux ) rend pusillanimes
à l'excès. Ne croyez pas qu'Horace soit une exception.
Les exceptions seules affrontent la maladie avec
stoïcisme.
—Aussi ne fais-je point, reprit-il, le procès à votre
ami; mais je voudrais que cette pauvre Marthe s'habituât
à ses manières, et ne prît pas l'alarme toutes les fois
qu'il lui passe par la tête de se croire mort.
—Est-ce donc là, demandai-je, la cause de son air
triste et accablé?
—Oh! ce n'en est qu'une entre toutes. Mais je ne
veux pas faire ici le délateur. Je me suis abstenu jusqu'à
présent de vous dire ce qui se passait. Puisque vous voilà
revenu chez eux, vous en jugerez bientôt par vous-même.
XXIII.
En effet, étant revenu le lendemain m'assurer de l'état
de parfaite santé où se trouvait Horace, j'obtins de lui,
sans la provoquer beaucoup, la confidence de ses chagrins.
«Eh bien, oui, me dit-il, répondant à une observation
que je lui faisais, je suis mécontent de mon
sort, mécontent de la vie, et, pourquoi ne le dirais-je
pas? tout à fait las de vivre. Pour une goutte de fiel de
plus qui tomberait dans ma coupe, je me couperais la
Gorge.
—Cependant hier, en vous croyant pris du choléra,
vous me recommandiez vivement de ne pas vous laisser
mourir. J'espère que vous vous exagérez à vous-même
votre spleen d'aujourd'hui.
—C'est qu'hier j'avais mal au cerveau, j'étais fou,
je tenais à la vie par un instinct animal; aujourd'hui
que je retrouve ma raison, je retrouve l'ennui, le dégoût
et l'horreur de la vie.»
J'essayai de lui parler de Marthe, dont il était l'unique
appui, et qui peut-être ne lui survivrait pas s'il consommait
le crime d'attenter à ses jours. Il fit un mouvement
d'impatience qui allait presque jusqu'à la fureur; il regarda
dans la chambre voisine, et s'étant assuré que
Marthe n'était pas rentrée de ses courses du matin,
«Marthe! s'écria-t-il! eh bien, vous nommez mon fléau,
mon supplice, mon enfer! Je croyais, après toutes les
prédictions que vous m'avez faites à cet égard, qu'il y
allait de mon honneur de vous cacher à quel point elles
se sont réalisées; eh bien, je n'ai pas ce sot orgueil, et
je ne sais pas pourquoi, quand je retrouve mon meilleur,
mon seul ami, je lui ferais mystère de ce qui se passe en
moi. Sachez donc la vérité, Théophile: j'aime Marthe,
et pourtant je la hais; je l'idolâtre, et en même temps
je la méprise; je ne puis me séparer d'elle, et pourtant
je n'existe que quand je ne la vois pas. Expliquez cela,
vous qui savez tout expliquer, vous qui mettez l'amour
en théorie, et qui prétendez le soumettre à un régime
comme les autres maladies.
—Cher Horace, lui répondis-je, je crois qu'il me serait
facile de constater du moins l'état de votre âme. Vous
aimez Marthe, j'en suis bien certain; mais vous voudriez
l'aimer davantage, et vous ne le pouvez pas.
—Eh bien, c'est cela même! s'écria-t-il. J'aspire à
un amour sublime, je n'en éprouve qu'un misérable.
Je voudrais embrasser l'idéal, et je n'étreins que la
réalité.
—En d'autres termes, repris-je en essayant d'adoucir
par un ton caressant ce que mes paroles pouvaient avoir
de sévère, vous voudriez l'aimer plus que vous-même, et
vous ne pouvez pas même l'aimer autant.»
Il trouva que je traitais sa douleur un peu plus cavalièrement
qu'il ne l'eût souhaité; mais tout ce qu'il me
dit pour modifier une opinion qui ne lui semblait pas à la
hauteur de sa souffrance, ne servit qu'à m'y confirmer.
Marthe rentra, et Horace, obligé de sortir à son tour, me
laissa avec elle. Ce que je voyais de leur intérieur ne
m'inspirait guère l'espoir de leur être utile. Pourtant je
ne voulais pas les quitter sans m'être bien assuré que
je ne pouvais rien pour adoucir leur infortune.
Je trouvais Marthe aussi peu disposée à me laisser pénétrer
dans son coeur, qu'Horace avait été prompt à
m'ouvrir le sien. Je devais m'y attendre: elle était l'offensée,
elle avait de justes sujets de plainte contre lui, et
une noble générosité la condamnait au silence. Pour
vaincre ses scrupules, je lui dis qu'Horace s'était accusé
devant moi, et m'avait confessé tous ses torts: c'était la
vérité. Horace ne s'était pas épargné; il m'avait dévoilé
ses fautes, tout en se défendant de la cause égoïste que
je leur assignais. Mais cet encouragement ne changea
rien aux résolutions que Marthe semblait avoir prises; je
remarquai en elle une sorte de courage sombre et de désespoir
morne que je n'aurais pas cru conciliables avec
l'enthousiaste mobilité et la sensibilité expansive que je
lui connaissais. Elle excusa Horace, me dit que la faute
était toute à la société, dont l'opinion implacable flétrit à
jamais la femme tombée, et lui défend de se relever en
inspirant un véritable amour. Elle refusa de s'expliquer
sur son avenir, me parla vaguement de religion et de résignation.
Elle refusa également l'offre que je lui fis de
lui amener Eugénie, en disant que ce rapprochement serait
bientôt brisé par les mêmes causes qui avaient
amené la désunion; et tout en protestant de son affection
profonde pour mon amie, elle me conjura de ne point lui
parler d'elle. La seule idée qui me parut arrêtée dans son
cerveau, parce qu'elle y revint à plusieurs reprises, fut
celle d'un devoir qu'elle avait à remplir, devoir mystérieux,
et dont elle ne détermina point la nature.
En examinant avec attention sa contenance et tous ses
mouvements, je crus observer qu'elle était enceinte; elle
était si peu disposée à la confiance, que je n'osai pas
l'interroger à cet égard, et me réservai de le faire en
temps opportun.
Quand je l'eus quittée, le coeur attristé profondément de
sa souffrance, je passai par hasard devant un café où Horace
avait l'habitude d'aller lire les journaux; et comme
il y était en ce moment, il m'appela et me força de m'asseoir
près de lui. Il voulait savoir ce que Marthe m'avait
dit; et moi, je commençai par lui demander si elle n'était
pas enceinte. Il est impossible de rendre l'altération
que ce mot causa sur son visage. «Enceinte! s'écria-t-il;
de quoi parlez-vous là, bon Dieu? Vous la croyez enceinte?
Elle vous a dit qu'elle l'était? Malédiction de tous
les diables! il ne me faudrait plus que cela!
—Qu'aurait donc de si effrayant une pareille nouvelle?
lui dis-je. Si Eugénie m'en annonçait une semblable,
je m'estimerais bien heureux!—Il frappa du poing
sur la table, si fort qu'il fit trembler toute la faïence de
l'établissement.
—Vous en parlez à votre aise, dit-il; vous êtes philosophe
d'abord, et ensuite vous avez trois mille livres de
rente et un état. Mais moi, que ferais-je d'un enfant? à
mon âge, avec ma misère, mes dettes, et mes parents,
qui seraient indignés! Avec quoi le nourrirais-je? avec
quoi le ferais-je élever? Sans compter que je déteste les
marmots, et qu'une femme en couches me représente
l'idée la plus horrible!... Ah! mon Dieu! vous me rappelez
qu'elle lit l'Emile, sans désemparer depuis quinze
jours! C'est cela, elle veut nourrir son enfant! elle va
lui donner une éducation à la Jean-Jacques, dans une
chambre de six pieds carrés! Me voilà père, je suis
perdu!»
Son désespoir était si comique, que je ne pus m'empêcher
d'en rire. Je pensai que c'était une de ces boutades
sans conséquence qu'Horace aimait à lancer, même sur
les sujets les plus sérieux, rien que pour donner un peu
de mouvement à son esprit, comme à un cheval ardent
qu'on laisse caracoler avant de lui faire prendre une allure
mesurée. J'avais bonne opinion de son coeur, et j'aurais
cru lui faire injure en lui remontrant gravement les
devoirs que sa jeune paternité allait lui imposer. D'ailleurs
je pouvais m'être trompé. Si Marthe eût été dans
la position que je supposais, Horace eût-il pu l'ignorer?
Nous nous séparâmes, moi riant toujours de son aversion
sarcastique pour les marmots, et lui continuant à déclamer
contre eux avec une verve inépuisable.
Je trouvai en rentrant chez moi une liste de malades
qui s'étaient fait inscrire. J'étais reçu médecin depuis
l'automne précédent, et je commençais ma carrière par
la sinistre et douloureuse épreuve du choléra. J'avais
donc tout à coup une clientèle plus nombreuse que je ne
l'aurais désiré, et je fus tellement accaparé pendant plusieurs
jours, que je ne revis Horace qu'au bout d'une
quinzaine. Ce fut sous l'influence d'un événement étrange
qui coupait court à toutes ses amères facéties sur la progéniture.
Il entra chez moi un matin, pâle et défait.
«Est-elle ici? fut le premier mot qu'il m'adressa.
—Eugénie? lui dis-je; oui, certainement, elle est dans
sa chambre.
—Marthe! s'écria-t-il avec agitation. Je vous parle de
Marthe; elle n'est point chez moi, elle a disparu. Théophile,
je vous le disais bien, que je devrais me couper
la gorge; Marthe m'a quitté, Marthe s'est enfuie avec
le désespoir dans l'âme, peut-être avec des pensées de
suicide.»
Il se laissa tomber sur une chaise, et, cette fois, son
épouvante et sa consternation n'avaient rien d'affecté.
Nous courûmes chez Arsène. Je pensais que cet ami fidèle
de Marthe avait pu être informé par elle de ses dispositions.
Nous ne trouvâmes que ses soeurs, dont l'air étonné
nous prouva sur-le-champ qu'elles ne savaient rien, et
qu'elles ne pressentaient pas même le motif de la visite
d'Horace. Comme nous sortions de chez elles, nous rencontrâmes
Paul qui rentrait. Horace courut à sa rencontre,
et, se jetant dans ses bras par un de ces élans
spontanés qui réparaient en un instant toutes ses injustices:
«Mon ami, mon frère, mon cher Arsène! s'écria-t-il
dans l'abondance de son coeur, dites-moi où elle est,
vous le savez, vous devez le savoir. Ah! ne me punissez
pas de mes crimes par un silence impitoyable. Rassurez-moi;
dites-moi qu'elle vit, qu'elle s'est confiée à vous. Ne
me croyez pas jaloux, Arsène. Non, à cette heure, je
jure Dieu que je n'ai pour vous qu'estime et affection. Je
consens à tout, je me soumets à tout! soyez son appui,
son sauveur, son amant. Je vous la donne, je vous la
confie; je vous bénis si vous pouvez, si vous devez lui
donner du bonheur; mais dites-moi qu'elle n'est pas
morte, dites-moi que je ne suis pas son bourreau, son
assassin!»
Quoique Marthe n'eût pas été nommée, comme il n'y
avait qu'elle au monde qui pût intéresser Arsène, il comprit
sur-le-champ, et je crus qu'il allait tomber foudroyé.
Il fut quelques instants sans pouvoir répondre. Ses dents
claquaient dans sa bouche, et il regardait Horace d'un air
hébété, en retenant dans sa main froide et fortement
contractée la main que ce dernier lui avait tendue. Il ne
fit aucune réflexion. Un mélange d'effroi et d'espoir le jetait
dans une sorte de délire farouche. Il se mit à courir
avec nous. Nous allâmes à la Morgue; Horace avait eu
déjà la pensée d'y aller; il n'en avait pas eu le courage.
Nous y entrâmes sans lui; il s'arrêta sous le portique, et
s'appuya contre la grille pour ne pas tomber, mais évitant
de tourner ses regards vers cet affreux spectacle,
qu'il n'aurait pu supporter s'il lui eût offert parmi les victimes
de la misère et des passions l'objet de nos recherches.
Nous pénétrâmes dans la salle, où plusieurs cadavres,
couchés sur les tables fatales, offraient aux regards
la plus hideuse plaie sociale, la mort violente dans toute
son horreur, la preuve et la conséquence de l'abandon,
du crime ou du désespoir. Arsène sembla retrouver son
courage au moment où celui d'Horace faiblissait; il s'approcha
d'une femme qui reposait là avec le cadavre de
son enfant enlacé au sien; il souleva d'une main ferme
les cheveux noirs que le vent rabattait sur le visage de la
morte, et comme si sa vue eût été troublée par un nuage
épais, il se pencha sur cette face livide, la contempla un
instant, et la laissant retomber avec une indifférence qui,
certes, ne lui était pas habituelle:
«Non,» dit-il d'une voix forte; et il m'entraîna pour
répéter vite à Horace ce non», qui devait le soulager momentanément.
Au bout de quelques pas, Arsène s'arrêtant:
«Montrez-moi encore, lui dit-il, le billet qu'elle vous
a laissé.»
Ce billet, Horace nous l'avait communiqué. Il le remit
de nouveau à Paul, qui le relut attentivement. Il était
ainsi conçu:
«Rassurez-vous, cher Horace, je m'étais trompée.
Vous n'aurez pas les charges et les ennuis de la paternité;
mais après tout ce que vous m'avez dit depuis
quinze jours, j'ai compris que notre union ne pouvait pas
durer sans faire votre malheur et ma honte. Il y a longtemps
que nous avons dû nous préparer mutuellement à
cette séparation, qui vous affligera, j'en suis sûre, mais
à laquelle vous vous résignerez, en songeant que nous
nous devions mutuellement cet acte de courage et de
raison. Adieu pour toujours. Ne me cherchez pas, ce serait
inutile. Ne vous inquiétez pas de moi, je suis forte
et calme désormais. Je quitte Paris; j'irai peut-être dans
mon pays. Je n'ai besoin de rien, je ne vous reproche
rien. Ne gardez pas de moi un souvenir amer. Je pars en
appellant sur vous la bénédiction du ciel.»
Celle lettre n'annonçait pas des projets sinistres; cependant
elle était loin de nous rassurer. Moi surtout, j'avais
trouvé naguère chez Marthe tous les symptômes d'un
désespoir sans ressource, et cette farouche énergie qui
conduit aux partis extrêmes.
«Il faut, dis-je à Horace, faire encore un grand
effort sur vous-même, et nous raconter textuellement ce
qui s'est passé entre vous depuis quinze jours; d'après
cela, nous jugerons de l'importance que nous devons
laisser à nos craintes. Peut-être les vôtres sont exagérées.
Il est impossible que vous ayez eu envers Marthe des procèdés
assez cruels pour la pousser à un acte de folie. C'est
un esprit religieux, c'est peut-être un caractère plus fort
que vous ne le pensez. Parlez, Horace; nous vous plaignons
trop pour songer à vous blâmer, quelque chose que
vous ayez à nous dire.
—Me confesser devant lui? répondit Horace en regardant
Arsène. C'est un rude châtiment; mais je l'ai mérité,
et je l'accepte. Je savais bien qu'il l'aimait, lui, et
que son amour était plus digne d'elle que le mien. Mon
orgueil souffrait de l'idée qu'un autre que moi pouvait lui
donner le bonheur que je lui déniais; et je crois que,
dans mes accès de délire, je l'aurais tuée plutôt que de
la voir sauvée par lui!
—Que Dieu vous pardonne! dit Arsène; mais avouez
jusqu'au bout. Pourquoi la rendiez vous si malheureuse?
Est-ce à cause de moi? Vous savez bien qu'elle ne m'aimait
pas!
—Oui, je le savais! dit Horace avec un retour d'orgueil
et de triomphe égoïste; mais aussitôt ses yeux
s'humectèrent et sa voix se troubla. Je le savais, continua-t-il,
mais je ne voulais seulement pas qu'elle t'estimât,
noble Arsène! C'était pour moi une injure sanglante
que la comparaison qu'elle pouvait faire entre nous
deux au fond de son coeur. Vous voyez bien, mes amis,
que, dans ma vanité, il y avait des remords et de la honte.
—Mais enfin, reprit Arsène, elle ne me regrettait pas
assez, elle ne pensait pas assez à moi, pour qu'il lui en
coûtât beaucoup de m'oublier tout à fait?
—Elle vous a longtemps défendu, répondit Horace
avec une énergie qui me portait à la fureur. Et puis tout
à coup elle ne m'a plus parlé de vous, elle s'y est résignée
avec un calme qui semblait me braver et me mépriser
intérieurement. C'est à cette époque que la misère
m'a contraint à lui laisser reprendre son travail, et
quoique j'eusse vaincu en apparence ma jalousie, je n'ai
jamais pu la voir sortir seule, sans conserver un soupçon
qui me torturait. Mais je le combattais, Arsène; je vous
jure qu'il m'arrivait bien rarement de l'exprimer. Seulement
quelquefois, dans des accents de colère, je laissais
échapper un mot indirect, qui paraissait l'offenser et la
blesser mortellement. Elle ne pouvait pas supporter
d'être soupçonnée d'un mensonge, d'une dissimulation
si légère qu'elle fût dans ma pensée. Sa fierté se révoltait
contre moi tous les jours dans une progression qui
me faisait craindre son changement ou son abandon.
Pourtant, depuis quelques semaines, j'étais plus maître
de moi, et, injuste qu'elle était! elle prenait ma vertu
pour de l'indifférence. Tout à coup une malheureuse circonstance
est venue réveiller l'orage. J'ai cru Marthe enceinte;
Théophile m'en a donné l'idée, et j'en ai été consterné.
Épargnez-moi l'humiliation de vous dire à quel
point le sentiment paternel était peu développé en moi.
Suis-je donc dans l'âge où cet instinct s'éveille dans le
coeur de l'homme? et puis l'horrible misère ne fait-elle
pas une calamité de ce qui peut être un bonheur en
d'autres circonstances? Bref, je suis rentré chez moi précipitamment,
il y a aujourd'hui quinze jours, en quittant
Théophile, et j'ai interrogé Marthe avec plus de terreur
que d'espérance, je l'avoue. Elle m'a laissé dans le doute;
et puis, irritée des craintes chagrines que je manifestais,
elle me déclara que si elle avait le bonheur de devenir
mère, elle n'irait pas implorer pour son enfant l'appui
d'une paternité si mal comprise et si mal acceptée par les
hommes de ma condition. J'ai vu là un appel tacite vers
vous, Arsène, je me suis emporté; elle m'a traité avec un
mépris accablant. Depuis ces quinze jours, notre vie a été
une tempête continuelle, et je n'ai pu éclaircir le doute
poignant qui en était cause. Tantôt elle m'a dit qu'elle
était grosse de six mois, tantôt qu'elle ne l'était pas, et,
en définitive, elle m'a dit que si elle l'était, elle me le
cacherait, et s'en irait élever son enfant loin de moi. J'ai
été atroce dans ces débats, je le confesse avec des larmes
de sang. Lorsqu'elle niait sa grossesse, j'en provoquais
l'aveu par une tendresse perfide, et lorsqu'elle l'avouait,
je lui brisais le coeur par mon découragement, mes malédictions,
et, pourquoi ne dirais-je pas tout? par des
doutes insultants sur sa fidélité, et des sarcasmes amers
sur le bonheur qu'elle se promettait de donner un héritier
à mes dettes, à ma paresse et à mon désespoir. Il y
avait pourtant des moments d'enthousiasme et de repentir
où j'acceptais cette destinée avec franchise et avec
une sorte de courage fébrile; mais bientôt je retombais
dans l'excès contraire, et alors Marthe, avec un dédain
glacial, me disait: «Tranquillisez-vous donc; je vous ai
trompé pour voir quel homme vous étiez. A présent que
j'ai la mesure de votre amour et de votre courage, je puis
vous dire que je ne suis pas grosse, et vous répéter que
si je l'étais, je ne prétendrais pas vous associer à ce que
je regarderais comme mon unique bonheur en ce monde.»
«Que vous dirai-je? chaque jour la plaie s'envenimait.
Avant-hier la mésintelligence fut plus profonde que la
veille, et puis hier, elle le fut à un excès qui m'eût semblé
devoir amener une catastrophe, si nous n'eussions
pas été comme blasés l'un et l'autre sur de pareilles douleurs.
A minuit, après une querelle qui avait duré deux
mortelles heures, je fus si effrayé de sa pâleur et de son
abattement, que je fondis en larmes. Je me mis à genoux,
j'embrassai ses pieds, je lui proposai de se tuer avec moi
pour en finir avec ce supplice de notre amour, au lieu de
le souiller par une rupture. Elle ne me répondit que par
un sourire déchirant, leva les yeux au ciel, et demeura
quelques instants dans une sorte d'extase. Puis, elle jeta
ses bras autour de mon cou, et pressa longtemps mon
front de ses lèvres desséchées par une fièvre lente. «Ne
parlons plus de cela, me dit-elle ensuite en se levant: ce
que vous craignez tant n'arrivera pas. Vous devez être
bien fatigué, couchez-vous; j'ai encore quelques points à
faire. Dormez tranquille; je le suis, vous voyez!»
«Elle était bien tranquille en effet! Et moi, stupide et
grossier dans ma confiance, je ne compris pas que c'était
le calme de la mort qui s'étendait sur ma vie. Je m'endormis
brisé, et je ne m'éveillai qu'au grand jour. Mon
premier mouvement fut de chercher Marthe, pour la remercier
à genoux de sa miséricorde. Au lieu d'elle, j'ai
trouvé ce fatal billet. Dans sa chambre rien n'annonçait
un départ précipité. Tout était rangé comme à l'ordinaire;
seulement la commode qui contenait ses pauvres
hardes était vide. Son lit n'avait pas été défait: elle ne
s'était pas couchée. Le portier avait été réveillé vers trois
heures du matin par la sonnette de l'intérieur; il a tiré
le cordon comme il fait machinalement dans ce temps de
choléra, où, à toute heure, on sort pour chercher ou
porter des secours. Il n'a vu sortir personne, il a entendu
refermer la porte. Et moi je n'ai rien entendu. J'étais là,
étendu comme un cadavre, pendant qu'elle accomplissait
sa fuite, et qu'elle m'arrachait le coeur de la poitrine pour
me laisser à jamais vide d'amour et de bonheur.»
Après le douloureux silence où nous plongea ce récit,
nous nous livrâmes à diverses conjectures. Horace était
persuadé que Marthe ne pouvait pas survivre à cette séparation,
et que si elle avait emporté ses hardes, c'était
pour donner à son départ un air de voyage, et mieux cacher
son projet de suicide. Je ne partageais plus sa terreur.
Il me semblait voir dans toute la conduite de Marthe
un sentiment de devoir et un instinct d'amour maternel
qui devaient nous rassurer. Quant à Arsène, après que
nous eûmes passé la journée en courses et en recherches
minutieuses autant qu'inutiles, il se sépara d'Horace, en
lui serrant la main d'un air contraint, mais solennel.
Horace était désespéré. «Il faut, lui dit Arsène, avoir
plus de confiance en Dieu. Quelque chose me dit au fond
de l'âme qu'il n'a pas abandonné la plus parfaite de ses
créatures, et qu'il veille sur elle.»
Horace me supplia de ne pas le laisser seul. Étant obligé
de remplir mes devoirs envers les victimes de l'épidémie,
je ne pus passer avec lui qu'une partie de la nuit. Laravinière
avait couru toute la journée, de son côté, pour retrouver
quelque indice de Marthe. Nous attendions avec
impatience qu'il fût rentré. Il rentra à une heure du
matin sans avoir été plus heureux que nous; mais il
trouva chez lui quelques lignes de Marthe, que la poste
avait apportées dans la soirée. «Vous m'avez témoigné
tant d'intérêt et d'amitié, lui disait-elle, que je ne veux
pas vous quitter sans vous dire adieu. Je vous demande
un dernier service: c'est de rassurer Horace sur mon
compte, et de lui jurer que ma position ne doit lui causer
d'inquiétude, ni au physique ni au moral. Je crois en
Dieu, c'est ce que je puis dire de mieux. Dites-le aussi à
mon frère Paul. Il le comprendra.»
Ce billet, en rendant à Horace une sorte de tranquillité,
réveilla ses agitations sur un autre point. La jalousie
revint s'emparer de lui. Il trouva dans les derniers mots
que Marthe avait tracés un avertissement et comme une
promesse détournée pour Paul Arsène. «Elle a eu, en
s'unissant à moi, dit-il, une arrière-pensée qu'elle a toujours
conservée et qui lui revenait dans tous les mécontentements
que je lui causais. C'est cette pensée qui lui a
donné la force de me quitter. Elle compte sur Paul, soyez-en
sûrs! Elle conserve encore pour notre liaison un certain
respect qui l'empêchera de se confier tout de suite à
un autre. J'aime à croire, d'ailleurs, que Paul n'a pas
joué la comédie avec moi aujourd'hui, et qu'en m'aidant
à chercher Marthe jusqu'à la Morgue, il n'avait pas
au fond du coeur l'égoïste joie de la savoir vivante et résignée.
—Vous ne devez pas en douter, répondis-je avec vivacité;
Arsène souffrait le martyre, et je vais tout de suite,
en passant, lui faire part de ce dernier billet, afin qu'il
repose en paix, ne fût-ce qu'une heure ou deux.
—J'y vais moi-même, dit Laravinière; car son chagrin
m'intéresse plus que tout le reste.» Et sans faire attention
au regard irrité que lui lançait Horace, il lui reprit
le billet des mains, et sortit.
«Vous voyez bien qu'ils sont tous d'accord pour me
jouer! s'écria Horace furieux. Jean est l'âme damnée de
Paul, et l'entremetteur sentimental de cette chaste intrigue.
Paul, qui doit si bien comprendre, au dire de
Marthe, comment et pourquoi elle croit en Dieu (mot
d'ordre que je comprends bien aussi, allez!...), Paul va
courir en quelque lieu convenu, où il la trouvera; ou
bien il dormira sur les deux oreilles, sachant qu'après
deux ou trois jours donnés aux larmes qu'elle croit me
devoir, l'infidèle orgueilleuse l'admettra à offrir ses consolations.
Tout cela est fort clair pour moi, quoique arrangé
avec un certain art. Il y a longtemps qu'on cherchait
un prétexte pour me répudier, et il fallait me
donner tort. Il fallait qu'on pût m'accuser auprès de mes
amis, et se rassurer soi-même contre les reproches de la
conscience. On y est parvenu; on m'a tendu un piège en
feignant, c'est-à-dire en feignant de feindre une grossesse.
Vous avez été innocemment le complice de cette
belle machination; on connaissait mon faible: on savait
que cette éventualité m'avait toujours fait frémir. On m'a
fourni l'occasion d'être lâche, ingrat, criminel... Et quand
on a réussi à me rendre odieux aux autres et à moi-même,
on m'abandonne avec des airs de victime miséricordieuse!
C'est vraiment ingénieux! Mais il n'y aura que
moi qui n'en serai pas dupe; car je me souviens comment
on a abandonné le Minotaure, et comment on s'est
tenu caché pour laisser passer la première bourrasque de
colère et de chagrin. Lui aussi, le pauvre imbécile, a cru
à un suicide! lui aussi, il a été à la police et à la Morgue!
lui aussi, sans doute, a trouvé un billet d'adieu et de
belles phrases de pardon au bout d'une trahison consommée
avec Paul Arsène! Je pense que c'est un billet
tout pareil au mien; le même peut servir dans toutes les
circonstances de ce genre!...»
Horace parla longtemps sur ce ton avec une âcreté
inouïe. Je le trouvai en cet instant si absurde et si injuste,
que, n'ayant pas le courage de le blâmer hautement,
mais ne partageant nullement ses soupçons, je
gardai le silence. Après tout, comme j'étais forcé de le
laisser à lui-même jusqu'au lendemain, j'aimais mieux le
voir ranimé par des dispositions amères que terrassé par
l'inquiétude insupportable de la journée. Je le quittai
sans lui rien dire qui pût influencer son jugement.
More History
|