|


 Explorers, Scientists &
Inventors
Explorers, Scientists &
Inventors
 Musicians, Painters &
Artists
Musicians, Painters &
Artists
 Poets, Writers &
Philosophers
Poets, Writers &
Philosophers
 Native Americans & The Wild
West
Native Americans & The Wild
West
 First Ladies
First Ladies
 Popes
Popes
 Troublemakers
Troublemakers
 Historians
Historians
 Archaeologists
Archaeologists
 Royal
Families
Royal
Families
 Tribes & Peoples
Tribes & Peoples
Assassinations in History
Who
got slain, almost slain, when, how,
why, and by whom?
 Go to the
Assassination Archive
Go to the
Assassination Archive

Online History Dictionary A - Z



Voyages in History
When did what
vessel arrive with whom onboard and where
did it sink if it didn't?
 Go to the
Passage-Chart
Go to the
Passage-Chart


The Divine Almanac
Who all roamed the heavens in
olden times? The Who's Who of
ancient gods.
 Check out
the Divine Almanac
Check out
the Divine Almanac

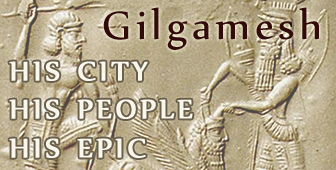
|
|
George Sand - Horace: Chapter 27-30
Notice
Chapter 1 - 5
Chapter 6 - 12
Chapter 13 - 19
Chapter 20 - 23
Chapter 24 - 26
Chapter 27 - 30
Chapter 31 - 33
|
|
XXVII.
Ce jour de bonheur, mémorable et funeste entre tous
dans la vie d'Horace, fut enregistré d'une manière plus
sérieuse et plus solennelle dans l'histoire. C'était le
5 juin 1832; et quoique j'aie passé ce jour et le lendemain
dans l'ignorance complète de la tragédie imprévue
dont Paris était le théâtre, et où plusieurs de mes amis
furent acteurs, j'interromprai le récit des bonnes fortunes
d'Horace pour suivre Arsène et Laravinière au milieu du
drame sanglant d'une révolution avortée. Ma tâche n'est
pas de rappeler des événements dont le souvenir est encore
saignant dans bien des coeurs. Je n'ai rien su de
particulier sur ces événements, sinon la part que mes amis
y ont prise. J'ignore même comment Laravinière y fut
mêlé, s'il les avait prévus, ou s'il s'y jeta inopinément,
poussé par les provocations de la force militaire au convoi
de l'illustre Lamarque, et par le désordre encore mal
expliqué de cette déplorable journée. Quoi qu'il en soit,
cette lutte ne pouvait passer devant lui sans l'entraîner.
Elle entraîna aussi Arsène, qui n'en espérait point le
succès; mais qui, désirant la mort, et voyant son cher
Jean la chercher derrière les barricades, s'attacha à ses
pas, partagea ses dangers, et subit l'héroïque et sombre
enivrement qui gagna les défenseurs désespérés de ces
nouvelles Thermopyles. A l'heure dernière de ces martyrs,
comme la troupe envahissait le cloître Saint-Méry,
Laravinière, déjà criblé, tomba frappé d'une dernière
Balle.
«Je suis mort, dit-il à Arsène, et la partie est perdue.
Mais tu peux fuir encore; pars!
—Jamais, dit Arsène en se jetant sur lui; ils me tueront
sur ton corps.
|
—Et Marthe! répondit Laravinière, Marthe qui existe
peut-être, et qui n'a que toi sur la terre! La dernière
volonté d'un mourant est sacrée. Je te lègue l'avenir de
Marthe, et je t'ordonne de sauver ta vie pour elle. Puisqu'il
n'y a plus rien à faire ici, tu peux et tu dois te
soustraire à ces bourreaux qui s'approchent, ivres de
vengeance et de vin; pauvres soldats qui se croient vainqueurs
cent contre un!»
Deux minutes après, l'intrépide Jean tomba inanimé
sur le sein d'Arsène. La maison, dernier refuge des insurgés,
était envahie. Arsène fut un de ceux qui s'échappèrent
par un toit. Cette évasion tint du miracle, et arracha
malheureusement peu de braves à la furie des
assaillants. Caché à plusieurs reprises dans des cheminées,
dans des lucarnes de greniers, vingt fois aperçu et
poursuivi, vingt fois soustrait aux recherches avec un bonheur
qui semblait proclamer l'intervention de la Providence,
Arsène, couvert de blessures, brisé par plusieurs
chutes, se sentant à bout de ses forces et de son courage,
tenta un dernier effort pour disputer une vie à laquelle
une faible espérance le rattachait à peine. Il s'agissait de
sauter d'un toit à l'autre pour entrer dans une mansarde
par une fenêtre inclinée qu'il apercevait à quelques pieds
de distance. Ce n'était qu'un pas à faire, un instant de
résolution et de sang-froid à ressaisir; mais Arsène était
mourant et à demi fou. Le sang de Laravinière, mêlé au
sien, était chaud sur sa poitrine, sur ses mains engourdies,
sur ses tempes embrasées. Il avait le vertige. La
douleur morale était si violente qu'elle ne lui permettait
pas de sentir la douleur physique; et cependant l'instinct
de la conservation le guidait encore, sans qu'il pût se
rendre compte de l'épuisement qui augmentait avec rapidité,
sans qu'il eût connaissance de l'agonie qui commençait.
«Mon Dieu, pensa-t-il en s'approchant de la
fente entre les deux toits, si ma vie est encore bonne à
quelque chose, conserve-la; sinon, permets qu'elle s'éloigne
bien vite!» Et penchant le corps en avant, il se
laissa tomber plutôt qu'il ne s'élança sur le bord opposé.
Alors, se traînant sur ses genoux et sur ses coudes, car
ses pieds et ses mains lui refusaient le service, il parvint
jusqu'à la fenêtre qu'il cherchait, l'enfonça en posant ses
deux genoux sur le vitrage, et, laissant porter sur ce dernier
obstacle tout le poids de son corps, s'abandonnant avec
indifférence à la générosité ou à la lâcheté de ceux qu'il
allait surprendre dans cette misérable demeure, il roula
évanoui sur le carreau de la mansarde. En recevant ce
dernier choc qu'il ne sentit pas, il eut comme une réaction
de lucidité qui dura à peine quelques secondes. Ses
yeux virent les objets; son cerveau les comprit à peine,
mais son coeur éprouva comme un dilatement de joie
qui éclaira son visage au moment où il perdit connaissance.
Qu'avait-il donc vu dans cette mansarde? Une femme
pâle, maigre, et misérablement vêtue, assise sur son grabat
et tenant dans ses bras un enfant nouveau-né, qu'elle
cacha avec épouvante derrière elle, en voyant un homme
tomber du toit à ses pieds. Arsène avait reconnu cette
femme. Pendant un instant aussi rapide que l'éclair, mais
aussi complet qu'une éternité dans sa pensée, il l'avait
contemplée; et, oubliant tout ce qu'il avait souffert comme
tout ce qu'il avait perdu, il avait goûté un bonheur que
vingt siècles de souffrance n'eussent pu effacer. C'est
ainsi qu'il exprima par la suite cet instant ineffable dans
sa vie, qui lui avait ouvert une source de réflexions nouvelles
sur la fiction du temps créée par les hommes, et
sur la permanence de l'abstraction divine.
Marthe ne l'avait pas reconnu. Brisée, elle aussi, par
la souffrance, la misère et la douleur, elle n'était pas soutenue
par une exaltation fébrile qui pût la ranimer tout
d'un coup et lui faire sentir la joie au sein du désespoir.
Elle fut d'abord effrayée; mais elle ne chercha pas longtemps
l'explication d'une visite aussi étrange. Toute la
journée, toute la nuit précédente, toute la veille, attentive
aux bruits sinistres du combat, dont le théâtre était
voisin de sa demeure, elle n'avait eu qu'une pensée:
«Horace est là, se disait-elle, et chacun de ces coups de
fusil que j'entends peut avoir sa poitrine pour but.» Horace
lui avait fait pressentir cent fois qu'il se jetterait
dans la première émeute; elle le croyait capable de persister
dans une telle résolution. Elle avait pensé aussi à
Laravinière, qu'elle savait ardent et prêt à toutes ces
luttes; mais elle avait entendu tant de fois Arsène détester
les tragiques souvenirs des journées de 1830,
qu'elle ne le supposait pas mêlé à celles-ci. Lorsqu'elle
vit un homme tomber expirant devant elle, elle comprit
que c'était un fugitif, un vaincu, et, de quelque parti
qu'il fût, elle se leva pour le secourir. Ce ne fut qu'en
approchant sa lampe de ce visage noirci de poudre et
souillé de sang, qu'elle songea à Arsène; mais elle n'en
crut pas ses yeux. Elle prit son tablier pour étancher ce
sang et pour essuyer cette poudre, sans peur et sans dégoût:
les malheureux ne sont guère susceptibles de
telles faiblesses. Elle se pencha sur cette tête meurtrie et
défigurée, qu'elle venait de poser sur ses genoux tremblants;
et alors seulement elle fut certaine que c'était là
son frère dévoué, son meilleur ami. Elle le crut mort, et,
laissant tomber son visage sur cette face livide qui lui
souriait encore avec une bouche contractée et des yeux
éteints, elle l'embrassa à plusieurs reprises, et resta sans
verser une larme, sans exhaler un gémissement, plongée
dans un désespoir morne, voisin de l'idiotisme.
Quand elle eut recouvré quelque présence d'esprit,
elle chercha dans le battement des artères à retrouver
quelque symptôme de vie. Il lui sembla que le pouls battait
encore; mais le sien propre était si gonflé, qu'elle ne
sentait pas distinctement et qu'elle ne put s'assurer de la
vérité. Elle marcha vers la porte pour appeler quelques
voisins à son aide; mais, se rappelant aussitôt que parmi
ces gens, qu'elle ne connaissait pas encore, un scélérat ou
un poltron pouvait livrer le proscrit à la vengeance des
lois, elle tira le verrou de la porte, revint vers Arsène,
joignit les mains, et demanda tout haut à Dieu, son seul
refuge, ce qu'il fallait faire. Alors, obéissant à un instinct
subit, elle essaya de soulever ce corps inerte. Deux fois
elle tomba à côté de lui sans pouvoir le déranger; puis
tout à coup, remplie d'une force surnaturelle, elle l'enleva
comme elle eût fait d'un enfant, et le déposa sur son lit
de sangle, à côté d'un autre infortuné, d'un véritable enfant
qui dormait là, insensible encore aux terreurs et
aux angoisses de sa mère. «Tiens, mon fils, lui dit-elle
avec égarement, voilà comme ta vie commence; voilà du
sang pour ton baptême, et un cadavre pour ton oreiller.»
Puis elle déchira des langes pour essuyer et fermer les
blessures d'Arsène. Elle lava son sang collé à ses cheveux;
elle contint avec ses doigts les veines rompues, elle
réchauffa ses mains avec son haleine, elle pria Dieu avec
ferveur du fond de son âme désolée. Elle n'avait rien, et
ne pouvait rien de plus.
Dieu vint à son secours, et Arsène reprit connaissance.
Il fit un violent effort pour parler.
«Ne prends pas tant de peine, lui dit-il; si mes blessures
sont mortelles, il est inutile de les soigner; si elles
ne le sont pas, il importe peu que je sois soulagé un peu
plus tôt. D'ailleurs je ne souffre pas; assieds-toi là, donne-moi
seulement un peu d'eau à boire, et puis laisse-moi
ce mouchoir, j'arrêterai moi-même le sang qui coule de
ma poitrine. Laisse ta main sur ma tempe, je n'ai pas
besoin d'autre appareil. Dis-moi que je ne rêve pas, car
je suis heureux!... Heureux?» ajouta-t-il avec effroi en
se ravisant, car le souvenir de Laravinière venait de se
réveiller. Mais en songeant que Marthe avait bien assez
à souffrir, il lui cacha l'horreur de cette pensée, et garda
le silence. Il but l'eau avec une avidité qu'il réprima aussitôt.
«Ote-moi ce verre, lui dit-il; quand les blessés boivent,
ils meurent aussitôt. Je ne veux pas mourir, Marthe; à
cause de toi, il me semble que je ne dois pas mourir.
Cependant il fut durant toute cette nuit entre la mort
et la vie. Dévoré d'une soif furieuse, il eut le courage de
s'abstenir. Marthe était parvenue à arrêter le sang. Les
blessures, quoique profondes, ne constituaient pas par
elles-mêmes l'imminence du danger; mais l'exaltation, le
chagrin et la fatigue allumaient en lui une fièvre délirante,
et il sentait du feu circuler dans ses artères. S'il
eût cédé aux transports qui le gagnaient, il se fût ôté la
vie; car il sentait la rage de destruction qui l'avait possédé
depuis deux jours se tourner maintenant contre lui-même.
Dans cet état violent, il conservait cependant
assez de force pour combattre son mal: son âme n'était
pas abattue. Cette âme puissante, aux prises avec la désorganisation
de la vie physique, ressentait un trouble
cruel, mais se raidissait contre ses propres détresses, et,
par des efforts presque surhumains, elle terrassait les
fantômes de la fièvre et les suggestions du désespoir.
Vingt fois il se leva, prêt à déchirer ses blessures, à repousser
Marthe, que par instants il ne reconnaissait plus
et prenait pour un ennemi, à trahir le secret de sa retraite
par des cris de fureur, à se briser la tête contre
les murs. Mais alors il se faisait en lui des miracles de
volonté. Son esprit, profondément religieux, conservait,
jusque dans l'égarement, un instinct de prière et d'espérance;
et il joignait les mains en s'écriant: «Mon Dieu!
qu'est-ce que c'est? où suis-je? que se passe-t-il en moi
et hors de moi? M'abandonneriez-vous, mon Dieu? ne
me donnerez-vous pas du moins une fin pieuse et résignée?»
Puis, se tournant vers Marthe: «Je suis un
homme, n'est-ce pas? lui disait-il; je ne suis pas un assassin,
je n'ai pas versé à dessein le sang innocent! je
n'ai pas perdu le droit de l'invoquer! Dis-moi que c'est
bien toi qui es là, Marthe! dis-moi que tu espères, que tu
crois! Prie, Marthe, prie pour moi et avec moi, afin que
je vive ou que je meure comme un homme, et non pas
comme un chien.»
Puis il enfonçait son visage sur le traversin, pour
étouffer les rugissements qui s'échappaient de sa poitrine;
il mordait les draps pour empêcher ses dents de
se broyer les unes contre les autres; et quand les objets
prenaient à ses yeux des formes chimériques, quand
Marthe se transformait dans son imagination en visions
effrayantes, il fermait les yeux, il rassemblait ses idées,
il forçait les hallucinations à céder devant la raison; et de
la main écartant les spectres, il les exorcisait au nom de
la foi et de l'amour.
Cette lutte épouvantable dura près de douze heures.
Marthe avait pris son enfant dans ses bras; et lorsque
Paul perdait courage et s'écriait douloureusement: «Mon
Dieu, mon Dieu! voilà que vous m'abandonnez encore!»
elle se prosternait et tendait à Arsène cette innocente
créature, dont la vue semblait lui imposer une sorte de
respect craintif. Arsène n'avait encore exprimé aucune
pensée par rapport à cet enfant. Il le voyait, il le regardait
avec calme; il ne faisait aucune question; mais dès
qu'il avait, malgré lui, laissé échapper un gémissement
ou un sanglot, il se retournait vivement pour voir s'il ne
l'avait pas éveillé. Une fois, après un long silence et une
immobilité qui ressemblait à de l'extase, il dit tout à
coup:
«Est-ce qu'il est mort?
—Qui donc? demanda Marthe.
—L'enfant, répondit-il, l'enfant qui ne crie plus! il
faut cacher l'enfant, les brigands triomphent, ils le tueront.
Donne-moi l'enfant que je le sauve; je vais l'emporter
sur les toits, et ils ne le trouveront pas. Sauvons
l'enfant: vois-tu, tout le reste n'est rien, mais un enfant,
c'est sacré.»
Et ainsi en proie à un délire où l'idée du devoir et du
dévouement dominait toujours, il répéta cent fois: «L'enfant,
l'enfant est sauvé, n'est-ce pas?... Oh! sois tranquille
pour l'enfant, nous le sauverons bien.»
Quand il revenait à lui-même, il le regardait, et ne
disait plus rien. Enfin cette agitation se calma, et il dormit
pendant une heure. Marthe, épuisée, avait replacé
l'enfant sur le lit, à côté du moribond. Assise sur une
chaise, d'un de ses bras elle entourait son fils pour le
préserver, de l'autre elle soutenait la tête de Paul; la
sienne était tombée sur le même coussin; et ces trois infortunés
reposèrent ainsi sous l'oeil de Dieu, leur seul refuge,
isolés du reste de l'humanité par le danger, la misère
et l'agonie.
Mais bientôt ils furent réveillés par une sourde rumeur
qui se faisait autour d'eux. Marthe entendit des voix inconnues,
des pas lourds et pressés qui lui glacèrent le
coeur d'épouvante. Des agents de police visitaient les
mansardes, cherchant des victimes. On approchait de la
sienne. Elle jeta les couvertures sur Arsène, nivela le lit
avec ses hardes, qu'elle cacha sous les draps, et, plaçant
son enfant sur Arsène lui-même, elle alla ouvrir la porte
avec la résolution et la force que donnent les périls extrêmes.
Les débris du châssis de sa fenêtre avaient été
cachés dans un coin de la chambre; elle avait attaché
son tablier en guise de rideau devant cette fenêtre brisée
pour voiler le dégât. Une voisine charitable, chez qui on
venait de faire des perquisitions, suivit les sbires jusqu'au
seuil de Marthe.
«Ici, mes bons messieurs, leur dit-elle, il n'y a qu'une
pauvre femme à peine relevée de couches, et encore bien
malade. Ne lui faites pas peur, mes bons messieurs, elle
en mourrait.»
Cette prière ne toucha guère les êtres sans coeur et
sans pitié auxquels elle s'adressait; mais le sang-froid
avec lequel Marthe se présenta devant eux leur ôta tout
soupçon. Un coup d'oeil jeté dans sa chambre trop petite
et trop peu meublée pour receler une cachette, leur persuada
l'inutilité d'une recherche plus exacte. Ils s'éloignèrent
sans remarquer des traces de sang mal effacées
sur le carreau, et ce fut encore un des miracles qui concoururent
au salut d'Arsène. La vieille voisine était une
digne et généreuse créature qui avait assisté Marthe dans
les douleurs de l'enfantement. Elle l'aida à cacher le
proscrit, se chargea de lui apporter des aliments et quelques
remèdes; mais, ne connaissant aucun médecin dont
les opinions pussent lui garantir le silence, et terrifiée
par les rigueurs vraiment inquisitoriales qui furent déployées
à l'égard des victimes du cloître Saint-Méry, elle
se borna aux secours insuffisants qu'elle pouvait fournir
elle-même. Marthe n'osait faire un pas hors de sa chambre,
dans la crainte qu'on ne revint l'explorer en son
absence. D'ailleurs Arsène était devenu si calme que
l'inquiétude s'était dissipée, et qu'elle comptait sur une
prompte guérison.
Il n'en fut pas ainsi. La faiblesse se prolongea au point
que, pendant plus d'un mois, il lui fut impossible de
sortir du lit. Marthe coucha tout ce temps sur une botte
de paille, qu'elles était procurée sous prétexte de se faire
une paillasse; mais elle n'avait pas le moyen d'en acheter
la toile. La vieille voisine était dans une indigence complète.
L'état du malade et son propre accablement ne
permettaient pas à Marthe de travailler, encore moins de
sortir pour chercher de l'ouvrage. Depuis deux mois
qu'elle s'était séparée d'Horace, résolue de n'être à charge
à personne en devenant mère, elle avait vécu du prix de
ses derniers effets vendus ou engagés au Mont-de-Piété;
sa délivrance ayant été plus longue et pus pénible
qu'elle ne l'avait prévu, elle avait épuisé cette faible ressource,
et se trouvait dans un dénûment absolu. Arsène
n'était pas plus heureux. Depuis quelque temps; prévoyant,
d'après les discours de Laravinière, un bouleversement
dans Paris, et voulant être libre de s'y jeter,
il avait donné toutes ses petites épargnes à ses soeurs, et
les avait renvoyées en province. Croyant n'avoir plus
qu'à mourir, il n'avait rien gardé. La situation de ces
deux êtres abandonnés était donc épouvantable. Tous
deux malades, tous deux brisés; l'un cloué sur un lit de
douleur, l'autre allaitant un enfant, ne vivant que de
pain et dormant sur la paille, n'étant pas même abritée
dans cette mansarde dont elle n'osait pas faire réparer la
fenêtre, puisqu'un secret de mort était lié à cette trace
d'effraction, et n'ayant d'ailleurs pas la force de faire un
pas. Et puis, ajoutez à ces empêchements une sorte d'apathie
et d'impuissance morale, causée par les privations,
l'épuisement, une habitude de fierté outrée, et
l'isolement qui paralyse toutes les facultés: et vous
comprendrez comment, pouvant avertir Eugénie et moi
avec quelques précautions et un peu moins d'orgueil,
ils se laissèrent dépérir en silence durant plusieurs semaines.
L'enfant fut le seul qui ne souffrit pas trop de cette détresse.
Sa mère avait peu de lait; mais la voisine partageait
avec le nourrisson celui de son déjeuner, et chaque
jour elle allait le promener dans ses bras au soleil du
quai aux Fleurs. Il n'en faut pas davantage à un enfant
de Paris pour croître comme une plante frêle, mais tenace,
le long de ces murs humides où la vie se développe
en dépit de tout, plus souffreteuse, plus délicate, et cependant
plus intense qu'à l'air pur des champs.
Pendant cette dure épreuve, la patience d'Arsène ne se
démentit pas un instant; il ne proféra pas une seule
plainte, quoiqu'il souffrît beaucoup, non de ses blessures,
qui ne s'envenimèrent plus et se fermèrent peu à peu
sans symptômes alarmants, mais d'une violente irritation
du cerveau qui revenait sans cesse et faisait place à de
profonds accablements. Entre l'exaltation et l'affaissement,
il eut peu d'intervalles pour s'entretenir avec
Marthe. Dans la fièvre, il s'imposait un silence absolu,
et Marthe ignorait alors combien il était malade. Dans le
calme, il ménageait à dessein ses forces, afin de pouvoir
lutter contre le retour de la crise. Il résulta de cette résolution
stoïque une guérison dont la lenteur surprit Marthe,
parce qu'elle ne comprenait pas la gravité du mal, et
dont la rapidité me parut inexplicable, lorsque, par la
suite, je tins de la bouche d'Arsène le détail de tout ce
qu'il avait souffert. Par instants, malgré la confiance qu'il
avait su lui donner, Marthe s'effrayait pourtant de l'espèce
d'indifférence avec laquelle il semblait attendre sa guérison
sans la désirer. Elle pensait alors que ses facultés
mentales avaient reçu une grave atteinte, et craignait
qu'il n'en retrouvât jamais complètement la vigueur. Mais
tandis qu'elle s'abandonnait à cette sinistre conjecture,
Arsène, plein de persistance et de détermination, comptait
les jours et les heures; et sentant les accès de son mal
diminuer lentement, il en concluait avec raison qu'une
grave rechute était imminente, à moins qu'il ne gardât
les rênes de sa volonté toujours également tendues. Il
voulait donc s'abstenir de toute émotion violente, de tout
découragement puéril, et semblait ne pas voir l'horreur
de la situation que Marthe partageait avec lui.
Un jour qu'il avait les yeux fermés et semblait dormir,
il entendit la vieille voisine exprimer de l'intérêt à
Marthe, selon la portée de ses idées et de ses sentiments
bons et humains sans doute, mais bornés et un peu grossiers.
«Savez-vous, mon coeur, lui disait-elle, que c'est
un grand malheur pour vous d'avoir été forcée de recueillir
cet homme-là? Vous étiez déjà bien assez dépourvue,
et voilà que vous êtes obligée de partager avec lui un
pauvre morceau de pain quotidien qui vous ferait du lait
pour votre enfant!
—Que ne puis-je partager, en effet, ma bonne amie!
répondit Marthe avec un triste sourire; mais il ne mange
pas une once de pain par jour dans sa soupe. Et quelle
soupe! une goutte de lait dans une pinte d'eau; je ne
comprends pas qu'il vive ainsi.
—Aussi cela va durer éternellement, cette maladie!
répondit la vieille; il ne pourra jamais retrouver ses forces
avec un pareil régime. Vous aurez beau faire, vous vous
épuiserez sans pouvoir le sauver.
—J'aimerais mieux mourir avec lui que de l'abandonner,
dit Marthe.
—Mais si vous faites mourir votre enfant? dit la
vieille.
—Dieu ne le permettra pas! s'écria Marthe épouvantée.
—Je ne dis pas que cela arrive, reprit la vieille avec
douceur; je ne dis pas non plus que votre dévouement
pour ce réfugié soit poussé trop loin. Je sais ce qu'on doit
à son prochain; mais ce serait à lui de comprendre qu'il
ne se sauve de l'échafaud que pour vous conduire avec
lui à l'hôpital. Le pauvre jeune homme ne peut pas savoir
combien il vous nuit. Il ne voit pas qu'à dormir sur
la paille, comme vous faites, avec une fenêtre ouverte
sur le dos, vous ne pouvez pas durer longtemps. La maladie
lui ôte la réflexion, c'est tout simple; mais si vous
me permettiez de lui parler, je vous assure que le jour
même il prendrait son parti de se traîner dehors comme
il pourrait. Tenez, à nous deux, en le soutenant bien,
nous le conduirions à l'hôpital; il y serait mieux qu'ici.
—A l'hôpital! s'écria Marthe en pâlissant. N'avez-vous
pas entendu dire (et ne me l'avez-vous pas répété),
qu'il était enjoint aux médecins de livrer les blessés qui
se confieraient à leurs soins, et que chaque malade accueilli
dans un hospice était désigné à l'examen de la police
par un écriteau placé au-dessus de son lit? Comment!
la délation est imposée (sous peine d'être accusés
de complicité) aux hommes dont les fonctions sont les
plus saintes; et vous voulez que j'abandonne cette victime
à la vengeance d'une société où de tels ordres sont acceptés
de tous sans révolte, et peut-être sans horreur de
la part de beaucoup de gens? Non, non, si le monde est
devenu un coupe-gorge, du moins il reste dans le coeur
des pauvres femmes, et sous les tuiles de nos mansardes,
un peu de religion et d'humanité, n'est-ce pas, bonne
voisine?
—Allons! répondit la voisine en essuyant ses yeux
avec le coin de son tablier, voilà que vous faites de moi
ce que vous voulez. Je ne sais pas où vous prenez ce que
vous dites, mon enfant; mais vous parlez selon Dieu et
selon mon coeur. Je vais vous chercher un peu de lait et
de sucre pour votre malade, et aussi pour ce cher trésor,
ajouta-t-elle en embrassant l'enfant suspendu au sein de
sa mère.
—Non, ma chère amie, dit Marthe, ne vous dépouillez
pas pour nous; vous avez déjà assez fait. Il n'est pas juste
qu'à votre âge vous vous condamniez à souffrir. Nous
sommes jeunes, nous autres, et nous avons la force de
nous priver un peu.
—Et si je veux me priver, si je veux souffrir, moi!
s'écria la bonne femme tout en colère; me prenez-vous
pour un mauvais coeur, pour une avare, pour une égoïste?
Avez-vous le droit de me refuser, d'ailleurs, quand il s'agit
d'un amour d'enfant comme le vôtre, et d'un malheureux
que le bon Dieu nous confie?
—Eh bien, j'accepte, répondit Marthe en jetant ses
bras amaigris et couverts de haillons au cou de la vieille
femme; j'accepte avec joie. Un jour viendra, qui n'est
pas loin peut-être, où nous vous rendrons tout le bien
que vous nous faites maintenant; car Dieu aussi nous
rendra la force et la liberté!
—Tu as raison, Marthe, dit Arsène d'une voix faible
et mesurée, lorsque la voisine fut sortie. La liberté nous
sera rendue, et la force nous reviendra. Ta pitié me
sauve, et j'aurai mon tour. Va, ma pauvre Marthe, conserve
ton courage, comme j'entretiens le mien dans le
silence et la soumission. Il m'en faut plus qu'à toi pour
te voir souffrir comme tu fais, et pour songer sans désespoir
que non-seulement je ne puis te soulager, mais que
encore j'augmente ta misère. Durant les premiers jours,
je me suis souvent demandé si je ne ferais pas mieux de
remonter sur les toits, et de m'en aller mourir dans quelque
gouttière, comme un pauvre oiseau dont on a brisé
l'aile; mais j'ai senti, à ma tendresse pour toi, que je
surmonterais cette maladie; qu'à force de vouloir vivre
je vivrais, et qu'en acceptant ton appui, je t'assurais le
mien pour l'avenir. Vois-tu, Marthe, Dieu sait bien ce
qu'il fait! Dans ta fierté, tu t'étais éloignée et cachée de
moi. Tu voulais passer ta vie dans l'isolement, dans la
douleur et dans le besoin, plutôt que d'accepter mon dévouement.
A présent que la destinée m'a envoyé ici pour
profiler du tien, tu ne pourras plus me repousser, tu
n'auras plus le droit de refuser mon appui. Je ne t'offre
rien que mon coeur et mes bras, Marthe; car je ne possède
ni or, ni argent, ni vêtement, ni asile, ni talent,
ni protection; mais mon coeur te chérit, et mes bras
pourront te nourrir, toi et ce cher trésor, comme dit la
voisine.»
En parlant ainsi, Paul prit l'enfant et l'embrassa; c'était
la première marque d'affection qu'il lui donnait. Jusqu'à
ce jour, il l'avait souvent soutenu et bercé sur ses
genoux pour soulager la mère; il l'avait endormi toutes
les nuits à plusieurs reprises dans ses bras, et réchauffé
contre sa poitrine, mais en lui donnant ces soins, il ne
l'avait jamais caressé. En cet instant, une larme de tendresse
coula de ses yeux sur le visage de l'enfant, et
Marthe l'y recueillit avec ses lèvres. «Ah! mon Paul,
ah! mon frère! s'écria-t-elle, si tu pouvais l'aimer, ce
cher et douloureux trésor!
—Tais-toi, Marthe, ne parlons pas de cela, répondit-il
en lui rendant son fils. Je suis encore trop faible;
je ne t'ai pas encore dit un mot là-dessus. Nous en parlerons,
et tu seras contente de moi, je l'espère. En attentant,
souffrons encore, puisque c'est la volonté divine.
Je vois bien que tu jeûnes, je vois bien que tu couches
sur le carreau avec une poignée de paille sous ta tête, et
je n'ose pas seulement te dire: Reprends ton lit, et
laisse-moi m'étendre sur cette litière; car, à cette idée-là,
tu te révoltes, et tu m'accables d'une bonté qui me fait
trop de mal et trop de bien. Il faut que je reste là, que
je subisse la vue de tes fatigues, et que je sois calme, et
que je dise: Tout est bien! Hélas! mon Dieu, faites que
je remporte cette victoire jusqu'au bout!
«Pourvu, Marthe, lui dit-il dans un autre moment de
calme qu'il eut le lendemain, que tu n'ailles pas oublier
ce que tu fais pour moi, et que tu ne viennes pas me
dire un jour, quand je te le rappellerai, que tu n'as pas
autant souffert que je veux bien le prétendre! C'est
que je te connais, Marthe: tu es capable de cette perfidie-là.»
Un pâle sourire effleura leurs lèvres à tous les deux;
et, Marthe, se penchant sur lui, imprima un chaste baiser
sur le front de son ami. C'était la première caresse
qu'elle osait lui donner depuis cinq semaines qu'ils étaient
enfermés ensemble tête à tête le jour et la nuit. Durant
tout ce temps, chaque fois que Marthe, dans une effusion
de douleur et d'effroi pour sa vie, s'était approchée
de lui pour l'embrasser comme pour lui dire adieu, il
l'avait toujours repoussée vivement, en lui disant avec
une sorte de colère: «Laisse-moi. Tu veux donc me
tuer?» C'étaient les seuls moments où le souvenir de sa
passion avait paru se réveiller. Hors de ces émotions rapides
et rares, que Marthe avait appris à ne plus provoquer
par son élan fraternel, ils n'avaient pas échangé
un mot qui fit allusion aux malheurs précédents. On eût
dit qu'entre la paisible amitié de leur enfance et la tragique
journée du cloître Saint-Méry il ne s'était rien
passé, tant l'un mettait de délicatesse à détourner le
souvenir des temps intermédiaires, tant l'autre éprouvait
de honte et d'angoisse à les rappeler! Ce jour-là
seulement tous deux y songèrent sans trouble au même
moment, et tous deux comprirent que cette pensée pouvait
cesser d'être amère. Paul, loin de repousser le baiser
de Marthe, le rendit à son enfant avec plus de tendresse
encore qu'il n'avait fait la veille, et il ajouta avec
une sorte de gaieté mélancolique: «Sais-tu, Marthe,
que cet enfant est charmant? On dit que ces petits êtres
sont tous laids à cet âge-là; mais ceux qui parlent ainsi
n'en ont jamais regardé un avec des yeux de père!»
XXVIII.
Horace nous avait fait pressentir, dès les premiers jours
de son assiduité au château de Chailly, les vues qu'il
avait sur la vicomtesse et les espérances qu'il avait conçues.
Eugénie l'avait raillé de sa fatuité; et moi, qui
ne regardais point son succès comme impossible, je ne
l'avais pas félicité de cette entreprise. Loin de là: je lui
avais dit sans ambiguïté le peu de cas que je faisais du
caractère de Léonie. Notre manière d'accueillir ses confidences
lui avait déplu, et il ne nous en faisait plus depuis
longtemps, lorsque le jour de sa victoire arriva,
et le remplit d'un orgueil impossible à réprimer. Ce
jour-là, en soupant avec nous, il ne put s'empêcher de
ramener à tout propos, dans la conversation, les grâces
imposantes, l'esprit supérieur, le tact exquis, toutes les
séductions qu'il voulait nous faire admirer chez la vicomtesse.
Eugénie, qui avait été sa couturière, et qui avait
vu sa beauté, ses belles manières et son grand esprit en
déshabillé, s'obstinait à ne pas partager cet enthousiasme
et à déclarer cette femme hautaine dans sa familiarité,
sèche et blessante jusque dans ses intentions protectrices.
Le souvenir de Marthe, l'indignation qu'Eugénie
éprouvait secrètement de la voir oubliée si lestement,
rendirent ses contradictions un peu amères. Horace s'emporta,
et la traita comme une péronnelle, qui devait du
respect à madame de Chailly, et qui l'oubliait. Il affecta
de lui dire qu'elle ne pouvait pas comprendre le charme
d'une femme de cette condition et de ce mérite. «Mon
cher Horace, lui répondit Eugénie avec la plus parfaite
douceur, ce que vous dites là ne me fâche pas. Je n'ai
jamais eu la prétention de lutter dans votre estime contre
qui que ce soit. Si, en vous disant mon opinion avec
franchise, je vous ai blessé, mon excuse est dans l'intérêt
que je vous porte et dans la crainte que j'ai de
vous voir tourmenté et humilié par cette belle dame, qui
a joué beaucoup d'hommes aussi fins que vous, et qui
s'en vante même devant ses habilleuses; ce que j'ai
trouvé, quant à moi, de mauvais goût et de mauvais
ton.»
Horace était de plus en plus irrité. Je tâchai de le calmer
en insistant sur la vérité des assertions d'Eugénie,
et en le suppliant pour la dernière fois de bien réfléchir
avant de s'exposer aux railleries de la vicomtesse. Ce
fut alors que, blessé de cette idée, et ne pouvant plus
se contenir, il nous ferma la bouche en nous annonçant
dans des termes fort clairs, qu'il ne courait plus le risque
d'être éconduit honteusement, et que si la vicomtesse
prenait fantaisie d'ajouter une dépouille à la brochette
de victimes qu'elle portait à l'épingle de son fichu, il
pourrait bien, lui aussi, attacher ses couleurs à la boutonnière
de son habit.
«Vous ne le feriez pas, répliqua Eugénie froidement:
car un homme d'honneur ne se vante pas de ses bonnes
fortunes.»
Horace se mordit les lèvres; puis, il ajouta, après un
moment de réflexion:
«Un homme d'honneur ne se vante pas de ses bonnes
fortunes tant qu'il en est fier; mais quelquefois il s'en
accuse, quand on le force à en rougir. C'est ce que je
ferais, n'en doutez pas, envers la femme qui me pousserait
à bout.
—Ce n'est pas le système de votre ami le marquis de
Vernes, lui répondis-je.
—Le système du marquis, reprit Horace (et c'est un
homme qui en sait plus que vous et moi sur ce chapitre),
est d'empêcher qu'on se moque jamais de lui. Je n'ai pas
la prétention de me faire son imitateur en adoptant les
mêmes moyens. Chacun a les siens, et tous sont bons
s'ils arrivent au même but.
—Je ne sais pas ce que pense là-dessus le marquis
de Vernes, dit Eugénie; mais, quant à moi, je suis sûre
de ce que vous penseriez si vous vous trouviez dans un
cas pareil.
—Vous plait-il de me le dire? demanda Horace.
—Le voici, répondit-elle. Vous pèseriez, dans un
esprit de raison et de justice, les torts qu'on aurait eus
envers vous, et ceux que vous seriez tenté d'avoir. Vous
compareriez le tort qu'une femme peut vous faire en se
vantant de vous avoir repoussé, et celui que vous lui feriez
immanquablement en vous vantant de l'avoir vaincue;
et vous verriez que ce serait vous venger tout au
plus d'un ridicule par un outrage. Car le monde (oui, j'en
suis sûre, le grand monde comme l'opinion populaire)
respecte la femme qui est respectée par son amant, et
méprise celle que son amant méprise. On lui fait un crime
de s'être trompée; et il faut reconnaître que, sous ce
rapport, les femmes sont fort à plaindre, puisque les
plus prudentes et les plus habiles sont encore exposées
à être insultées par l'homme qui les implorait la veille.
Voyons, n'en est-il pas ainsi, Horace? ne riez pas et répondez.
Pour être écouté de la vicomtesse elle-même,
que je ne crois pas très farouche, ne seriez-vous pas
obligé d'être bien assidu, bien humble, bien suppliant
pendant quelque temps? Ne vous faudrait-il pas montrer
de l'amour ou en faire le semblant? Dites!
—Eugénie, ma chère, répliqua Horace, demi-troublé,
demi-satisfait de ce qu'il prenait pour une interrogation
détournée, vous faites des questions fort indiscrètes;
et je ne suis pas forcé de vous rendre compte de
ce qui a pu ou de ce qui pourrait se passer entre la vicomtesse
et moi.
—Je ne vous fais que des demandes auxquelles vous
pouvez répondre sans compromettre personne, et je ne
vous pose qu'une question de principes. N'est-il pas certain
que vous ne feriez pas la cour à une femme qui se
livrerait sans combats?
—Vous le savez, je ne conçois pas qu'on s'adresse à
d'autres femmes qu'à celles qui se défendent, et dont la
conquête est périlleuse et difficile.
—Je connais votre fierté à cet égard, et je dis qu'en
ce cas vous n'aurez jamais le droit de trahir aucune
femme, parce que vous n'en posséderez aucune à qui
vous n'ayez juré respect, dévouement et discrétion. La
diffamer après, serait donc une lâcheté et un parjure.
—Ma chère amie, reprit Horace, je sais que vous
avez cultivé la controverse à la salle Taitbout; je sais
par conséquent que toutes vos conclusions seront toujours
à l'avantage des droits féminins. Mais quelque subtile
que soit votre argumentation, je vous répondrai que
je n'acquiesce pas à cette domination que les femmes
doivent s'arroger selon vous. Je ne trouve pas juste que
vous ayez le droit de nous faire passer pour des sots,
pour des impertinents ou pour des esclaves, sans que
nous puissions invoquer l'égalité. Eh quoi! une coquette
m'attirerait à ses pieds, m'agacerait durant des
semaines entières, triompherait de ma prudence, me
donnerait enfin sur elle, en échange de sa victoire, les
droits d'un époux et d'un maître, et puis elle recommencerait
le lendemain avec un autre, et se débarrasserait
de moi en disant à mon successeur, à ses amis,
à ses femmes de chambre: «Vous voyez bien ce paltoquet?
il m'a obsédée de ses désirs; mais je l'ai remis
à sa place, et j'ai rabattu son sot amour-propre!» Ce
serait un peu trop fort, et, par ma foi, je ne suis pas
disposé à me laisser jouer ainsi. Je trouve qu'un ridicule
est aussi sérieux qu'aucune autre honte. C'est même peut-être
en France, à l'heure qu'il est, la pire de toutes; et
la femme qui me l'infligera peut s'attendre à de franches
représailles, dont elle se souviendra toute sa vie. C'est
la peine du talion qui régit nos codes.
—Si vous acceptez cette peine-là comme juste et humaine,
répondit Eugénie, je n'ai plus rien à dire. En ce
cas, vous souscrivez à la peine de mort et à toutes les
autres institutions barbares, au-dessus desquelles je pensais
que votre coeur s'était élevé. Du moins, je vous l'avais
entendu affirmer; et j'aurais cru que, dans ces actes de
conduite personnelle où nous pouvons tous corriger l'ineptie
et la cruauté des lois, dans vos rapports avec l'opinion,
par exemple, vous chercheriez plus de grandeur
et de noblesse que vous n'en professez en ce moment.
Mais, ajouta-t-elle en se levant de table, j'espère que
tout ceci est, comme on dit dans ma classe de bonnes
gens, l'histoire de parler, et que dans l'occasion vos
actions vaudront mieux que vos paroles.»
Malgré la résistance d'Horace, les nobles sentiments
d'Eugénie firent impression sur lui. Quand elle fut sortie,
il me dit avec un généreux entraînement:
«Ton Eugénie est une créature supérieure, et je crois
qu'elle a, sinon autant d'esprit, du moins plus d'idées
que ma vicomtesse.
—Elle est donc tienne décidément, mon pauvre Horace?
lui dis-je en lui prenant la main. Eh bien! j'en suis
réellement affligé, je te l'avoue.
—Et pourquoi donc? s'écria-t-il avec un rire superbe.
Vraiment, vous êtes étonnants, Eugénie et toi, avec vos
compliments de condoléances. Ne dirait-on pas que je suis
le plus malheureux des hommes, parce que je possède
la plus adorable et la plus séduisante des femmes? Je ne
sais pas si elle est une héroïne de roman parfaite, telle
que vous la voudriez; mais pour moi, qui suis plus modeste,
c'est une belle conquête, une maîtresse délirante.
—L'aimes-tu? lui demandai-je.
—Le diable m'emporte si je le sais, répondit-il d'un
air léger. Tu m'en demandes trop long. J'ai aimé, et je
crois que ce sera pour la première et la dernière fois de
ma vie. Désormais, je ne peux plus chercher dans les
femmes qu'une distraction à mon ennui, une excitation
pour mon coeur à demi éteint. Je vais à l'amour comme
on va à la guerre, avec fort peu de sentiment d'humanité,
pas une idée de vertu, beaucoup d'ambition et pas
mal d'amour-propre. Je t'avoue que ma vanité est caressée
par cette victoire, parce qu'elle m'a coûté du temps
et de la peine. Quel mal y trouves-tu? Vas-tu faire le pédant?
Oublies-tu que j'ai vingt ans, et que si mes sentiments
sont déjà morts, mes passions sont encore dans
toute leur violence?
—C'est que tout cela me paraît faux et guindé, lui
dis-je. Je te parle dans la sincérité de mon coeur, Horace,
sans aucun ménagement pour cette vanité derrière laquelle
tu te réfugies, et qui me paraît un sentiment trop
petit pour toi. Non, le grand sentiment, le grand amour
n'est pas mort dans ton sein; je crois même qu'il n'y est
pas encore éclos, et que tu n'as point aimé jusqu'ici. Je
crois que de nobles passions, étouffées longtemps par
l'ignorance et l'amour-propre, fermentent chez toi, et
vont faire ton supplice, si elles ne font pas ton bonheur.
Oh! mon cher Horace, tu n'es pas, tu ne peux pas être
le don Juan que décrit Hoffmann, encore moins celui de
Byron. Ces créations poétiques occupent trop ton cerveau,
et tu le manières pour les faire passer dans la réalité
de ta vie. Mais tu es plus jeune et plus puissant que
ces fantômes-là. Tu n'es pas brisé par la perte de ton
premier amour; ce n'a été qu'un essai malheureux.
Prends garde que le second, en dépit de la légèreté que
tu veux y mettre, ne soit l'amour sérieux et fatal de
ta vie.
—Eh bien, s'il en est ainsi, répondit Horace, dont
l'orgueil accepta facilement mes suppositions, vogue la
galère! Léonie est bien faite pour inspirer une passion
véritable; car elle l'éprouve, je n'en peux pas douter.
Oui, Théophile, je suis ardemment aimé, et cette femme
est prête à faire pour moi les plus grands sacrifices, les
plus grandes folies. Peut-être que cet amour éveillera le
mien, et que nous aurons ensemble des jours agités. C'est
tout ce que je demande à la destinée pour sortir de la
torpeur odieuse où je me sentais plongé naguère.
—Horace, m'écriai-je, elle ne t'aime pas. Elle n'a
jamais rien aimé, et elle n'aimera jamais personne; car
elle n'aime pas ses enfants.
—Absurdités, pédagogie que tout cela! répondit-il
avec humeur. Je suis charmé qu'elle n'aime rien, et
qu'elle me livre un coeur encore vierge. C'est plus que
je n'espérais, et ce que tu dis là m'exalte au lieu de me
refroidir. Pardieu! si elle était bonne épouse et bonne
mère, elle ne pourrait pas être une amante passionnée.
Tu me prends pour un enfant. Crois-tu que je puisse me
faire illusion sur elle, et que je n'aie pas senti ses transports
aujourd'hui? Ah! que ton ivresse était différente
du chaste abandon de Marthe! Celle-là était une religieuse,
une sainte; amour et respect à sa mémoire, à
jamais sacrée! Mais Léonie! c'est une femme, c'est une
tigresse, un démon!
—C'est une comédienne, repris-je tristement. Malheur
à toi, quand tu rentreras avec elle dans la coulisse!
Si la vicomtesse avait eu auprès d'elle en ce moment
un ami véritable, il lui aurait dit les mêmes choses d'Horace
que je disais d'elle à celui-ci; mais livrée au désir
exalté d'être aimée avec toute la fureur romantique
qu'elle trouvait dans les livres, et qu'aucun homme de
sa caste ne lui avait encore exprimée, elle n'eût pas
mieux reçu un bon conseil qu'Horace n'écouta les miens.
Elle se livra à lui, croyant inspirer une passion violente,
et entraînée seulement par la vanité et la curiosité. On
peut donc dire qu'ils étaient à deux de jeu.
Je n'ai jamais compris, pour ma part, comment une
femme aussi pénétrante, formée de bonne heure par les
leçons du marquis de Vernes à la ruse envers les hommes
et à la prévoyance devant les événements, put se tromper
sur le compte d'Horace, comme le fit la vicomtesse.
Elle se flatta de trouver en lui un dévouement romanesque
que rien ne pourrait ébranler, une admiration
qui n'y regarderait pas de trop près, une sorte de vanité
modeste qui se tiendrait toujours pour honorée de
la possession d'une femme comme elle. Elle s'abusait
beaucoup: Horace, enivré durant quelques jours, devait
bientôt, éclairé subitement dans son inexpérience
par les intérêts de son amour-propre, lutter avec force
contre celui de Léonie. Je ne puis m'expliquer l'erreur
de cette femme, sinon en me rappelant qu'elle s'était
aventurée sur un terrain tout à fait inconnu, en choisissant
l'objet de son amour dans la classe bourgeoise.
Elle n'avait certainement aucun préjugé aristocratique.
Elle s'était donc fait un type de supériorité intellectuelle,
et elle le rêvait dans un rang obscur, afin de lui
donner plus d'étrangeté, de mystère, et de poésie. Elle
avait l'imagination aussi vive que le coeur froid, il ne faut
pas l'oublier. Ennuyée de tout ce qu'elle connaissait, et sachant
d'avance par coeur toutes les phrases dont ses nobles
adorateurs articulaient les premières syllabes, elle trouva,
dans l'originale brusquerie d'Horace, la nouveauté dont
elle avait soif. Mais, en devinant le mérite de l'homme
sans naissance, elle ne pressentit pas les défauts de
l'homme sans usage, sans savoir-vivre, comme disait
le vieux marquis avec une grande justesse d'expression.
Dans une société sans principes, le point d'honneur qui
en tient lieu, et l'éducation qui en fait affecter le semblant,
sont des avantages plus réels qu'on ne pense.
Horace sentait cette espèce de supériorité de ce qu'on
appelle la bonne compagnie. Amoureux de tout ce qui
pouvait l'élever et le grandir, il eût voulu se l'inoculer.
Mais s'il y réussit dans les petites choses, il ne put le
faire dans les grandes. Le naturel et l'habitude furent
vaincus là où l'étiquette ne commandait que des sacrifices
faciles; mais lorsqu'elle ordonna celui de la vanité,
elle fut impuissante, et l'amour-propre un peu grossier,
la présomption un peu déplacée, la personnalité un peu
âpre de l'homme du tiers, reprirent le dessus. C'était
tout le contraire de ce qu'eût souhaité la vicomtesse.
Elle aimait la gaucherie spirituelle et gracieuse d'Horace;
elle trouva qu'il la perdait trop vite. Elle espérait de sa
part une grande abnégation, une sorte d'héroïsme en
amour; elle n'en trouva pas en lui le moindre élan.
Cependant, comme le coeur de ce jeune homme n'était
pas corrompu, mais seulement faussé, il éprouva, durant
les premiers jours, une reconnaissance vraie pour
la vicomtesse. Il le lui exprima avec talent, et elle se
crut enfin adorée, comme elle avait l'ambition de l'être.
Il y eut même une sorte de grandeur dans la manière
dont Horace accepta sans méfiance, sans curiosité, et
sans inquiétude, le passé de sa nouvelle maîtresse. Elle
lui disait qu'il était le premier homme qu'elle eût aimé.
Elle disait vrai en ce sens qu'il était le premier homme
qu'elle eût aimé de cette manière. Horace n'hésitait point
à la prendre au mot. Il acceptait sans peine l'idée qu'aucun
homme n'avait pu mériter l'amour qu'il inspirait;
et quant aux peccadilles dont il pensait bien que la vie
de Léonie n'était point exempte, il s'en souciait si peu,
qu'il ne lui fit à cet égard aucune question indiscrète. Il
ne connut point avec elle cette jalousie rétroactive qui
avait fait de ses amours avec Marthe un double supplice.
D'une part, ses idées sur le mérite des femmes s'étaient
beaucoup modifiées dans la société de la vicomtesse et à
l'école du vieux marquis. Il ne cherchait plus cette chasteté
bourgeoise dont il avait fait longtemps son idéal,
mais bien la désinvolture leste et galante d'une femme à
la mode. D'autre part, il n'était pas humilié des prédécesseurs
que lui avait donnés la vicomtesse, comme il
l'avait été de succéder dans le coeur de Marthe à M. Poisson,
le cafetier, et (selon ses suppositions) à Paul Arsène,
le garçon de café. Chez Léonie, c'était à des
grands seigneurs sans doute, à des ducs, à des princes
peut-être, qu'il succédait; et cette brillante avant-garde,
qui avait ouvert et précédé sa marche triomphale, lui
paraissait un cortège dont on ne devait pas rougir. La
pauvre Marthe, pour avoir accepté avec douceur et repentance
le reproche d'une seule erreur, avait été accablée
par l'orgueil ombrageux d'Horace. La fière vicomtesse,
prête à se vanter d'une longue série de fautes, fut
respectée, grâce à ce même orgueil.
Interrogée comme Marthe l'avait été, la vicomtesse
n'eût pas daigné répondre. L'eût-elle fait, elle n'eût caché
aucune de ses actions. Elle n'était pas hypocrite de
principes. Tout au contraire, elle avait à cet égard un
certain cynisme voltairien qui donnait un démenti formel
à ses hypocrisies de sentiment. Elle n'avait pas la prétention
d'être une femme vertueuse, mais bien celle d'être
une âme jeune, ardente, ouverte aux passions qu'on saurait
lui inspirer. C'était une sorte de prostitution de coeur,
car elle allait s'offrant à tous les désirs, se faisant respecter
par ce mot: «Je ne peux pas aimer;» se laissant
attaquer par cet autre qu'elle ajoutait pour certains hommes:
«Je voudrais pouvoir aimer.»
Lorsque Horace devint son amant, elle était à peu près
seule avec lui dans une sorte d'intimité au château de
Chailly. Le comte de Meilleraie s'était absenté, les adorateurs
d'habitude s'étaient dispersés; le choléra avait
effrayé les uns, et apporté aux autres des héritages précieux
ou des pertes sensibles. Cependant le fléau s'éloignait
de nos contrées, et Léonie ne rappelait pas sa cour
autour d'elle. Absorbée par son nouvel amour, et embarrassée
peut-être d'en faire accepter les apparences à ses
amis, elle écartait toutes les visites, en répondant à toutes
les lettres, qu'elle était à la veille de retourner à Paris.
Cependant, les semaines se succédaient, et Horace triomphait
secrètement (trop secrètement à son gré) de l'absence
de ses rivaux.
Malgré ses affectations de franchise ordinaire, la vicomtesse,
à cause de sa belle-mère et de ses enfants,
exigea d'Horace le plus profond mystère. Grâce à l'aplomb
de Léonie, plus encore qu'au voisinage des habitations
respectives et aux précautions prises, le secret de
cette liaison ne transpira point. Les moeurs de Léonie,
ses discours, ses prétentions, ses réticences, ses demi-aveux,
tout son mélange de franchise et de fausseté,
avaient fait de sa vie à l'extérieur quelque chose d'énigmatique,
que les amants heureux s'étaient plu à voiler
pour rendre leur gloire plus piquante, et les amants rebutés
à respecter, pour adoucir la honte de leur position.
Horace passa pour un intime de plus, pour un de ces assidus
dont on disait: Ils sont tous heureux, ou bien il n'y
en a pas un seul; tous sont également favorisés ou tenus
à distance. Ce n'était pas ainsi qu'Horace eût arrangé son
rôle, si on lui en eût laissé le choix; son principal sentiment
auprès de Léonie avait été le désir d'écraser tous
ses rivaux dans l'apparence, sinon dans la réalité, et de
faire dire de lui: «Voilà celui qu'elle favorise; aucun
autre n'est écouté.» Il souffrit donc bien vite de l'obscurité
de sa position et du peu de retentissement de sa
victoire. Il s'en consola en la confiant sous le sceau du
secret, non-seulement à moi, mais à quelques autres personnes
qu'il ne connaissait pas assez pour les traiter avec
cet abandon, et qui, le jugeant extrêmement fat, ne voulurent
pas croire à son succès.
Ces indiscrétions tournèrent donc à la honte d'Horace
et à la glorification de la vicomtesse, qui les apprit et les
démentit en disant, avec un sang-froid admirable et une
douceur angélique, que cela était impossible, parce qu'Horace
était un homme d'honneur, incapable d'inventer et
de répandre un fait contraire à la vérité. Mais lorsqu'elle
le revit tête à tête, elle lui fit sentir sa faute avec des
ménagements si cruels et une bonté si mordante, qu'il
fut forcé, tout en étouffant de rage, de se lancer auprès
d'elle dans un système de dénégations et de mensonges
pour reconquérir sa confiance et son estime. Mais c'en
était fait déjà pour jamais. La curiosité de Léonie était satisfaite;
sa vanité était assouvie par toutes les louanges
ampoulées qu'Horace lui avait prodiguées, au lieu d'ardeur,
dans ses épanchements, au lieu d'affection, dans
ses épîtres en prose et en vers. Il avait épuisé pour elle
tout son vocabulaire ébouriffant de l'amour à la mode;
il l'avait saturée d'épithètes délirantes, et ses billets
étaient criblés de points d'exclamation. Léonie en avait
assez. En femme d'esprit, elle s'était vite lassée de tout
ce mauvais goût poétique. En diplomate clairvoyant, elle
avait reconnu que cet amour-là n'était différent de celui
qu'elle connaissait que par l'expression, et que ce n'était
pas la peine de s'exposer vis-à-vis du public à des propos
ridicules, pour écouter un jargon d'amour qui ne l'était
pas moins. Après un mois de cette expérience, chaque
jour plus froide et plus triste, Léonie résolut de se débarrasser
peu à peu de cette intrigue, afin de pouvoir, en
attendant mieux, retourner au comte de Meilleraie, qui
était un homme d'excellent ton.
La vicomtesse, qui ne rougissait point de ses fautes,
rougissait fort souvent de ceux qui les lui avaient fait
commettre; et de là venait qu'en se confessant parfois
avec beaucoup de candeur, il ne lui était jamais arrivé de
nommer personne. Elle avait douloureusement commencé
à nourrir cette honte mystérieuse en devenant la proie
du vieux marquis. Elle n'avait conservé avec lui que des
relations filiales: mais elle n'avait pas trouvé dans ses
autres amours de quoi s'enorgueillir assez pour effacer
cette blessure, et laver cette tache à ses propres yeux.
Elle en avait gardé une haine et un mépris profonds pour
les hommes qui ne lui plaisaient pas, ou qui ne lui plaisaient
plus; et même à l'égard de ceux qui étaient en
possession de lui plaire, elle nourrissait une méfiance
continuelle. Elle n'avait jamais ratifié leur puissance sur
elle par des confidences à ses amis (il faut en excepter le
marquis, à qui elle disait presque tout), encore moins
par des démarches compromettantes. En général, elle
avait été secondée par la délicatesse de leurs procédés et
la froideur de leur rupture, parce que c'étaient des hommes
du monde, également incapables d'un regret et d'une
vengeance. Horace, pour qui elle avait failli abjurer sa
prudence; Horace, qu'elle avait jugé si pur, si épris, si
naïf; Horace, dont elle ne s'était pas défiée, lui parut le
plus misérable de tous, lorsqu'il voulut s'imposer à elle
pour amant aux yeux d'autrui. Elle en fut si révoltée,
que non-seulement elle jura de l'éconduire au plus vite,
mais encore de se venger en ne laissant pas derrière elle
la moindre trace de ses bontés pour lui. «Tu seras puni
par où tu as péché, lui disait-elle en son âme ulcérée;
tu as voulu passer pour mon maître, et, à la première
occasion, je te ferai passer pour mon bouffon. Ta fatuité
retombera sur ta tête; et où tu as semé la gloriole, tu ne
recueilleras que la honte et le ridicule.»
Horace pressentit cette vengeance, et une nouvelle
lutte s'engagea entre eux, non plus pour se dominer mutuellement,
mais pour se détruire.
XXIX.
Cependant nous ignorions absolument le sort de trois
personnes qui nous intéressaient au plus haut point:
Marthe, que nous étions déjà habitués à regarder comme
perdue à jamais pour nous; Laravinière, que ses amis
cherchaient sans pouvoir le retrouver; et Arsène, qui
nous avait promis de nous écrire, et dont nous ne recevions
pas plus de nouvelles que des deux autres. La disparition
de Jean avait été complète. On présumait bien
qu'il était mort au cloître Saint-Méry, car les bousingots
les plus courageux l'avaient suivi durant toute la journée
du 5 juin; mais dans la nuit ils s'étaient dispersés pour
chercher des armes, des munitions et du renfort. Le 6 au
matin, il leur avait été impossible de se réunir aux insurgés,
que la troupe, échelonnée sur tous les points, parquait
dans leur dernière retraite. Je ne saurais affirmer
que ces étudiants eussent tous mis une audace bien persévérante
à opérer cette jonction; mais il est certain que
plusieurs la tentèrent, et qu'à la prise de la maison où
leur chef était retranché, ils profitèrent de la confusion
pour s'efforcer de le retrouver, afin d'aider à son évasion,
ou tout au moins de recueillir son cadavre. Cette dernière
consolation leur fut refusée. Louvet retrouva seulement
sa casquette rouge, qu'il garda comme une relique, et il
ne put savoir si son ami était parmi les prisonniers. Plus
tard, le procès qu'on instruisait contre les victimes n'amena
aucune découverte, car il n'y fut pas fait mention
de Laravinière. Ses amis le pleurèrent, et se réunirent
pour honorer sa mémoire par des discours et des chants
funèbres, dont l'un d'eux composa les paroles et un autre
la musique.
Ils m'écrivirent à cette occasion pour me demander si
je n'avais pas de nouvelles de Paul Arsène, et c'est ainsi
que j'appris que lui aussi avait disparu. J'écrivis à ses
soeurs, qui n'étaient pas plus avancées que moi. Louison
nous répondit une lettre de lamentations où elle exprimait
assez ingénument sa tendresse intéressée pour son
frère. Elle terminait en disant: «Nous avons perdu notre
unique soutien, et nous voilà forcées de travailler sans
relâche pour ne pas tomber dans la misère.»
Pendant que nous étions tous livrés à ces perplexités,
auxquelles Horace n'avait guère le loisir de prendre part,
bien qu'il donnât des regrets sincères à Jean et à Paul
quand on l'y faisait songer, Paul entrait en convalescence
dans la mansarde ignorée de la pauvre Marthe. Celle-ci
commençait à sortir, et s'était assurée de la tranquillité
qui régnait enfin dans le quartier. Bien que les voisins
des mansardes eussent quelque soupçon d'un patriote
réfugié chez elle, ce secret fut religieusement gardé, et
la police ne surveilla pas ses mouvements. Cependant il
était bien important qu'Arsène, dès qu'il voudrait sortir,
changeât de quartier, et s'éloignât d'un lieu où certainement
sa figure avait été remarquée dans les barricades
et dans la maison mitraillée. Il ne pourrait se montrer
trois fois dans les rues environnantes sans que des témoins
malveillants ou maladroits fissent sur lui tout
haut des remarques qu'une oreille d'espion pouvait saisir
au passage. Il résolut donc d'aller demeurer à l'autre
extrémité de Paris. La difficulté n'était pas de sortir de
sa retraite: il commençait à marcher, et, en descendant
le soir avec précaution, il était facile de s'esquiver sans
être vu. Mais il n'osait pas abandonner Marthe, dans
l'état de misère où elle se trouvait, aux persécutions
d'un propriétaire qu'elle ne pouvait pas payer, et qui, en
vérifiant l'état des lieux, remarquerait certainement l'effraction
de la fenêtre; alors ce créancier courroucé livrerait
peut-être Marthe aux poursuites de la police. Enfin,
comme en restant les bras croisés il ne détournerait pas
ce péril, Paul se décida à sortir de la maison avant le jour
de l'échéance, et s'alla confier à Louvet, qui sur-le-champ
le mit en fiacre, l'installa à Belleville, et alla porter à la
vieille voisine l'argent nécessaire pour tirer Marthe d'embarras.
On chercha ensuite un ouvrier dévoué à la cause
républicaine: ce ne fut pas difficile à trouver; on lui fit
réparer sans bruit la lucarne, et Louvet amena Marthe,
l'enfant et la voisine, qui ne voulait plus les quitter, dans
le pauvre local où il avait établi Arsène sous son propre
nom, en lui prêtant son passe-port. Ce Louvet était un
excellent jeune homme, le plus pauvre et par conséquent
le plus généreux de tous ceux qu'Arsène avait connus
dans l'intimité de Laravinière. Paul souffrait de ne pouvoir
immédiatement lui rembourser les avances qu'il lui
faisait avec tant d'empressement; mais, à cause de Marthe,
il était forcé de les accepter. Louvet ne lui avait pas
donné le temps de les solliciter; en route il lui promit le
secret sur toutes choses, et il le garda si religieusement,
que ce changement de situation me laissa dans la même
ignorance où j'étais sur le compte de Marthe et d'Arsène.
A peine établi à Belleville, Paul chercha de l'ouvrage;
mais il était encore si faible, qu'il ne put supporter la fatigue,
et fut renvoyé. Il se reposa deux ou trois jours,
reprit courage, et s'offrit pour journalier à un maître
paveur. Arsène n'avait pas de temps à perdre, et pas de
choix à faire. Le pain commençait à manquer. Il n'entendait
rien à la besogne qui lui était confiée; on le renvoya
encore. Il fut tour à tour garçon chez un marchand de
vins, batteur de plâtre, commissionnaire, machiniste au
théâtre de Belleville, ouvrier cordonnier, terrassier, brasseur,
gâche, gindre, et je ne sais quoi encore. Partout
il offrit ses bras et ses sueurs, là où il trouva à gagner
un morceau de pain. Il ne put rester nulle part, parce
que sa santé n'était pas rétablie, et que, malgré son zèle,
il faisait moins de besogne que le premier venu. La misère
devenait chaque jour plus horrible. Les vêtements
s'en allaient par lambeaux. La voisine avait beau tricoter,
elle ne gagnait presque rien. Marthe ne pouvait trouver
d'ouvrage; sa pâleur, ses haillons, et son état de nourrice,
lui nuisaient partout. Elle alla faire des ménages à
six francs par mois. Et puis elle réussit à être couturière
des comparses du théâtre de Belleville; et comme elle
n'était pas souvent payée par ces dames, elle se décida
à solliciter à ce théâtre l'emploi d'ouvreuse de loges. On
lui prouva que c'était trop d'ambition, que la place était
importante; mais par pitié on lui accorda celle d'habilleuse,
et les grandes coquettes furent contentes de son
adresse et de sa promptitude.
Ce fut alors que Paul, qui, dans son court emploi de
machiniste, avait écouté les pièces et observé les acteurs
avec attention, songea à s'essayer sur le théâtre. Il avait
une mémoire prodigieuse. Il lui suffisait d'entendre deux
répétitions pour savoir tous les rôles par coeur. On l'examina:
on trouva qu'il ne manquait pas de dispositions
pour le genre sérieux; mais tous les emplois de ce genre
étaient envahis, et il n'y avait de vacant qu'un emploi
de comique, où il débuta par le rôle d'un valet fripon et
battu. Arsène se traîna sur les planches, la mort dans
l'âme, les genoux tremblants de honte et de répugnance,
l'estomac affamé, les dents serrés de colère, de fièvre et
d'émotion. Il joua tristement, froidement, et fut outrageusement
sifflé. Il supporta cet affront avec une indifférence
stoïque. Il n'avait pas été braver ce public pour
satisfaire un sot amour-propre: c'était une tentative désespérée,
entre vingt autres, pour nourrir sa femme et
son enfant; car il avait épousé Marthe dans son coeur, et
adopté le fils d'Horace devant Dieu. Le directeur, en
homme habitué à ces sortes de désastres, rit de la mésaventure
de son débutant, et l'engagea à ne pas se risquer
davantage; mais il remarqua le sang-froid et la présence
d'esprit dont il avait fait preuve au milieu de l'orage,
sa prononciation nette, sa diction pure, sa mémoire infaillible,
et son entente du dialogue. Il conçut des espérances
sur son avenir, et, pour lui fournir les moyens de
se former sans irriter le public de Belleville, il lui donna
l'emploi de souffleur, dont il s'acquitta parfaitement. En
peu de temps, Arsène montra qu'il s'entendait aussi aux
costumes et aux décors, qu'il croquait vite et bien, qu'il
avait du goût et de la science. Ce qu'il avait vu et copié
chez M. Dusommerard lui servit en cette occasion. La
modestie de ses prétentions, sa probité, son activité, son
esprit d'ordre et d'administration, achevèrent de le rendre
précieux, et il devint enfin, après plusieurs mois de
désespoir, d'anxiétés, de souffrances et d'expédients, une
sorte de factotum au théâtre, avec des honoraires de
quelques centaines de francs assurés et bien servis.
De son côté, tout en habillant les actrices et en assistant
dans la coulisse aux représentations, Marthe s'était
familiarisée avec la scène. Sa vive intelligence avait saisi
les côtés faibles et forts du métier. Elle retenait, comme
malgré elle, des scènes entières, et, rentrée dans son grenier,
elle en causait avec Arsène, analysait la pièce avec
supériorité, critiquait l'exécution avec justesse, et, après
avoir contrefait avec malice et enjouement la méchante
manière des actrices, elle disait leur rôle comme elle le
sentait, avec naturel, avec distinction, et avec une émotion
touchante, qui plusieurs fois humecta les paupières
d'Arsène et fit sangloter la vieille voisine, tandis que l'enfant,
étonné des gestes et des inflexions de voix de sa
mère, se rejetait en criant dans le sein de la vieille
Olympe. Un jour Arsène s'écria: «Marthe, si tu voulais,
tu serais une grande actrice.
—J'essaierais, répondit-elle, si j'étais sûre de conserver
ton estime.
—Et pourquoi la perdrais-tu? répondit-il; ne suis-je
pas, moi, un ex-mauvais acteur?»
Marthe protégée par la grande coquette, qui voulait
faire pièce à une ingénue, sa rivale et son ennemie, débuta
dans un premier rôle, et elle eut un succès éclatant.
Elle fut engagée quinze jours après, avec cinq cent francs
d'appointements, non compris les costumes, et trois mois
de congé. C'était une fortune; l'aisance et la sécurité
vinrent donc relever ce pauvre ménage. La mère Olympe
fut associée au bien-être; et, tout enflée de la brillante
condition de ses jeunes amis, elle promenait l'enfant dans
les rues pittoresques de Belleville, d'un air de triomphe,
cherchant des promeneurs ou des commères à qui elle
put dire, en l'élevant dans ses bras: «C'est le fils de madame
Arsène!»
Tout en portant le nom de son ami, tout en habitant
sous le même toit, tout en laissant croire autour d'elle
qu'elle était unie à lui, Marthe n'était cependant ni la
femme ni la maîtresse de Paul Arsène. Il y a des conditions
où un pareil mensonge est un acte d'impudence ou
d'hypocrisie. Dans celle où se trouvait Marthe, c'était un
acte de prudence et de dignité, sans lequel elle n'eût pas
échappé aux malignes investigations et aux prétentions
insultantes de son entourage. Le couple modeste et résigné
avait reconnu l'impossibilité où il était de se soutenir
dans la dure mais honorable classe des travailleurs.
Certes, il ne répugnait ni à l'un ni à l'autre de persévérer
dans la voie péniblement tracée par ses pères; certes, ni
l'un ni l'autre ne se sentait porté par goût et par ambition
vers la vocation vagabonde de l'artiste bohémien;
mais il est certain que le domaine de l'art était le seul où
ils pussent trouver un refuge pour leur existence matérielle,
un milieu pour le développement de leur vie intellectuelle.
Dans la hiérarchie sociale, toutes les positions
s'acquièrent encore par droit d'hérédité. Celles qui s'enlèvent
par droit de conquête sont exceptionnelles. Dans
le prolétariat, comme dans les autres classes, elles exigent
certains talents particuliers qu'Arsène n'avait pas et ne
pouvait pas avoir. Oublieux de son propre avenir, et occupé
seulement de procurer quelque bien-être aux objets
de son affection, il n'avait pas songé à se perfectionner
dans une spécialité quelconque. Il eût fait volontiers quelque
dur et patient apprentissage, s'il eût été seul au
monde; mais, toujours chargé d'une famille, il avait été
au plus pressé, acceptant toute besogne, pourvu qu'elle
fût assez lucrative pour remplir le but généreux qu'il
s'était proposé. Par surcroît de malheur, la force physique
lui avait manqué au moment où elle lui eût été plus
nécessaire. Il fallait donc qu'il allât grossir le nombre,
énorme déjà, des enfants perdus de cette civilisation
égoïste qui a oublié de trouver l'emploi des pauvres maladifs
et intelligents. A ceux-là le théâtre, la littérature,
les arts, dans tous leurs détails brillants ou misérables,
offrent du moins une carrière, où, par malheur, beaucoup
se précipitent par mollesse, par vanité ou par amour du
désordre, mais où, en général, le talent et le zèle ont des
chances d'avenir. Arsène avait de l'aptitude et l'on peut
même dire du génie pour toutes choses. Mais toutes
choses lui étaient interdites, parce qu'il n'avait ni argent
ni crédit. Pour être peintre, il fallait de trop longues
études, et il ne pouvait pas s'y consacrer. Pour être administrateur,
il fallait de grandes protections, et il n'en
avait pas. La moindre place de bureaucrate est convoitée
par cinquante aspirants. Celui qui remportera ne le devra
ni à l'estime de son mérite, ni à l'intérêt qu'inspireront
ses besoins, mais à la faveur du népotisme. Arsène
ne pouvait donc frapper qu'à cette porte, dont le
hasard et la fantaisie ont les clefs, et qui s'ouvre devant
l'audace et le talent, la porte du théâtre. C'est parfois le
refuge de ce que la société aurait de plus grand, si elle ne
le forçait pas à être souvent ce qu'il y a plus de vil. C'est
là que vont les plus belles et les plus intelligentes femmes,
c'est là que vont des hommes qui avaient peut-être reçu
d'en haut le don de la prédication. Mais l'homme qui
aurait pu, dans un siècle de foi, faire les miracles de la
parole; mais la femme qui, dans une société religieuse
et poétique, devrait être prêtresse et initiatrice, s'il faut
qu'ils descendent au rôle d'histrion pour amuser un auditoire
souvent grossier et injuste, parfois impie et obscène,
quelle grandeur, quelle conscience, quelle élévation
d'idées et de sentiments peut-on exiger d'eux,
chassés qu'ils sont de leur voie et faussés dans leur impulsion?
Et cependant, à mesure que l'horreur du préjugé
s'efface et ne vient plus ajouter le découragement,
la révolte et l'isolement à ces causes de démoralisation
déjà si puissantes, on voit, par de nombreux exemples,
que si l'honneur et la dignité ne sont pas faciles, ils sont
du moins possibles dans cette classe d'artistes. Je ne
parle pas seulement des grandes célébrités, existences
qui sont passées au rang de sommité sociale; mais parmi
les plus humbles et les plus obscures, il en est de
chastes, de laborieuses et de respectables.
Celle de Marthe en fut une nouvelle preuve. Délicate
de corps et d'esprit, portée à l'enthousiasme, douée d'une
intelligence plutôt saisissante que créatrice; trop peu instruite
pour tirer des oeuvres d'art de son propre fonds,
mais capable de comprendre les sentiments les plus élevés
et prompte à les bien exprimer; ayant dans sa personne
un charme extrême, une beauté accompagnée de grâce
et de distinction innée, elle ne pouvait pas, sans souffrir,
concentrer toutes ces facultés, anéantir toute cette puissance.
Elle le faisait pourtant sans amertume et sans regret
depuis qu'elle était au monde; elle ignorait même la
cause de ces langueurs et de ces exaltations soudaines, de
ces accablements profonds et de ce continuel besoin d'enthousiasme
et d'admiration qu'elle ressentait. Son amour
pour Horace avait été la conséquence de ces dispositions
excitées et non satisfaites par la lecture et la rêverie. Le
théâtre lui ouvrit une carrière de fatigues nécessaires,
d'études suivies et d'émotions vivifiantes. Arsène comprit
qu'à cette âme tendre et agitée il fallait un aliment, et il
encouragea ses tentatives. Il ne se dissimula pas certains
dangers, et il ne les craignit guère. Il sentait qu'un grand
calme était descendu dans le coeur de Marthe, et qu'une
grande force avait ranimé le sien propre, depuis que
l'un et l'autre avaient un but indiqué. Celui de Marthe
était d'assurer à son enfant, par son travail, les bienfaits
de l'éducation; celui d'Arsène était de l'aider à atteindre
ce résultat, sans entraver son indépendance et sans compromettre
sa dignité. C'est que jusque là, en effet, la
dignité de Marthe avait souffert de cette position d'obligée
et de protégée, qui fait de la plupart des femmes les
inférieures de leurs maris ou de leurs amants. Depuis
qu'au lieu de subir l'assistance d'autrui, elle se sentait
mère et protectrice efficace et active à son tour d'un être
plus faible qu'elle, elle éprouvait un doux orgueil, et relevait
sa tête longtemps courbée et humiliée sous la domination
de l'homme. Ce bien-être nouveau éloigna ce
que l'idée d'être encore une fois protégée avait eu pour
elle de pénible au commencement de son union avec Arsène,
Elle s'habitua à ne plus s'effrayer de son dévouement,
et à l'accepter sans remords, maintenant qu'elle
pouvait s'en passer. Elle ne vit plus en lui le mari qu'elle
devait accepter pour soutien de son enfant, l'amant
qu'elle devait écouter pour payer la dette de la reconnaissance.
Arsène fut à ses yeux un frère, qui s'associait
par pure affection, et non plus par pitié généreuse, à son
sort et à celui de son fils. Elle comprit que ce n'était pas
un bienfaiteur qui venait lui pardonner le passé, mais un
ami qui lui demandait, comme une grâce, le bonheur de
vivre auprès d'elle. Cette situation imprévue soulagea son
coeur craintif et satisfit sa juste fierté. Elle le sentit d'autant
mieux qu'Arsène ne lui avait pas adressé un seul
mot d'amour depuis la rencontre miraculeuse du 6 juin.
Chaque jour, elle avait attendu avec crainte l'explosion
de cette tendresse longtemps comprimée, et cependant,
au lieu d'y céder, Arsène semblait l'avoir vaincue: car il
était calme, respectueux dans sa familiarité, enjoué dans
sa mélancolie. Il n'y avait eu d'autre explication entre
eux que la demande réitérée de la part d'Arsène de ne
pas être exilé d'auprès d'elle durant les mauvais jours.
Quand la prospérité fut assurée de part et d'autre, Arsène
parla enfin, mais avec tant de noblesse, de force et
de simplicité, que, pour toute réponse, Marthe se jeta
dans ses bras, en s'écriant: «A toi, à toi tout entière et
pour toujours! J'y suis résolue depuis longtemps, et je
craignais que tu n'y eusses renoncé.—Mon Dieu, tu as
eu enfin pitié de moi! dit Arsène avec effusion en levant
ses bras vers le ciel.—Mais mon enfant? ajouta Marthe
en se jetant sur le berceau de son fils; songe, Arsène
qu'il faut aimer mon enfant comme moi-même.—Ton
enfant et toi, c'est la même chose, répondit Arsène. Comment
pourrais-je vous séparer dans mon coeur et dans ma
pensée? A ce propos, écoute, Marthe, j'ai une question
importante à te faire. Il faut te résigner à prononcer un
nom qui n'a pas seulement effleuré nos lèvres depuis
longtemps. Maintenant que tu vas être à moi, et moi à
toi, il faut que cet enfant soit à nous deux, et il ne faut
pas qu'un autre ait des droits sur ce que nous aurons de
plus cher au monde. Depuis que tu t'es séparée d'Horace,
as-tu eu quelque relation avec lui?—Aucune, répondit
Marthe; j'ai toujours ignoré où il était, à quoi il
songeait; j'ai désiré quelquefois le savoir, je te l'avoue,
et, bien que je n'aie plus pour lui aucun sentiment d'affection,
j'ai éprouvé malgré moi des mouvements de pitié
et d'intérêt. Mais je les ai toujours étouffés, et j'ai résisté
au désir de t'adresser une seule question sur son
compte.
—Que veux-tu faire? quelle conduite as-tu résolu de
tenir à son égard?
—Je n'ai rien résolu. J'ai désiré de ne jamais le revoir,
et j'espère que cela n'arrivera pas.
—Mais s'il venait un jour te réclamer son enfant, que
lui répondrais-tu?
—Son enfant! son enfant! s'écria Marthe épouvantée;
un enfant qu'il ne connaît pas, dont il ignore même l'existence?
un enfant qu'il n'a pas désiré, qu'il a engendré
dans mon sein malgré lui, et dont il a détesté en moi
l'espérance? un enfant qu'il m'aurait défendu de mettre
au monde si cela eût été en notre pouvoir? Non, ce n'est
pas son enfant, et ce ne le sera jamais! Ah! Paul! comment
n'as-tu pas compris que je pouvais pardonner à Horace
de m'humilier, de me briser, de me haïr; mais que,
pour avoir haï et maudit l'enfant de mes entrailles, il ne
lui serait jamais pardonné? Non, non! cet enfant est à
nous, Arsène, et non pas à Horace. C'est l'amour, le dévouement
et les soins qui constituent la vraie paternité.
Dans ce monde affreux, où il est permis à un homme
d'abandonner le fruit de son amour sans passer pour un
monstre, les liens du sang ne sont presque rien. Et quant
à moi, j'ai profité à cet égard de la faculté que me donnait
la loi, pour rompre entièrement le lien qui eût uni
mon fils à Horace. La mère Olympe l'a porté à la mairie
sous mon nom, et à la place de celui de son père, on a
écrit celui d'inconnu. C'est toute la vengeance que j'ai
tirée d'Horace: elle serait sanglante, s'il avait assez de
coeur pour la sentir.
—Mon amie, reprit Arsène, parlons sans amertume et
sans ressentiment d'un homme plus faible que mauvais,
et plus malheureux que coupable. Ta vengeance a été
bien sévère, et il pourrait arriver que tu en eusses regret
par la suite. Horace n'est qu'un enfant, il le sera peut-être
encore pendant plusieurs années; mais enfin il deviendra
un homme, et il abjurera peut-être les erreurs
de son coeur et de son esprit. Il se repentira du mal qu'il
a fait sans le comprendre, et tu seras dans sa vie un remords
cuisant. S'il revoit un jour ce bel enfant, qui,
grâce à toi, sera sans doute adorable, et si tu lui refuses
le droit de le serrer sur son coeur...
—Arsène, ta générosité t'abuse, interrompit Marthe
avec une énergie douloureuse; Horace n'aimera jamais
son enfant. Il n'a pas senti cet amour à l'âge où le coeur
est dans toute sa puissance; comment l'éprouverait-il
dans l'âge de l'égoïsme et de l'intérêt personnel? Si son
fils avait de quoi le rendre vain, il s'en amuserait peut-être
pendant quelques jours; mais sois sûr qu'il ne lui
donnerait pas des préceptes et des exemples selon mon
coeur. Je ne veux donc pas qu'il lui appartienne. Oh! jamais!
en aucune façon!
—Eh bien, dit Arsène, es-tu bien décidée à cela? et
veux-tu t'arrêter sans retour à cette détermination?
—Je le veux, répondit Marthe.
—En ce cas, reprit-il, il y a un moyen bien simple.
Cet enfant passe pour être mon fils, parce que personne
dans notre entourage actuel ne sait nos relations passées
ou présentes. On nous croit époux ou amants. Il n'entre
guère dans les moeurs du théâtre de demander à un
couple quelconque la preuve légale de son association.
Nous avons laissé cette opinion se former; nous l'avons
jugée nécessaire à notre sécurité. Il n'y a que la mère
Olympe qui pourrait dire que cet enfant ne m'appartient
pas, et elle est trop discrète et trop dévouée pour trahir
nos intentions. Jusqu'ici rien de plus simple: il ne s'agit
que de laisser subsister un fait déjà établi. Mais quand
nous retrouverons nos anciens amis (car lors même que
nous les éviterions, il nous serait impossible de ne pas en
rencontrer quelqu'un; un jour ou l'autre cela doit arriver),
dis-moi, Marthe, que leur dirons-nous?»
Marthe, interdite et comme affligée, réfléchit un instant;
puis, prenant son parti, elle répondit avec beaucoup
de fermeté: «Nous leur dirons ce que nous avons
dit aux autres, que cet enfant est le tien.
—Songes-tu aux conséquences de ce mensonge, ma
pauvre Marthe? Souviens-toi que la jalousie d'Horace
était bien connue de ses amis: tous ne te connaissaient
pas assez pour être sûrs qu'elle n'était pas fondée... Ils
croiront donc que tu le trompais; et cette accusation injuste,
que tu n'as pu supporter dans la bouche d'Horace,
elle sera donc dans la bouche de tout le monde, même
dans celle des amis qui n'avaient jamais douté de toi,
comme Théophile, Eugénie, et quelques autres!»
Marthe pâlit.
«Cela me fera souffrir beaucoup, répondit-elle. J'ai
été si fière! j'ai montré tant d'indignation d'être soupçonnée!
L'on pensera maintenant que j'ai été impudente
et que j'ai menti avec effronterie. Mais, après tout, qu'importe?
On ne pourra m'accuser que de sottise et de vaine
gloire; car on saura bien que je n'ai pas présenté cet enfant
à Horace comme le sien, et que je me suis éloignée
de lui au moment de devenir mère.
—On dira qu'il t'a chassée, que tu as essayé de le
tromper, mais qu'il s'est aperçu de ton infidélité; et il
sera complètement justifié aux yeux des autres et aux
siens propres.
—Aux siens propres! s'écria Marthe, frappée d'une
idée qui ne lui était pas encore venue. Oh! cela est bien
vrai! Ce serait lui épargner la punition que lui réserve
la justice de Dieu! Ce serait lui ôter la honte qu'il doit
éprouver en voyant comment tu as rempli à sa place les
devoirs qu'il a méconnus. Non! je ne veux pas qu'il
ignore ta grandeur et la pureté de ton amour! Je veux
qu'il en soit humilié jusqu'au fond de son âme, et qu'il
soit forcé de se dire: Marthe a eu bien raison de se réfugier
dans le sein d'Arsène!
—Ceci importe peu, reprit Arsène; mais ce qui m'importe,
à moi, c'est que cet homme aveugle et violent ne
s'arroge pas le droit de te mépriser et d'aller crier chez
tes véritables amis: «Vous voyez! j'avais bien raison de
me méfier de Marthe. Elle était la maîtresse d'Arsène en
même temps que la mienne. J'avais bien raison de maudire
sa grossesse. L'enfant qu'elle voulait me donner
a eu deux pères, et je ne sais auquel des deux il appartient.»
—Tu as raison, répondit Marthe. Eh bien, nous ne
mentirons pas à nos anciens amis; et si jamais j'ai le
malheur de rencontrer Horace, j'aurai le courage de lui
dire à lui-même: «Vous n'avez pas voulu de votre
enfant; un autre est fier de s'en charger, et par là il a
mérité d'être mon époux, mon amant, mon frère à
jamais.»
Marthe, en parlant ainsi, se précipita dans les bras
d'Arsène, et couvrit son visage de baisers et de larmes.
Puis elle prit l'enfant dans son berceau, et le lui donna
solennellement. Paul l'éleva dans ses mains, prit Dieu
témoin, et consacra à la face du ciel cette adoption, plus
sainte et plus certaine qu'aucune de celles que les lois ratifient
à la face des hommes.
XXX.
A la fin de l'été, la vicomtesse avait hâté son départ de
la campagne, sous prétexte d'affaires pressantes, mais en
réalité pour fuir Horace, qu'elle n'aimait plus, et que
même elle commençait à détester. Pour se débarrasser
de cet amant dangereux, elle avait écrit à son vieux ami
le marquis de Vernes, et lui avait demandé conseil
comme elle avait coutume de le faire lorsqu'elle avait besoin
de lui. Elle lui avait avoué en même temps et son
goût pour Horace et le dégoût qui l'avait suivi, le mépris
et le ressentiment que lui avaient causé ses indiscrétions,
et la crainte qu'elle éprouvait qu'il n'en commit de nouvelles.
Elle lui avait raconté comment, ayant essayé de
le traiter d'un peu haut pour l'habituer au respect, ce
moyen avait échoué: Horace avait voulu faire sentir ses
droits, et, pour se faire craindre sans se rendre odieux,
il avait parlé de jalousie et de vengeance comme un héros
de Calderon. Léonie, épouvantée, demandait en grâce au
marquis de venir à son secours pour la délivrer de ce
forcené. «J'avais bien prévu ce qui arrive, avait répondu
le marquis. Ce jeune homme m'a plu, et à vous encore
d'avantage. Il a les qualités du talent et les travers de
l'homme de rien. Il vous aime, et il va bientôt vous haïr,
parce que vous ne pouvez ni le haïr, ni l'aimer comme il
l'entend. Sa haine ou son amour vous seront également
funestes. Il n'y a qu'un moyen de vous en préserver:
c'est de travailler à le rendre indifférent. Pour cela, il
faut bien vous garder de lui témoigner de l'indifférence.
Ce serait ranimer ses désirs, éveiller son dépit, et le
pousser aux dernières extrémités. Soyez passionnée au
contraire; renchérissez sur ses jalousies, sur ses injustices,
sur ses menaces. Effrayez-le, fatiguez-le d'émotions.
Tâchez de l'ennuyer à force d'exigences. Faites l'amante
espagnole à votre tour, et rendez-le si malheureux, qu'il
désire vous quitter. Tâchez qu'il fasse le premier pas
vers une rupture, et qu'il le fasse violemment; alors vous
serez sauvée: il aura eu les premiers torts. Votre empressement
à en profiter pour l'abandonner sera de la
fierté légitime, la dignité d'un grand caractère, la colère
implacable d'un grand amour! Je vous réponds du reste.
Je m'emparerai de lui quand l'occasion sera venue; j'écouterai
ses plaintes, je lui prouverai qu'il est le seul
coupable, et, tout en vous haïssant, il sera forcé de vous
respecter. Il vous importunera peut-être, il fera des folies
pour arriver jusqu'à vous. Soyez sans pitié. Peut-être se
brûlera-t-il la cervelle, mais seulement un peu; il a trop
d'esprit pour vouloir renoncer aux beaux romans dont
son avenir est gros. Toutes les extravagances qu'il pourra
faire alors pour vous, loin de vous compromettre, tourneront
au triomphe de votre fierté. Tout le monde saura
peut-être que ce jeune homme vous adore; mais on saura
aussi que vous le réduisez au désespoir; et s'il lui arrive
de se vanter du passé dans sa colère, on le regardera
comme un fat ou comme un fou. De tout ceci, ma belle
amie, il résultera pour vous un surcroît de gloire. Votre
puissance sera plus enviée que jamais par les femmes, et
les hommes viendront se prosterner par centaines à vos
genoux.»
La vicomtesse suivit fidèlement le conseil de son mentor.
Elle joua si bien la passion, qu'Horace eu fut épouvanté.
Des qu'elle le vit reculer, elle avança, et ne craignit
pas d'exiger de lui qu'il l'enlevât. Cette idée sourit
d'abord à Horace, à cause du retentissement qu'aurait
une pareille aventure, et de l'honneur que lui ferait,
dans la province et même dans le monde, la passion
échevelée d'une dame de ce rang et de cet esprit. La vicomtesse
frémit en le voyant irrésolu; mais, au bout de
vingt quatre heures, Horace s'effraya de l'idée de vivre
avec une maîtresse aussi jalouse et aussi impérieuse. Il
songea à la souffrance qu'il éprouverait lorsque les curieux,
se précipitant sur ses pas pour le voir passer avec
sa conquête, l'un dirait: «Tiens! elle n'est pas plus
belle que cela?» l'autre: «Elle n'est, pardieu, pas
jeune!» Et, tout bien considéré, il refusa le sacrifice
qu'elle lui offrait, sous prétexte qu'il était pauvre, et
qu'il ne pouvait se résoudre à faire partager sa misère à
une femme comme elle, bercée dans l'opulence. Ce prétexte
était d'ailleurs assez bien fondé. La vicomtesse feignit
de n'en tenir compte, de dédaigner les richesses, de
vouloir braver le monde, qu'elle prétendait haïr et mépriser.
Mais dès qu'elle se fut bien assurée de la répugnance
sincère d'Horace à prendre ce parti, elle l'accusa
de ne point l'aimer; elle feignit d'être jalouse d'Eugénie;
elle inventa je ne sais quels sujets absurdes de soupçon
et de ressentiment. Elle pleura même, et s'arracha quelques
faux cheveux. Puis tout à coup elle chassa Horace
de son boudoir, fit ses apprêts de départ, refusa de recevoir
ses excuses et ses adieux, et s'en retourna à Paris,
bien fatiguée du drame qu'elle venait de jouer, bien satisfaite
d'être enfin délivrée du sujet de ses terreurs.
De ce moment, ainsi que l'avait prédit le marquis, sa
victoire fut assurée; et Horace, tout en la plaignant de
sa prétendue douleur, tout en se réjouissant de n'avoir
plus à en subir les violences, se sentit le plus faible,
parce qu'il se crut le plus froid.
Les jeunes gens nobles du pays qui avaient composé
la cour ordinaire de Léonie restèrent dans leurs châteaux
pour s'y adonner au plaisir de la chasse durant l'automne;
et l'un d'eux, qui avait pris Horace en amitié, et
qui le tenait sérieusement pour un grand homme, l'invita
à venir achever la saison dans ses terres. Horace
accepta cette offre avec plaisir. Son hôte était riche et
garçon. Il avait peu d'esprit, aucune instruction, un bon
coeur et de bonnes manières. C'était l'homme qu'Horace
pouvait éblouir de son érudition et charmer par le brillant
de son esprit, en même temps qu'il trouvait à profiter
dans son commerce pour se former aux habitudes
aristocratiques, dont il était alors plus que jamais infatué.
Son premier besoin fut d'oublier les semaines d'agitation
pénible qu'il venait de subir, et la maison de Louis
de Méran lui fut un lieu de délices. Avoir de beaux chevaux
à monter, un tilbury à sa disposition, des armes
magnifiques et des chiens excellents pour la chasse, une
bonne table, de gais convives, voire quelques autres
distractions dont il ne se vanta pas à moi après tout le
mépris qu'il avait témoigné pour ce genre de plaisir,
mais auxquelles il s'abandonna en voyant ses modèles les
dandys vanter et cultiver la débauche: c'en fut assez
pour l'étourdir et l'enivrer jusqu'aux approches de l'hiver.
Comme il était réellement supérieur par son intelligence
à tous ses nouveaux amis, il rachetait à force
d'esprit le défaut de naissance, de fortune et d'usage,
dont, au reste, on ne lui eût fait un tort que s'il en eût
fait parade; mais il s'en garda bien. Il craignit tellement
de voir l'orgueil de ces jeunes gens s'élever au-dessus du
sien, qu'il leur laissa croire qu'il était d'une bonne famille
de robe, et jouissait d'une honnête aisance. L'exiguïté
de sa valise donnait bien un démenti à ses gasconnades:
mais il était en voyage; c'était par hasard qu'il
s'était arrêté dans ce pays, où il était venu seulement
avec l'intention de passer quelques jours; et pour rendre
excusable aux yeux de Louis de Méran, la légèreté de sa
bourse, qui était par trop évidente, il feignit plusieurs fois
de vouloir partir, afin, disait-il, d'aller chercher au moins
chez son banquier l'argent qui lui manquait.
«Qu'à cela ne tienne! lui dit son hôte, qui avait le
malheur de s'ennuyer lorsqu'il était seul dans son château,
et pour qui Horace était une société agréable, ma
bourse est à votre disposition. Combien vous faut-il?
Voulez-vous une centaine de louis?
—Il ne me faut rien qu'une centaine de francs, s'écria
Horace, à qui une offre aussi magnifique fit ouvrir de
grands yeux, et qui jusque-là ne s'était tourmenté que
de la manière dont il donnerait le pourboire aux laquais
de la maison en s'en allant.
—Vous n'y songez pas! lui dit son ami: nous allons
avoir une grande réunion de jeunes gens, à l'occasion
d'une sorte de fête villageoise où nous allons tous, et où
nous passons quelquefois huit jours en parties de plaisir.
On y joue un jeu d'enfer. Il faudra que vous puissiez
jeter quelques poignées d'or sur la table, si vous ne voulez,
vous, inconnu dans la province, passer pour une espèce.»
Bien qu'Horace sût parfaitement qu'il ne pourrait jamais
rendre cet argent, à moins d'être heureux au jeu,
il n'eut pas plus tôt entrevu cette chance de succès, qu'il
s'y confia aveuglément, et accepta les offres de son ami.
Il n'avait jamais joué de sa vie, parce qu'il n'avait jamais
été à même de le faire, et il ignorait tous les jeux excepté
le billard, où il était de première force, ce qui lui
avait valu l'estime de plusieurs des graves personnages
au milieu desquels il s'était lancé. Il eut bientôt compris
la bouillotte en les voyant s'y exercer, et le jour de la
fête, il débuta avec passion dans cette nouvelle carrière
d'émotions et de périls. Il eut, pour son malheur à venir,
un bonheur insolent ce jour-là. Avec cent louis il en gagna
mille. Il se hâta de restituer la somme première à
Louis de Méran, mit de côté quatre cents louis, et continua
à jouer les jours suivants avec les cinq cents autres.
Il perdit, regagna, et, après plusieurs fluctuations de
la fortune, retourna enfin au château de Méran avec dix-sept
mille francs en or et en billets de banque dans sa valise.
Pour un jeune homme qui avait de grands besoins
d'argent, et qui n'avait jamais connu qu'un sort précaire,
c'était une fortune. Il en pensa devenir fou de joie, et je
crois bien qu'à partir de là il le devint réellement un
peu. Il vint nous voir pour nous faire part de son bonheur,
et ne songea pas à me restituer cent cinquante
louis qu'il me devait. Je n'osai le lui rappeler, quoique
je fusse assez gêné; je regardais comme impossible qu'il
l'oubliât. Cependant il ne s'en souvint jamais, et je
le lui pardonne de tout mon coeur, certain que sa volonté
n'y fut pour rien. L'empressement avec lequel il
vint m'annoncer sa richesse en est la meilleure preuve.
Son premier soin fut d'envoyer cent louis à sa mère;
mais il n'osa pas lui dire que c'était l'argent du jeu: la
bonne femme s'en fût effrayée plus que réjouie. Il lui
manda que c'était le prix de travaux littéraires auxquels
il se livrait dans mon ermitage, et qu'il envoyait à Paris
à un éditeur.
«Je prétends, me dit-il en riant, la réconcilier avec
la profession d'homme de lettres, qu'elle avait tant de
regret à me voir embrasser, et qu'elle va désormais regarder
comme très-honorable. Dans quelques mois je lui
enverrai encore un millier de francs, ainsi de suite, tant
que j'aurai de l'argent. Que ne puis-je lui faire passer dès
aujourd'hui la somme entière! Je serais si heureux de
pouvoir m'acquitter en un instant des sacrifices qu'elle
fait pour moi depuis que j'existe! Mais elle comprendrait
si peu ce qui m'arrive, qu'elle me demanderait des
explications impossibles; et les gens de ma province,
qui sont aussi judicieux que charitables, voyant la mère
Dumontet remonter sa vaisselle et acheter des robes à
sa fille, en concluraient certainement que, pour procurer
à ma famille une telle opulence, il faut que j'aie assassiné
quelqu'un. Il est vrai que mon bon père, qui se
pique un peu de belles-lettres, voudra lire de ma prose
imprimée. Je lui dirai que j'écris sous un pseudonyme,
et je couperai, dans un volume de quelque poète mystique
allemand nouvellement traduit, une centaine de
pages que je lui enverrai en lui disant qu'elles sont de
moi. Il n'y verra que du feu, et il les montrera à tous
les beaux esprits de sa petite ville, qui, n'y comprenant
goutte, reconnaîtront enfin que je suis un homme supérieur.»
En disant ces folies, Horace, qui se moquait parfois
de lui-même de fort bonne grâce, éclata de rire. C'était
la vérité qu'il eût envoyé tout son argent à sa mère s'il
eût pu le faire à l'instant même sans l'effrayer. Son coeur
était généreux; et s'il se réjouissait tant d'être riche,
ce n'était pas tant à cause de la possession, qu'à cause
de l'espèce de victoire remportée sur ce qu'il appelait
son mauvais destin. Malheureusement il ne songea plus à
ses résolutions le lendemain. Sa mère ne reçut plus
rien de lui, et tous ses créanciers de Paris furent également
oubliés. Il ne lui resta, de cet instant de dévouement
enthousiaste, qu'une sorte d'orgueil insensé et bizarre,
qui consistait à croire à son étoile en fait de succès
d'argent, comme Napoléon croyait à la sienne en fait
de gloire militaire. Cette confiance absurde en une providence
occupée à favoriser ses caprices, et en un dieu disposé
à intervenir dans toutes ses entreprises, le rendit
vain et téméraire. Il commença à mener le train d'un
jeune homme pour qui quinze mille francs auraient été le
semestre d'une pension de trente mille. Il acheta un cheval,
sema les pièces d'or à tous les valets de son hôte, écrivit
à Paris à son tailleur qu'il avait fait un héritage, et qu'il
eût à lui envoyer les modes les plus nouvelles. Quinze
jours après, il se montra équipé le plus ridiculement du
monde. Ses amis se moquèrent de cet accoutrement de
mauvais goût, et lui conseillèrent de destituer son tailleur
du quartier latin pour une célébrité de la fashion.
Il distribua aussitôt sa nouvelle garde-robe aux piqueurs
de ces messieurs, et en commanda une autre à Humann,
qui habillait Louis de Méran. Recommandé par ce jeune
homme élégant et riche, il eut chez ce prince des tailleurs
un crédit ouvert dont il ne s'inquiéta pas, et qui
creusa sous lui comme un gouffre invisible.
Les joyeux compagnons qui l'entouraient, dès qu'ils le
virent insolemment prodigue et revêtu d'un costume de
dandy qui déguisait incroyablement son origine plébéienne,
l'adoptèrent tout à l'ait, et firent de lui le plus
grand cas. Ce n'est plus le temps, c'est l'argent qui est
un grand maître. Horace, n'étant plus retenu et contristé
par la misère, se livra à tous les élans de sa brillante
gaieté et de son audacieuse imagination. L'argent fit en
lui des miracles; car il lui rendit, avec la confiance en
l'avenir et les jouissances du présent, l'aptitude au travail,
qu'il semblait avoir à jamais perdue. Il retrouva
toutes ses facultés, émoussées par les chagrins et les soucis
de l'hiver précédent. Son humeur redevint égale et
enjouée. Ses idées, sans devenir plus justes, se coordonnèrent
et s'étendirent. Son style se forma tout à coup.
Il écrivit un petit roman fort remarquable, dont la triste
Marthe fut l'héroïne, et ses amours le sujet. Il s'y donna
un plus beau rôle qu'il ne l'avait eu dans la réalité; mais
il y motiva et y poétisa ses fautes d'une manière très-habile.
L'on peut dire que son livre, s'il eût eu plus de
retentissement, eût été un des plus pernicieux de l'époque
romantique. C'était non pas seulement l'apologie,
mais l'apothéose de l'égoïsme. Certainement Horace valait
mieux que son livre; mais il y mit assez de talent
pour donner à cet ouvrage une valeur réelle. Comme il
était riche alors, il trouva facilement un éditeur; et le
roman, imprimé à ses frais, et publié peu du temps
après son retour à Paris, eut une sorte de succès, surtout
dans le monde élégant.
Cette vie de luxe, mêlée de travail intellectuel et d'activité
physique, était l'idéal et l'élément véritable d'Horace.
Je remarquai que sa parole et ses manières, d'abord
ridicules lorsqu'il avait voulu les transformer de bourgeoises
en patriciennes, devinrent gracieuses et dignes,
lorsque fort de son propre mérite et riche de son propre
argent, il ne chercha plus, en se réformant, à imiter
personne. A Paris, ses nouveaux amis le présentèrent
dans diverses maisons riches ou nobles, où il vit l'ancienne
bonne compagnie et le nouveau grand monde. Il
vit les fêtes des banquiers israélites, et les soirées moins
somptueuses et plus épurées de quelques duchesses. Il
entra partout avec aplomb, certain de n'être déplacé
nulle part, après avoir été l'amant et l'élève de la précieuse
vicomtesse de Chailly.
Au bout de deux mois d'une telle vie, Horace fut complètement
transfiguré. Il vint nous voir un matin dans
son tilbury, avec son groom pour tenir son beau cheval.
Il monta nos cinq étages comme s'il n'eût fait autre
chose de sa vie, et eut le bon goût de ne pas paraître
essoufflé. Sa mise était irréprochable; sa chevelure inculte
avait enfin été domptée par Boucherot, successeur
de Michalon. Il avait la main blanche comme celle d'une
femme, les ongles taillés en biseau, des bottes vernies
et une canne Verdier. Mais ce qu'il y avait de plus extraordinaire,
c'est qu'il avait pris un ton parfaitement
naturel, et qu'il était impossible de deviner que tout cela
fût le résultat d'une étude. La seule chose qui trahit la
nouveauté de sa métamorphose, c'était l'espèce de joie
triomphante qui éclairait son front comme une auréole.
Eugénie, à qui il baisa la main en arrivant (pour la première
fois de sa vie), eut un peu de peine d'abord à tenir
son sérieux, et finit par s'étonner autant que moi de
la facilité avec laquelle ce jeune papillon avait dépouille
sa chrysalide. Il avait été à si bonne école, qu'il avait
appris non-seulement à se bien tenir, mais encore à
bien causer. Il ne parlait plus de lui; il nous questionnait
sur tout ce qui pouvait nous intéresser personnellement,
et il avait l'air de s'y intéresser lui-même. Nous avions
vu ses premiers efforts pour atteindre au type qu'il possédait
enfin, et nous étions émerveillés qu'il eût déjà
perdu l'enflure et l'arrogance du parvenu. «Parle-moi
donc de toi un peu, lui dis-je. Tes affaires me paraissent
florissantes. J'espère que ta nouvelle fortune ne repose
pas entièrement sur les cartes, mais bien sur la littérature,
où tu as fait un si joli début.—L'argent du jeu
tire à sa fin, me répondit-il naïvement; j'espère bien le
renouveler en puisant à la même source, et jusqu'ici mes
essais ne sont pas malheureux; mais comme il faut être
en mesure de perdre, j'ai songé à la littérature, comme
à un fonds plus solide. Mon éditeur m'a versé ces jours-ci
trois mille francs pour un petit volume que je lui ferai en
une quinzaine de jours; et si le public reçoit celui-là
avec autant d'indulgence que l'autre, j'espère que je ne
me trouverai plus à court d'argent.» trois mille francs un
petit volume, pensai-je, c'est un peu cher; mais tout
dépend des arrangements.
«Il faut, lui dis-je, que je te parle de ce roman que
tu viens de publier.—Oh! je t'en prie, s'écria-t-il, ne
m'en parle pas. C'est si mauvais, que je voudrais bien
n'en entendre jamais parler.—Ce n'est pas mauvais le
moins du monde, repris-je: on peut même dire, au point
de vue de l'art, que c'est une paraphrase très-remarquable
d'Adolphe, ce petit chef-d'oeuvre littéraire de
Benjamin Constant, que tu sembles avoir pris pour modèle.»
Ce compliment ne plut pas beaucoup à Horace; sa figure
changea tout d'un coup.
«Tu trouves, me dit-il en s'efforçant de garder son
air indifférent, que mon livre est un pastiche? C'est
bien possible: mais je n'y ai pas songé, d'autant plus
que je n'ai jamais lu Adolphe.
—Je te l'ai prêté cependant l'année dernière.
—Tu crois?
—J'en suis certain.
—Ah! je ne m'en souviens pas. Alors mon livre est
une réminiscence.
—Il est impossible, repris-je, que le premier ouvrage
d'un auteur de vingt ans soit autre chose; mais comme
le tien est bien fait, bien écrit et intéressant, personne
ne s'en plaint. Cependant, au risque d'être pédant, je
veux te gronder un peu quant au sujet. Tu as fait, ce me
semble, la réhabilitation de l'égoïsme...
—Ah! mon cher, laissons cela, je t'en prie, dit Horace
avec un peu d'ironie, tu parles comme un journaliste.
Je te vois venir! tu vas me dire que mon livre est
une mauvaise action. J'ai lu au moins ce mois-ci quinze
feuilletons qui finissaient de même.»
J'insistai. Je lui fis un peu la guerre; je combattis ses
théories de l'art pour l'art avec une sorte d'obstination
dont je me faisais un devoir d'amitié envers lui, mais
contre laquelle ne tint pas longtemps le vernis de modestie
enjouée que l'élude du goût lui avait donné.
Il s'impatienta, se défendit avec humeur, attaqua mes
idées avec amertume; et, perdant peu à peu toutes ses
grâces et tout son calme d'emprunt pour revenir à ses
anciennes déclamations, à ses éclats de voix, à ses gestes
de théâtre, même à quelques-unes de ces locutions de
café-billard du quartier latin, il laissa le vieil homme
sortir du sépulcre mal blanchi où il avait prétendu l'enfermer.
Quand il s'aperçut de ce qui lui arrivait, il en
fut si honteux et si courroucé intérieurement, qu'il devint
tout à coup sombre et taciturne. Mais ceci n'était pas
plus nouveau pour nous que sa colère bruyante: nous
l'avions si souvent vu passer de la déclamation à la bouderie!
«Tenez, Horace, lui dit Eugénie en lui posant familièrement
ses deux mains sur les épaules, tout charmant
que vous étiez au commencement de votre visite, et tout
maussade que vous voilà maintenant, je vous aime encore
mieux ainsi. Au moins c'est vous, avec tous vos défauts,
que nous savons par coeur, et qui ne nous empêchent
pas de vous aimer; au lieu que, quand vous voulez
être accompli, nous ne vous reconnaissons plus, et nous
ne savons que penser.
—Grand merci, ma belle,» dit Horace en cherchant
à l'embrasser cavalièrement pour la punir de son impertinence.
Mais elle s'en préserva en le menaçant d'une
petite balafre de son aiguille au visage, ce qui l'eût empêché
de paraître le soir dans le monde, et il ne s'y
exposa point. Il essaya de reprendre son air aisé et ses
manières distinguées avant de nous quitter; mais il n'en
put venir à bout, et, se sentant gauche et guindé, il
abrégea sa visite.
«Je crains que nous ne l'ayons fâché, et qu'il ne revienne
pas de si tôt, dis-je à Eugénie lorsqu'il fut parti.
—Nous le reverrons quand il aura gagné encore de
l'argent, et qu'il aura un coupé à deux chevaux à nous
faire voir, répondit-elle.
—Pendant un quart d'heure je l'ai cru corrigé de tous
ses défauts, repris-je, et je m'en réjouissais.
—Et moi, je m'en affligeais, dit Eugénie; car il me
semblait être arrivé à l'impudence, qui est le pire de
tous les vices. Heureusement, voyez-vous, il ne pourra
jamais s'empêcher d'être ridicule, parce qu'en dépit de
toutes ses affectations, il a un fonds de naïveté qui l'emporte.»
Ce même jour, nous fûmes surpris et bouleversés par
une visite autrement agréable. Comme nous étions encore
penchés sur le balcon pour suivre de l'oeil le rapide
tilbury d'Horace, nous remarquâmes qu'il faillit, au détour
du pont, écraser un homme et une femme qui venaient
à sa rencontre en se donnant le bras, et en causant
la tête baissée, sans faire attention à ce qui se passait
autour d'eux. Horace cria: Gare donc! d'une voix retentissante
qui monta jusqu'à nous par-dessus tous les bruits
du dehors, et nous le vîmes fouetter son cheval fougueux
avec quelque intention d'effrayer ces gens malappris qui
l'avaient forcé de s'arrêter une seconde. Nos yeux suivirent
involontairement ce couple modeste qui venait
toujours de notre côté, et qui semblait n'avoir remarqué
ni le dandy ni son équipage. Ils marchaient appuyés
l'un sur l'autre, et plus lentement que tous les gens
affairés qui suivaient le trottoir.
«As-tu jamais observé, me dit Eugénie, qu'on peut
deviner, à l'allure de deux personnes de sexe différent
qui se donnent le bras, le sentiment qu'elles ont l'une
pour l'autre? Voici un couple qui s'adore, je le parierais!
ils sont jeunes tous deux, je lu vois à leur taille et
à leur démarche. La femme doit être jolie, du moins elle
a une tournure charmante; et à la manière dont elle
s'appuie sur le bras de ce jeune mari ou de ce nouvel
amant, je vois qu'elle est heureuse de lui appartenir.
—Voilà tout un roman dont ces deux passants ne se
doutent peut-être guère, répondis-je. Mais vois donc,
Eugénie! à mesure que cet homme s'approche, il me
semble le reconnaître. Il a fait un geste comme Arsène;
il lève la tête vers notre balcon. Mon Dieu! si c'était lui?
—Je ne vois pas ses traits de si haut, dit Eugénie;
mais quelle serait donc cette femme qu'il accompagne?
A coup sur, ce n'est ni Suzanne ni Louison.
—C'est Marthe! m'écriai-je. J'ai de bons yeux; elle
nous a regardés, elle entre ici... Oui, Eugénie, c'est
Marthe avec Paul Arsène!
—Ne me fais pas de pareils contes! dit Eugénie tout
émue en s'arrachant du balcon. Ce sont de fausses joies
que tu me donnes.»
J'étais si sûr de mon fait, que je m'élançai sur l'escalier
à la rencontre de ces deux revenants, qui, un instant
après, pressaient Eugénie dans leurs bras entrelacés.
Eugénie, qui les avait crus morts l'un et l'autre, et qui
les avait amèrement pleurés, faillit s'évanouir en les retrouvant,
et ne reprit la force de les embrasser qu'en les
arrosant de larmes. Cet accueil les toucha vivement, et
ils passèrent plusieurs heures avec nous, durant lesquelles
ils nous informèrent complaisamment des moindres
détails de leur histoire et de leur vie présente.
Quand Eugénie sut que son amie était actrice, elle la
regarda avec surprise, et me dit en la montrant:
«Vois donc comme elle est toujours la même! elle a
embelli, elle est mise avec plus d'élégance; mais sa voix,
son ton, ses manières, rien n'a changé. Tout cela est
aussi simple, aussi vrai, aussi aimable que par le passé.
Ce n'est pas comme...» Et elle s'arrêta pour ne pas prononcer
un nom que Marthe, dans son récit, avait répété
cependant plusieurs fois sans émotion pénible. Mais à
chaque instant, Eugénie, en regardant Paul et Marthe,
et en poursuivant intérieurement son parallèle avec Horace,
ne pouvait s'empêcher de s'écrier:
«Mais ce sont eux! ils n'ont pas changé. Il me semble
que je les ai quittés hier.»
Marthe voulut avoir l'explication de ces réticences, et
je jugeai qu'il valait mieux lui parler ouvertement et naturellement
d'Horace que de la forcer à nous interroger
sur son compte. Je lui racontai la visite qu'il venait de
nous faire, et tout ce qui devait expliquer cette opulence
soudaine. Je lui parlai même de ses relations avec la vicomtesse
de Chailly. Je crus devoir le faire pour mettre
la dernière main, s'il en était besoin, à la guérison de
cette âme sauvée. Elle en sourit de pitié, frémit légèrement,
et, se jetant dans le sein de son époux, elle lui dit
avec un sourire doux et triste:
«Tu vois que je connaissais bien Horace!»
Ils furent forcés de nous quitter à quatre heures.
Marthe jouait le soir même. Nous allâmes l'entendre, et
nous revînmes tout émus et tout bouleversés de son talent,
joyeux jusqu'aux larmes d'avoir retrouvé ces deux
êtres chéris, unis enfin et heureux l'un par l'autre.
More History
|