|


 Explorers, Scientists &
Inventors
Explorers, Scientists &
Inventors
 Musicians, Painters &
Artists
Musicians, Painters &
Artists
 Poets, Writers &
Philosophers
Poets, Writers &
Philosophers
 Native Americans & The Wild
West
Native Americans & The Wild
West
 First Ladies
First Ladies
 Popes
Popes
 Troublemakers
Troublemakers
 Historians
Historians
 Archaeologists
Archaeologists
 Royal
Families
Royal
Families
 Tribes & Peoples
Tribes & Peoples
Assassinations in History
Who
got slain, almost slain, when, how,
why, and by whom?
 Go to the
Assassination Archive
Go to the
Assassination Archive

Online History Dictionary A - Z



Voyages in History
When did what
vessel arrive with whom onboard and where
did it sink if it didn't?
 Go to the
Passage-Chart
Go to the
Passage-Chart


The Divine Almanac
Who all roamed the heavens in
olden times? The Who's Who of
ancient gods.
 Check out
the Divine Almanac
Check out
the Divine Almanac

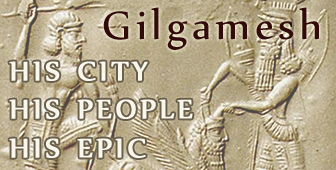
|
|
George Sand - Horace: Chapter 6-12
Notice
Chapter 1 - 5
Chapter 6 - 12
Chapter 13 - 19
Chapter 20 - 23
Chapter 24 - 26
Chapter 27 - 30
Chapter 31 - 33
|
|
VI.
Peu à peu Horace, avait daigné faire attention à la
beauté et aux bonnes manières de Laure: c'était le petit
nom que M. Poisson donnait à sa femme.
«Si cela était né sur un trône, disait-il souvent en la
regardant, la terre entière serait prosternée devant une
telle majesté.
—A quoi bon un trône? lui répondis-je; la beauté est
par elle-même une royauté véritable.
—Ce qui la distingue pour moi des autres teneuses de
comptoir, reprenait-il, c'est cette dignité froide, si différente
de leurs agaceries coquettes. En général, elles
vous vendent leurs regards pour un verre d'eau sucrée;
c'est à vous ôter la soif pour toujours. Mais celle-ci est,
au milieu des hommages grossiers qui l'environnent, une
perle fine dans le fumier; elle inspire vraiment une sorte
de respect. Si j'étais sûr qu'elle ne fût pas bête, j'aurais
presque envie d'en devenir amoureux.»
La vue de plusieurs jeunes gens qui, chaque jour,
s'évertuaient à fixer l'attention de la belle limonadière,
et qui eussent vraiment fait des folies pour elle, acheva
de piquer l'amour-propre d'Horace; mais il ne convenait
pas à tant d'orgueil de suivre la même route que ces
naïfs admirateurs. Il ne voulait pas être confondu dans
ce cortège: il lui fallait, disait-il, emporter la place d'assaut
au nez des assiégeants. Il médita ses moyens, et
jeta un soir une lettre passionnée sur le comptoir; puis
il resta jusqu'au lendemain sans se montrer, pensant que
cet air occupé, découragé ou dédaigneux, expliqué ensuite
par lui selon la circonstance, ferait un bon effet,
par contraste avec l'obsession de ses rivaux.
|
J'avais consenti à m'intéresser à cette folie, persuadé
intérieurement qu'elle servirait de leçon à la naissante
fatuité d'Horace, et qu'il en serait pour ses frais d'éloquence
épistolaire. Le lendemain je fus occupé plus que
de coutume, et nous nous donnâmes rendez-vous le soir
au café Poisson. La dame n'était pas à son comptoir:
Arsène remplissait à lui seul les fonctions de maître et
de valet, et il était si affairé, qu'à toutes nos questions
il ne répondit qu'un «je ne sais pas» jeté en courant
d'un air d'indifférence. M. Poisson ne paraissant pas davantage,
nous allions prendre le parti de nous retirer
sans rien savoir, lorsque Laravinière, le président des
bousingots, entra bruyamment au milieu de sa joyeuse
phalange.
J'ai lu quelque part une définition assez étendue de
l'étudiant, qui n'est certainement pas faite sans talent,
mais qui ne m'a point paru exacte. L'étudiant y est trop
rabaissé, je dirai plus, trop dégradé; il y joue un rôle
bas et grossier qui vraiment n'est pas le sien. L'étudiant
a plus de travers et de ridicules que de vices; et quand
il en a, ce sont des vices si peu enracinés, qu'il lui suffit
d'avoir subi ses examens et repassé le seuil du toit paternel,
pour devenir calme, positif, rangé; trop positif
la plupart du temps, car les vices de l'étudiant sont ceux
de la société tout entière, d'une société où l'adolescence
est livrée à une éducation à la fois superficielle et pédantesque,
qui développe en elle l'outrecuidance et la
vanité; où la jeunesse est abandonnée, sans règle et
sans frein, à tous les désordres qu'engendre le scepticisme,
où l'âge viril rentre immédiatement après dans
la sphère des égoïsmes rivaux et des luttes difficiles.
Mais si les étudiants étaient aussi pervertis qu'on nous
les montre, l'avenir de la France serait étrangement
compromis.
Il faut bien vite excuser l'écrivain que je blâme, en
reconnaissant combien il est difficile, pour ne pas dire
impossible, de résumer en un seul type une classe aussi
nombreuse que celle des étudiants. Eh quoi! c'est la
jeunesse lettrée en masse que vous voulez nous faire
connaître dans une simple effigie? Mais que de nuances
infinies dans cette population d'enfants à demi hommes
que Paris voit sans cesse se renouveler, comme des aliments
hétérogènes, dans le vaste estomac du quartier
latin! Il y a autant de classes d'étudiants qu'il y a de
classes rivales et diverses dans la bourgeoisie. Haïssez
la bourgeoisie encroûtée qui, maîtresse de toutes les
forces de l'État, en fait un misérable trafic; mais ne
condamnez pas la jeune bourgeoisie qui sent de généreux
instincts se développer et grandir en elle. En plusieurs
circonstances de notre histoire moderne, cette
jeunesse s'est montrée brave et franchement républicaine.
En 1830, elle s'est encore interposée entre le
peuple et les ministres déchus de la restauration, menacés
jusque dans l'enceinte où se prononçait leur jugement;
ç'a été son dernier jour de gloire.
Depuis, on l'a tellement surveillée, maltraitée et découragée,
qu'elle n'a pu se montrer ouvertement. Néanmoins,
si l'amour de la justice, le sentiment de l'égalité
et l'enthousiasme pour les grands principes et les grands
dévouements de la révolution française ont encore un
foyer de vie autre que le foyer populaire, c'est dans
l'âme de cette jeune bourgeoisie qu'il faut aller le chercher.
C'est un feu qui la saisit et la consume rapidement,
j'en conviens. Quelques années de cette noble
exaltation que semble lui communiquer le pavé brûlant
de Paris, et puis l'ennui de la province, ou le despotisme
de la famille, ou l'influence des séductions sociales,
ont bientôt effacé jusqu'à la dernière trace du généreux
élan.
Alors on rentre en soi-même, c'est-à-dire en soi seul,
on traite de folies de jeunesse les théories courageuses
qu'on a aimées et professées; on rougit d'avoir été fouriériste,
ou saint-simonien, ou révolutionnaire d'une manière
quelconque; on n'ose pas trop raconter quelles
motions audacieuses on a élevées ou soutenues dans les
sociétés politiques, et puis on s'étonne d'avoir souhaité
l'égalité dans toutes ses conséquences, d'avoir aimé le
peuple sans frayeur, d'avoir voté la loi de fraternité sans
amendement. Et au bout de peu d'années, c'est-à-dire
quand on est établi bien ou mal, qu'on soit juste-milieu,
légitimiste ou républicain, qu'on soit de la nuance des
Débats, de la Gazette ou du National, on inscrit sur
sa porte, sur son diplôme ou sur sa patente, qu'on n'a,
en aucun temps de sa vie, entendu porter atteinte à la
sacro-sainte propriété.
Mais ceci est le procès à faire, je le répète, à la société
bourgeoise qui nous opprime. Ne faisons pas celui de la
jeunesse, car elle a été ce que la jeunesse, prise en masse
et mise en contact avec elle-même, est et sera toujours,
enthousiaste, romanesque et généreuse. Ce qu'il y a de
meilleur dans le bourgeois, c'est donc encore l'étudiant;
n'en doutez pas.
Je n'entreprendrai pas de contredire dans le détail les
assertions de l'auteur, que j'incrimine sans aucune aigreur,
je vous jure. Il est possible qu'il soit mieux informé
des moeurs des étudiants que je ne puis l'être relativement
à ce qu'elles sont aujourd'hui; mais je dois en
conclure, ou que l'auteur s'est trompé, ou que les étudiants
ont bien changé; car j'ai vu des choses fort différentes.
Ainsi, de mon temps, nous n'étions pas divisés en
deux espèces, l'une, appelée les bambocheurs, fort nombreuse,
qui passait son temps à la Chaumière, au cabaret,
au bal du Panthéon, criant, fumant, vociférant dans
une atmosphère infecte et hideuse; l'autre fort restreinte,
appelée les piocheurs, qui s'enfermait pour
vivre misérablement, et s'adonner à un travail matériel
dont le résultat était le crétinisme. Non! il y avait bien
des oisifs et des paresseux, voire des mauvais sujets et
des idiots; mais il y avait aussi un très-grand nombre
de jeunes gens actifs et intelligents, dont les moeurs
étaient chastes, les amours romanesques, et la vie
empreinte d'une sorte d'élégance et de poésie, au
sein de la médiocrité et même de la misère. Il est
vrai que ces jeunes gens avaient beaucoup d'amour-propre,
qu'ils perdaient beaucoup de temps, qu'ils s'amusaient
à tout autre chose qu'à leurs études, qu'ils
dépensaient plus d'argent qu'un dévouement vertueux à
la famille ne l'eût permis; enfin, qu'ils faisaient de la
politique et du socialisme avec plus d'ardeur que de raison,
et de la philosophie avec plus de sensibilité que de
science et de profondeur. Mais s'ils avaient, comme je
l'ai déjà confessé, des travers et des ridicules, il s'en faut
de beaucoup qu'ils fussent vicieux, et que leurs jours
s'écoulassent dans l'abrutissement, leurs nuits dans l'orgie.
En un mot, j'ai vu beaucoup plus d'étudiants dans
le genre d'Horace, que je n'en ai vu dans celui de l'Étudiant
esquissé par l'écrivain que j'ose ici contredire.
Celui dont j'ai maintenant à vous faire le portrait,
Jean Laravinière, était un grand garçon de vingt-cinq
ans, leste comme un chamois et fort comme un taureau.
Ses parents ayant eu la coupable distraction de ne pas
le faire vacciner, il était largement sillonné par la petite-vérole,
ce qui était, pour son bonheur, un intarissable
sujet de plaisanteries comiques de sa part. Quoique
laide, sa figure était agréable, sa personne pleine d'originalité
comme son esprit. Il était aussi généreux qu'il
était brave, et ce n'était pas peu dire. Ses instincts de
combativité, comme nous disions en phrénologie, le
poussaient impétueusement dans toutes les bagarres, et
il y entraînait toujours une cohorte d'amis intrépides,
qu'il fanatisait par son sang-froid héroïque et sa gaieté
belliqueuse. Il s'était battu très-sérieusement en juillet;
plus tard, hélas! il se battit trop bien ailleurs.
C'était un tapageur, un bambocheur, si vous voulez;
mais quel loyal caractère, et quel dévouement magnanime!
Il avait toute l'excentricité de son rôle, toute l'inconséquence
de son impétuosité, toute la crânerie de sa
position. Vous eussiez pu rire de lui; mais vous eussiez
été forcé de l'aimer. Il était si bon, si naïf dans ses convictions,
si dévoué à ses amis! Il était censé carabin,
mais il n'était réellement et ne voulait jamais être autre
chose qu'étudiant émeutier, bousingot, comme on disait
dans ce temps-là. Et comme c'est un mot historique qui
s'en va se perdre, si l'on n'y prend garde, je vais tâcher
de l'expliquer.
Il y avait une classe d'étudiants, que nous autres (étudiants
un peu aristocratiques, je l'avoue) nous appelions,
sans dédain toutefois, étudiants d'estaminet.
Elle se composait invariablement de la plupart des étudiants
de première année, enfants fraîchement arrivés
de province, à qui Paris faisait tourner la tête, et qui
croyaient tout d'un coup se faire hommes en fumant à se
rendre malades, et en battant le pavé du matin au soir,
la casquette sur l'oreille; car l'étudiant de première année
a rarement un chapeau. Dès la seconde année, l'étudiant
en général devient plus grave et plus naturel. Il
est tout à fait retiré de ce genre de vie, à la troisième.
C'est alors qu'il va au parterre des Italiens, et qu'il commence
à s'habiller comme tout le monde. Mais un certain
nombre de jeunes gens reste attaché à ces habitudes
de flânerie, de billard, d'interminables fumeries à l'estaminet,
ou de promenade par bandes bruyantes au jardin
du Luxembourg. En un mot, ceux-là font, de la récréation
que les autres se permettent sobrement, le fond
et l'habitude de la vie. Il est tout naturel que leurs manières,
leurs idées, et jusqu'à leurs traits, au lieu de se
former, restent dans une sorte d'enfance vagabonde et
débraillée, dans laquelle il faut se garder de les encourager,
quoiqu'elle ait certainement ses douceurs et
même sa poésie. Ceux-là se trouvent toujours naturellement
tout portés aux émeutes. Les plus jeunes y vont
pourvoir, d'autres y vont pour agir; et, dans ce temps-là,
presque toujours tous s'y jetaient un instant et s'en
retiraient vite, après avoir donné et reçu quelques bons
coups. Cela ne changeait pas la face des affaires, et la
seule modification que ces tentatives aient apportée,
c'est un redoublement de frayeur chez les boutiquiers,
et de cruauté brutale chez les agents de police. Mais aucun
de ceux qui ont si légèrement troublé l'ordre public
dans ce temps-là ne doit rougir, à l'heure qu'il est, d'avoir
eu quelques jours de chaleureuse jeunesse. Quand
la jeunesse ne peut manifester ce qu'elle a de grand et
de courageux dans le coeur que par des attentats à la société,
il faut que la société soit bien mauvaise!
On les appelait alors les bousingots, à cause du chapeau
marin de cuir verni qu'ils avaient adopté pour
signe de ralliement. Ils portèrent ensuite une coiffure
écarlate en forme de bonnet militaire, avec un velours
noir autour. Désignés encore à la police, et attaqués dans
la rue par les mouchards, ils adoptèrent le chapeau gris;
mais ils n'en furent pas moins traqués et maltraités. On
a beaucoup déclamé contre leur conduite; mais je ne
sache pas que le gouvernement ait pu justifier celle de
ses agents, véritables assassins qui en ont assommé un
bon nombre sans que le boutiquier en ait montré la
moindre indignation ou la moindre pitié.
Le nom de bousingots leur resta. Lorsque le Figaro,
qui avait fait une opposition railleuse et mordante
sous la direction loyale de M. Delatouche, passa en
d'autres mains, et peu à peu changea de couleur, le nom
de bousingot devint un outrage; car il n'y eut sorte de
moqueries amères et injustes dont on ne s'efforçât de
le couvrir. Mais les vrais bousingots ne s'en émurent
point, et notre ami Laravinière conserva joyeusement
son surnom de président des bousingots, qu'il porta
jusqu'à sa mort, sans craindre ni mériter le ridicule ou
le mépris.
Il était si recherché et si adoré de ses compagnons,
qu'on ne le voyait jamais marcher seul. Au milieu du
groupe ambulant qui chantait ou criait toujours autour
de lui, il s'élevait comme un pin robuste; et fier au sein
du taillis, ou comme la Calypso de Fénelon au milieu du
menu fretin de ses nymphes, ou enfin comme le jeune
Saül parmi les bergers d'Israël. (Il aimait mieux cette
comparaison.) On le reconnaissait de loin à son chapeau
gris pointu à larges bords, à sa barbe de chèvre, à ses
longs cheveux plats, à son énorme cravate rouge sur laquelle
tranchaient les énormes revers blancs de son gilet
à la Marat. Il portait généralement un habit bleu à longues
basques et à boutons de métal, un pantalon à larges
carreaux gris et noirs, et un lourd bâton de cormier
qu'il appelait son frère Jean, par souvenir du bâton de
la croix dont le frère Jean des Entommeures fit, selon
Rabelais, un si horrificque carnage des hommes d'armes
de Pichrocole. Ajoutez à cela un cigare gros comme
une bûche, sortant d'une moustache rousse à moitié
brûlée, une voix rauque qui s'était cassée, dans les premiers
jours d'août 1830, à détonner la Marseillaise, et
l'aplomb bienveillant d'un homme qui a embrassé plus
de cent fois Lafayette, mais qui n'en parle plus en 1831
qu'en disant: Mon pauvre ami; et vous aurez au grand
complet Jean Laravinière, président des bousingots.
VII.
—Vous demandez madame Poisson? dit-il à Horace,
qui n'accueillait pas trop bien en général sa familiarité.
Eh bien! vous ne verrez plus madame Poisson. Absente
par congé, madame Poisson. Pas mal fait. M. Poisson ne
la battra plus.
—Si elle avait voulu me prendre pour son défenseur,
s'écria le petit Paulier, qui n'était guère plus gros qu'une
mouche, elle n'aurait pas été battue deux fois. Mais
enfin, puisque c'est le président qu'elle a honoré de sa
préférence....
—Excusez! cela n'est pas vrai, répondit le président
des bousingots en élevant sa voix enrouée pour que tout
le monde l'entendît. A moi, Arsène, un verre de rhum!
j'ai la gorge en feu. J'ai besoin de me rafraîchir.
Arsène vint lui verser du rhum, et resta debout près
de lui, le regardant attentivement avec une expression
indéfinissable.
«Eh bien, mon pauvre Arsène, reprit Laravinière
sans lever les yeux sur lui et tout en dégustant son petit
verre: tu ne verras plus ta bourgeoise! Cela te fait plaisir
peut-être? Elle ne t'aimait guère, ta bourgeoise?
—Je n'en sais rien, répondit Arsène de sa voix claire
et ferme; mais où diable peut-elle être?
—Je te dis qu'elle est partie. Partie, entends-tu bien?
Cela veut dire qu'elle est où bon lui semble; qu'elle est
partout excepté ici.
—Mais ne craignez-vous pas d'affliger ou d'offenser
beaucoup le mari en parlant si haut d'une pareille affaire?
dis-je en jetant les yeux vers la porte du fond, où
nous apparaissait ordinairement M. Poisson vingt fois
par heure.
—Le citoyen Poisson n'est pas céans, répondit le
bousingot Louvet: nous venons de le rencontrer à l'entrée
de la Préfecture de police, où il va sans doute demander
des informations. Ah! dame, il cherche; il cherchera
longtemps. Cherche, Poisson, cherche! Apporte!
—Pauvre bête! reprit un autre. Ça lui apprendra
qu'on ne prend pas les mouches avec du vinaigre. Arsène?
à moi, du café!
—Elle a bien fait! dit un troisième. Je ne l'aurais jamais
crue capable d'un pareil coup de tête, pourtant!
Elle avait l'air usé par le chagrin, cette pauvre femme!
A moi, Arsène, de la bière!»
Arsène servait lestement tout le monde, et il venait
toujours se planter derrière Laravinière, comme s'il eût
attendu quelque chose.
«Eh! qu'as-tu là à me regarder? lui dit Laravinière,
qui le voyait dans la glace.
—J'attends pour vous verser un second petit verre,
répondit tranquillement Arsène.
—Joli garçon, va! dit le président en lui tendant son
verre. Ton coeur comprend le mien. Ah! si tu avais pu
te poser ainsi en Hébé à la barricade de la rue Montorgueil,
l'année passée, à pareille époque! J'avais une si
abominable soif! Mais ce gamin-là ne songeait qu'à descendre
des gendarmes. Brave comme un lion, ce gamin-là!
Ta chemise n'était pas aussi blanche au'aujourd'hui,
hein? Rouge de sang et noire de poudre. Mais où diable
as-tu passé depuis?
—Dis-nous donc plutôt où madame Poisson a passé la
nuit, puisque tu le sais? reprit Paulier.
—Vous le savez? s'écria Horace le visage en feu.
—Tiens! ça vous intéresse, vous? répondit Laravinière.
Ça vous intéresse diablement, à ce qu'il parait!
Eh bien! vous ne le saurez pas, soit dit sans vous lâcher;
car j'ai donné ma parole, et vous comprenez.
—Je comprends, dit Horace avec amertume, que
vous voulez nous donner à entendre que c'est chez vous
que s'est retirée madame Poisson.
—Chez moi! je le voudrais: ça supposerait que j'ai
un chez moi. Mais pas de mauvaises plaisanteries, s'il
vous plaît. Madame Poisson est une femme fort honnête,
et je suis sûr qu'elle n'ira jamais ni chez vous ni
chez moi.
—Raconte-leur donc comment tu l'as aidée à se sauver?
dit Louvet en voyant avec quel intérêt nous cherchions
à deviner le sens de ses réticences.
—Voilà! écoutez! répondit le président. Je peux bien
le dire: cela ne fait aucun tort à la dame. Ah! tu écoutes,
toi? ajouta-t-il en voyant Arsène toujours derrière
lui. Tu voudrais faire le capon, et redire cela à ton bourgeois.
—Je ne sais pas seulement de quoi vous parlez, répondit
Arsène en s'asseyant sur une table vide et en ouvrant
un journal. Je suis là pour vous servir: si je suis
de trop, je m'en vas.
—Non, non! reste, enfant de juillet! dit Laravinière.
Ce que j'ai à dire ne compromet personne.»
C'était l'heure du dîner des habitants du quartier. Il
n'y avait dans le café que Laravinière, ses amis et nous.
Il commença son récit en ces termes:
«Hier soir... je pourrais aussi bien dire ce matin
(car il était minuit passé, près d'une heure), je revenais
tout seul à mon gîte, c'était par le plus long. Je ne vous
dirai ni d'où je venais, ni en quel endroit je fis cette
rencontre; j'ai posé mes réserves à cet égard. Je voyais
marcher devant moi une vraie taille de guêpe, et cela
avait un air si comme il faut, cela avait la marche si
peu agaçante que nous connaissons, que j'ai hésité par
trois fois... Enfin, persuadé que ce ne pouvait être autre
chose qu'un phalène, je m'avance sur la même ligne;
mais je ne sais quoi de mystérieux et d'indéfinissable
(style choisi, mes enfants!) m'aurait empêché d'être
grossier, quand même la galanterie française ne serait
pas dans les moeurs de votre président.—Femme
charmante, lui dis-je, pourrait-on vous offrir le bras?—Elle
ne répond rien et ne tourne pas la tête. Cela m'étonne.
Ah bah! elle est peut-être sourde, cela s'est vu.
J'insiste. On me fait doubler le pas.—N'ayez donc pas
peur!—Ah!—-Un petit cri, et puis on s'appuie sur le
parapet.
—Parapet? c'était sur le quai, dit Louvet.
—J'ai dit parapet comme j'aurais dit borne, fenêtre,
muraille quelconque. N'importe! je la voyais trembler
comme une femme qui va s'évanouir. Je m'arrête, interdit.
Se moque-t-on de moi?—Mais, Mademoiselle,
n'ayez donc pas peur.—Ah! mon Dieu! c'est vous,
monsieur Laravinière?—Ah! mon Dieu! c'est vous, madame
Poisson? (Et voilà, un coup de théâtre!)—Je suis
bien aise de vous rencontrer, dit-elle d'un ton résolu.
Vous êtes un honnête homme, vous allez me conduire.
Je remets mon sort entre vos mains, je me lie à vous. Je
demande le secret.—Me voilà, Madame, prêt à passer
l'eau et le feu pour vous et avec vous. Elle prend mon
bras.—Je pourrais vous prier de ne pas me suivre, et je
suis sûre que vous n'insisteriez pas; mais j'aime mieux
me confier à vous. Mon honneur sera en bonnes mains;
vous ne le trahirez pas.»
«J'étends la main, elle y met la sienne. Voilà la tête
qui me tourne un peu, mais c'est égal. J'offre mon bras
comme un marquis, et sans me permettre une seule
question, je l'accompagne...
—Où, demanda Horace impatient.
—Où bon lui semble, répondit Laravinière. Chemin
faisant:—Je quitte M. Poisson pour toujours, me répondit-elle;
mais je ne le quitte pas pour me mal conduire.
Je n'ai pas d'amant, Monsieur; je vous jure devant
Dieu, qui veille sur moi, puisqu'il vous a envoyé
vers moi en ce moment, que je n'en ai pas et n'en veux
pas avoir. Je me soustrais à de mauvais traitements,
et voilà tout. J'ai un asile, chez une amie, chez une
femme honnête et bonne; je vais vivre de mon travail.
Ne venez pas me voir; il faut que je me tienne dans une
grande réserve après une pareille fuite; mais gardez-moi
un souvenir amical, et croyez que je n'oublierai jamais...
Nouvelle poignée de main; adieu solennel, éternel peut-être,
et puis, bonsoir, plus personne. Je sais où elle est,
mais je ne sais chez qui, ni avec qui. Je ne chercherai
pas à le savoir, et je ne mettrai personne sur la voie de
le découvrir. C'est égal, je n'en ai pas dormi de la nuit
et me voilà amoureux comme une bête! À quoi cela me
servira-t-il?
—Et vous croyez, dit Horace ému, qu'elle n'a pas
d'amant, qu'elle est chez une femme, qu'elle...
—Ah! je ne crois rien, je ne sais rien, et peu m'importe!
Elle s'est emparée de moi. Me voilà forcé de tenir
ce que j'ai promis, puisqu'on m'a subjugué. Ces diables
de femmes! Arsène, du rhum! l'orateur est fatigué.»
Je regardai Arsène: son visage ne trahissait pas la
moindre émotion. Je cessai de croire à son amour pour
madame Poisson; mais, en voyant l'agitation d'Horace,
je commençai à penser que le sien prenait un caractère
sérieux. Nous nous séparâmes à la rue Gît-le-Coeur. Je
rentrai accablé de fatigue. J'avais passé la nuit précédente
auprès d'un ami malade, et je n'étais pas revenu
chez moi de la journée.
Quoique j'eusse vu briller de la lumière derrière mes
fenêtres, je fus tenté de croire qu'il n'y avait personne
chez moi, à la lenteur qu'Eugénie mit à me recevoir.
Ce ne fut qu'au troisième coup de sonnette qu'elle se
décida à ouvrir la porte, après m'avoir bien regardé et
interrogé par le guichet.
«Vous avez donc bien peur? lui dis-je en entrant.
—Très-peur, me répondit-elle; j'ai mes raisons pour
cela. Mais puisque vous voilà, je suis tranquille.»
Ce début m'inquiéta beaucoup. «Qu'est-il donc arrivé?
m'écriai-je.
—Rien que de fort agréable, répondit-elle en souriant,
et j'espère que vous ne me désavouerez pas; j'ai,
en votre absence, disposé de votre chambre.
—De ma chambre! grand Dieu! et moi qui ne me suis
pas couché la nuit dernière! Mais pourquoi donc? et que
veut dire cet air de mystère?
—Chut! ne faites pas de bruit! dit Eugénie en mettant
sa main sur ma bouche. Votre chambre est habitée
par quelqu'un qui a plus besoin de sommeil et de repos
que vous.
—Voilà une étrange invasion! Tout ce que vous faites
est bien, mon Eugénie, mais enfin...
—Mais enfin, mon ami, vous allez vous retirer de
suite, et demander à votre ami Horace ou à quelque
autre (vous n'en manquerez pas) de vous céder la moitié
de sa chambre pour une nuit.
—Mais vous me direz au moins pour qui je fais ce sacrifice?
—Pour une amie à moi, qui est venue me demander
un refuge dans une circonstance désespérée.
—Ah! mon Dieu! m'écriai-je, un accouchement dans
ma chambre! Au diable le butor à qui je dois cet enfant-là!
—Non, non! rien de pareil! dit Eugénie en rougissant.
Mais parlez donc plus bas, il n'y a point là d'affaire
d'amour proprement dite; c'est un roman tout à fait
pur et platonique. Mais, allez-vous-en.
—Ah ça, c'est donc une princesse enlevée pour qui
vous prenez tant de précautions respectueuses?
—Non; mais c'est une femme comme moi, et elle a
bien droit à quelque respect de votre part.
—Et vous ne me direz pas même son nom?
—A quoi bon ce soir? Nous verrons demain ce qu'on
peut vous confier.
—Et, c'est une femme?... dis-je avec un grand embarras.
—Vous en doutez?» répondit Eugénie en éclatant de
rire.
Elle me poussa vers la porte, et j'obéis machinalement.
Elle me rendit ma lumière, et me reconduisit jusqu'au
palier d'un air affectueux et enjoué, puis elle rentra,
et je l'entendis fermer la porte à double tour, ainsi
qu'une barre que j'y avais fait poser pour plus de sécurité
quand je laissais Eugénie seule, le soir, dans ma
mansarde.
Quand je fus au bas de l'escalier, je fus pris d'un vertige.
Je ne suis point jaloux de ma nature, et d'ailleurs,
jamais ma douce et sincère compagne ne m'avait donné
le moindre sujet de méfiance. J'avais pour elle plus que
de l'amour, j'avais une estime sans bornes pour son
caractère, une foi absolue en sa parole. Malgré tout cela,
je fus saisi d'une sorte de délire, et ne pus jamais me
résoudre à descendre le dernier étage. Je remontai vingt
fois jusqu'à ma porte; je redescendis autant de fois l'escalier.
Le plus profond silence régnait dans ma mansarde
et dans toute la maison. Plus je combattais ma folie, plus
elle s'emparait de mon cerveau. Une sueur froide coulait
de mon front. Je pensai plusieurs fois à enfoncer la
porte: malgré la serrure et la barre de fer, je crois que
j'en aurais eu la force dans ce moment-là; mais la
crainte d'épouvanter et d'offenser Eugénie par cette violence
et l'outrage d'un tel soupçon, m'empêchèrent de
céder à la tentation. Si Horace m'eût vu ainsi, il m'aurait
pris en pitié ou raillé amèrement. Après tout ce que
je lui avais dit pour combattre les instincts de jalousie et
de despotisme qu'il laissait percer dans ses théories de
l'amour, j'étais d'un ridicule achevé.
Je ne pus néanmoins prendre sur moi de sortir de la
maison. Je songeai bien à passer la nuit à me promener
sur le quai; mais la maison avait une porte de derrière
sur la rue Gît-le-Coeur, et pendant que j'en ferais le
tour, on pouvait sortir d'un côté ou de l'autre. Une fois
que j'aurais franchi la porte principale, soit que le portier
fut prévenu, soit qu'il allât se coucher, j'étais sur
de ne pas pouvoir rentrer passé minuit. Les portiers sont
fort inhumains envers les étudiants, et le mien était des
plus intraitables. Au diable l'hôtesse inconnue et sa réputation
compromise! pensai-je; et ne pouvant renoncer
à garder mon trésor à vue, ne pouvant plus résister à la
fatigue, je me couchai sur la natte de paille dans l'embrasure
de ma porte, et je finis par m'y endormir.
Heureusement nous demeurions au dernier étage de la
maison, et la seule chambre qui donnât sur notre palier
n'était pas louée. Je ne courais pas risque d'être surpris
dans cette ridicule situation par des voisins médisants.
Je ne dormis ni longtemps ni paisiblement, comme on
peut croire. Le froid du matin m'éveilla de bonne heure.
J'étais brisé, je fumai pour me ranimer, et quand, vers
six heures, j'entendis ouvrir la porte de la maison, je
sonnai à la mienne. Il me fallut encore attendre et encore
subir l'examen du guichet. Enfin il me fut permis
de rentrer.
«Ah! mon Dieu! dit Eugénie en frottant ses yeux
appesantis par un sommeil meilleur que le mien. Vous
me paraissez changé! Pauvre Théophile! vous avez donc
été bien mal couché chez votre ami Horace?
—On ne peut pas plus mal, répondis-je, un lit très dur.
Et votre hôte, est-il enfin parti?
—Mon hôte!» dit-elle avec un étonnement si candide
que je me sentis pénétré de honte.
Quand on est coupable, on a rarement l'esprit de se
repentir à temps. Je sentis le dépit me gagner, et n'ayant
rien à dire qui eût le sens commun, je posai ma canne
un peu brusquement sur la table, et je jetai mon chapeau
avec humeur sur une chaise: il roula par terre, je lui
donnai un grand coup de pied; j'avais besoin de briser
quelque chose.
Eugénie, qui ne m'avait jamais vu ainsi, resta stupéfaite:
elle ramassa mon chapeau en silence, me regarda
fixement, et devina enfin ma souffrance, en voyant
l'altération profonde de mes traits. Elle étouffa un soupir,
retint une larme, et entra doucement dans ma
chambre à coucher, dont elle referma la porte sur elle
avec soin. C'était là qu'était le personnage mystérieux.
Je n'osais plus, je ne voulais plus douter, et, malgré
moi, je doutais encore. Les pensées injustes, quand nous
leur laissons prendre le dessus, s'emparent tellement de
nous, qu'elles dominent encore notre imagination alors
que la raison et la conscience protestent contre elles.
J'étais au supplice; je marchais avec agitation dans mon
cabinet, m'arrêtant à chaque tour devant cette porte fatale,
avec un sentiment voisin de la rage. Les minutes
me semblaient des siècles.
Enfin la porte se rouvrit, et une femme vêtue à la
hâte, les cheveux encore dans le désordre du sommeil et
le corps enveloppé d'un grand châle, s'avança vers moi,
pâle et tremblante. Je reculai de surprise, c'était madame
Poisson.
VIII.
Elle s'inclina devant moi, presque jusqu'à mettre un
genou en terre; et dans cette attitude douloureuse, avec
sa pâleur, ses cheveux épars, et ses beaux bras nus sortant
de son châle écarlate, elle eût désarmé un tigre;
mais j'étais si heureux de voir Eugénie justifiée, que
j'eusse accueilli mon affreuse portière avec autant de
courtoisie que la belle Laure. Je la relevai, je la fis asseoir,
je lui demandai pardon d'être rentré si matin, n'osant
pas encore demander pardon, ni même jeter un regard
à ma pauvre maîtresse.
«Je suis bien malheureuse et bien coupable envers
vous, me dit Laure encore tout émue. J'ai failli amener
un chagrin dans votre intérieur. C'est ma faute, j'aurais
dû vous prévenir, j'aurais dû refuser la généreuse hospitalité
d'Eugénie. Ah! Monsieur, ne faites de reproche
qu'à moi: Eugénie est un ange. Elle vous aime comme
vous le méritez, comme je voudrais avoir été aimée, ne
fût-ce qu'un jour dans ma vie. Elle vous dira tout, Monsieur;
elle vous racontera mes malheurs et ma faute, ma
faute, qui n'est pas celle que vous croyez, mais qui est
plus grave mille fois, et dont je ferai pénitence toute
ma vie.»
Les larmes lui coupèrent la parole. Je pris ses deux
mains avec attendrissement. Je ne sais ce que je lui dis
pour la rassurer et la consoler; mais elle y parut sensible,
et, m'entraînant vers Eugénie, elle hâta avec une
grâce toute féminine l'explosion de mon remords et le
pardon de ma chère compagne. Je le reçus à genoux.
Pour toute réponse, celle-ci attira Laure dans mes bras,
et me dit: «Soyez son frère, et promettez-moi de la protéger
et de l'assister comme si elle était ma soeur et la
vôtre. Voyez que je ne suis pas jalouse, moi! Et pourtant
combien elle est plus belle, plus instruite, et plus faite
que moi pour vous tourner la tête!»
Le déjeuner, modeste comme à l'ordinaire, mais plein
de cordialité et même d'un enjouement attendri, fut
suivi des arrangements que prit Eugénie pour installer
Laure dans l'appartement qui donnait sur notre palier,
et que le portier n'avait pu mettre encore à sa disposition,
quoique à mon insu il fût retenu à cet effet depuis
plusieurs jours. Tandis que notre nouvelle voisine
s'établissait avec une certaine lenteur mélancolique dans
ce mystérieux asile, sous le nom de mademoiselle Moriat
(c'était le nom de famille d'Eugénie, qui la faisait
passer pour sa soeur), ma compagne revint me donner
les éclaircissements dont j'avais besoin pour la secourir.
«Vous avez de l'amitié pour le Masaccio? me dit-elle
pour commencer; vous vous intéressez à son sort?
et vous aimerez d'autant mieux Laure, qu'elle est plus
chère à Paul Arsène?
—Quoi! Eugénie, m'écriai-je, vous sauriez les secrets
du Masaccio? Ces secrets, impénétrables pour moi, il
vous les aurait confiés?»
Eugénie rougit et sourit. Elle savait tout depuis longtemps.
Tandis que le Masaccio faisait son portrait, elle
avait su lui inspirer une confiance extraordinaire. Lui,
si réservé, et même si mystérieux, il avait été dominé
par la bonté sérieuse et la discrète obligeance d'Eugénie.
Et puis l'homme du peuple, méfiant et fier avec moi,
avait ouvert fraternellement son coeur à la fille du peuple:
c'était légitime.
Eugénie avait promis le secret; elle l'avait religieusement
gardé. Elle me fit subir un interrogatoire très-judicieux
et très-fin, et quand elle se fut assurée que ma
curiosité n'était fondée que sur un intérêt sincère et dévoué
pour son protégé, elle m'apprit beaucoup de choses;
à savoir: primo, que madame Poisson n'était pas madame
Poisson, mais bien une jeune ouvrière née dans
la même ville de province et dans la même rue que le
petit Masaccio. Celui-ci avait eu pour elle, presque dès
l'enfance, une passion romanesque et tout à fait malheureuse;
car la belle Marthe, encore enfant elle-même, s'était
laissé séduire et enlever par M. Poisson, alors commis
voyageur, qui était venu avec elle dresser la tente
de son café à la grille du Luxembourg, comptant sans
doute sur la beauté d'une telle enseigne pour achalander
son établissement. Cette secrète pensée n'empêchait pas
M. Poisson d'être fort jaloux, et, à la moindre apparence,
il s'emportait contre Marthe, et la rendait fort
malheureuse. On assurait même dans le quartier qu'il
l'avait souvent frappée.
En second lieu, Eugénie m'apprit que Paul Arsène,
ayant un soir, contrairement à ses habitudes de sobriété,
cédé à la tentation de boire un verre de bière, était entré,
il y avait environ trois mois, au café Poisson; que
là, ayant reconnu dans cette belle dame vêtue de blanc
et coiffée de ses beaux cheveux noirs, en châtelaine du
moyen âge, la pauvre Marthe, ses premières, ses uniques
amours, il avait failli se trouver mal. Marthe lui avait fait
signe de ne pas lui parler, parce que le surveillant farouche
était là; mais elle avait trouvé moyen, en lui rendant
la monnaie de sa pièce de cinq francs, de lui glisser
un billet ainsi conçu:
«Mon pauvre Arsène, si tu ne méprises pas trop ta
payse, viens causer avec elle demain. C'est le jour de
garde de M. Poisson. J'ai besoin de parler de mon pays
et de mon bonheur passé.»
«Certes, continua Eugénie, Arsène fut exact au rendez-vous.
Il en sortit plus amoureux que jamais. Il avait
trouvé Marthe embellie par sa pâleur, et ennoblie par
son chagrin. Et puis, comme elle avait lu beaucoup de
romans à son comptoir, et même quelquefois des livres
plus sérieux, elle avait acquis un beau langage et toutes
sortes d'idées qu'elle n'avait pas auparavant. D'ailleurs,
elle lui confiait ses malheurs, son repentir, son désir de
quitter la position honteuse et misérable que son séducteur
lui avait faite, et Arsène se figurait que les devoirs
de la charité chrétienne et de l'amitié fraternelle l'enchaînaient
seuls désormais à sa compatriote. Il ne cessa
de rôder autour d'elle, sans toutefois éveiller les soupçons
du jaloux, et il parvint à causer avec Marthe toutes
les fois que M. Poisson s'absentait. Marthe était bien décidée
à quitter son tyran; mais ce n'était pas, disait-elle,
pour changer de honte qu'elle voulait s'affranchir.
Elle chargeait Arsène de lui trouver une condition où
elle pût vivre honnêtement de son travail, soit comme
femme de charge chez de riches particuliers, soit comme
demoiselle de comptoir dans un magasin de nouveautés,
etc.; mais toutes les conditions que Paul envisageait
pour elle lui semblaient indignes de celle qu'il aimait. Il
voulait lui trouver une position à la fois honorable, aisée
et libre: ce n'était pas facile. C'est alors qu'il a conçu et
exécuté le projet de quitter les arts et de reprendre une
industrie quelconque, fût-ce la domesticité. Il s'est dit
que sa tante allait bientôt mourir, qu'il ferait venir ses
soeurs à Paris, qu'il les établirait comme ouvrières en
chambre avec Marthe, et qu'il les soutiendrait toutes les
trois tant qu'elles ne seraient pas mises dans un bon train
d'affaires, sauf à ne jamais reprendre la peinture, si ses
avances et leur travail ne suffisaient pas pour les faire
vivre dans l'aisance. C'est ainsi que Paul a sacrifié la
passion de l'art à celle du dévouement, et son avenir à
son amour.
«Ne trouvant pas d'emploi plus lucratif pour le moment
que celui de garçon de café, il s'est fait garçon de café,
et il a justement choisi le café de M. Poisson, où il a pu
concerter l'enlèvement de Marthe, et où il compte rester
encore quelque temps pour détourner les soupçons. Car
la tante Henriette est morte, les soeurs d'Arsène sont en
route, et je m'étais chargée de veiller à leur établissement
dans une maison honnête: celle-ci est propre et
bien habitée. L'appartement à côté du nôtre se compose
de deux petites pièces; il coûte cent francs de loyer. Ces
demoiselles y seront fort bien. Nous leur prêterons le
linge et les meubles dont elles auront besoin en attendant
qu'elles aient pu se les procurer, et cela ne tardera
pas; car Paul, depuis deux mois qu'il gagne de l'argent,
a déjà su acheter une espèce de mobilier assez gentil qui
était là-haut dans votre grenier et à votre insu. Enfin,
avant-hier soir, tandis que vous étiez auprès de votre
malade, Laure, ou, pour mieux dire, Marthe, puisque
c'est son véritable nom, a pris son grand courage,
et au coup de minuit, pendant que M. Poisson
était de garde, elle est partie avec Arsène, qui devait l'amener
ici, et retourner bien vite à la maison avant que
son patron fût rentré; mais à peine avaient-ils fait trente
pas, qu'ils ont cru voir de la lumière à l'entre-sol de
M. Poisson, et ils ont délibéré s'ils ne rentreraient pas
bien vite. Alors Marthe, prenant son parti avec désespoir,
a forcé Arsène à rentrer et s'est mise à descendre
à toutes jambes la rue de Tournon, comptant sur la légèreté
de sa course et sur la protection du ciel pour
échapper seule aux dangers de la nuit. Elle a été suivie
par un homme sur les quais; mais il s'est trouvé par
bonheur que cet homme était votre camarade Laravinière,
qui lui a promis le secret et qui l'a amenée jusqu'ici.
Arsène est venu nous voir en courant ce matin. Le
pauvre garçon était censé faire une commission à l'autre
bout de Paris. Il était si baigné de sueur, si haletant, si
ému, que nous avons cru qu'il s'évanouirait en haut de
l'escalier. Enfin, en cinq minutes de conversation, il
nous a appris que leur frayeur au moment de la fuite
n'était qu'une fausse alerte, que M. Poisson n'était rentré
qu'au jour, et qu'au milieu de son trouble et de sa fureur,
il n'avait pas le moindre soupçon de la complicité
d'Arsène.
—Et maintenant, dis-je à Eugénie, qu'ont-ils à craindre
de M. Poisson? Aucune poursuite légale, puisqu'il n'est
pas marié avec Marthe?
—Non, mais quelque violence dans le premier feu de
la colère. Comme c'est un homme grossier, livré à toutes
ses passions, incapable d'un véritable attachement, il se
sera bientôt consolé avec une nouvelle maîtresse. Marthe,
qui le connaît bien, dit que si l'on peut tenir sa demeure
secrète pendant un mois tout au plus, il n'y aura plus
rien à craindre ensuite.
—Si je comprends bien le rôle que vous m'avez réservé
dans tout ceci, repris-je, c'est: primo, de vous
laisser disposer de tout ce qui est à nous pour assister
nos infortunées voisines; secundo, d'avoir toujours
derrière la porte une grosse canne au service des épaules
de M. Poisson, en cas d'attaque. Eh bien, voici, primo,
un terme de ma rente que j'ai touché hier, et dont tu
feras, comme de coutume, l'emploi que tu jugeras convenable;
secundo, voilà un assez bon rotin que je vais
placer en sentinelle.»
Cela fait, j'allai me jeter sur mon lit, où je tombai, à
la lettre, endormi avant d'avoir pu achever de me déshabiller.
Je fus réveillé au bout de deux heures par Horace:—Que
diable se passe-t-il chez toi? me dit-il. Avant d'ouvrir,
on parlemente au guichet, on chuchote derrière la
porte, on cache quelqu'un dans la cuisine, ou dans le
bûcher, ou dans l'armoire, je ne sais où; et, quand je
passe, on me rit au nez. Qui est-ce qu'on mystifie? Est-ce
toi ou moi?
A mon tour, je me mis à rire. Je fis ma toilette, et
j'allai prendre ma place au conseil délibératif que Marthe
et Eugénie tenaient ensemble dans la cuisine. Je fus
d'avis qu'il fallait se fier à Horace, ainsi qu'au petit
nombre d'amis que j'avais l'habitude de recevoir. En remettant
le secret de Marthe à leur honneur et à leur
prudence, on avait beaucoup plus de chances de sécurité
qu'en essayant de le leur cacher. Il était impossible qu'ils
ne le découvrissent pas, quand même Marthe s'astreindrait
à ne jamais passer de sa chambre dans la nôtre, et
quand même je consignerais tous mes amis chez le portier.
La consigne serait toujours violée; et il ne fallait
qu'une porte entr'ouverte, une minute durant, pour que
quelqu'un de nos jeunes gens entrevit et reconnut la belle
Laure. Je commençai donc le chapitre des confidences
solennelles par Horace, tout en lui cachant, ainsi que je
le fis, à l'égard des autres, l'intérêt qu'Arsène portait à
Laure, la part qu'il avait prise à son évasion, et jusqu'à
leur ancienne connaissance. Laure, désormais redevenue
Marthe, fut, pour Horace et pour tous nos amis, une
amie d'enfance d'Eugénie, qui se garda bien de dire
qu'elle ne la connaissait que depuis deux jours. Elle
seule fut censée lui avoir offert une retraite et la couvrir
de sa protection. Son chaperonnage était assez respectable;
tous mes amis professaient à bon droit pour Eugénie
une haute estime, et je ne me vantai jamais, comme
on peut le croire, de mon ridicule accès de jalousie.
Cependant Eugénie ne me le pardonna pas aussi aisément
que je m'en étais flatté. Je puis même dire qu'elle
ne me l'a jamais pardonné. Quoiqu'elle fit, j'en suis convaincu,
tous ses efforts pour l'oublier, elle y a toujours
pensé avec amertume. Combien de fois ne me l'a-t-elle
pas fait sentir, en niant énergiquement que l'amour d'un
homme fût à la hauteur de celui d'une femme!—Le
meilleur, le plus dévoué, le plus fidèle de tous, sera toujours
prêt, disait-elle, à se méfier de celle qui s'est donnée
à lui. Il l'outragera, sinon par des actes, du moins par la
pensée. L'homme a pris sur nous dans la société un droit
tout matériel; aussi toute notre fidélité, souvent tout
notre amour, se résument pour lui dans un fait. Quant à
nous, qui n'exerçons qu'une domination morale, nous
nous en rapportons plus à des preuves morales qu'à des
apparences. Dans nos jalousies, nous sommes capables
de récuser le témoignage de nos yeux; et quand vous
faites un serment, nous nous en rapportons à votre parole
comme si elle était infaillible. Mais la nôtre est-elle
donc moins sacrée? Pourquoi avez-vous fait de votre honneur
et du nôtre deux choses si différentes? Vous frémiriez
de colère si un homme vous disait que vous mentez.
Et pourtant vous vous nourrissez de méfiance, et vous
nous entourez de précautions qui prouvent que vous
doutez de nous. A celui que des années de chasteté et de
sincérité devraient rassurer à jamais, il suffit d'une petite
circonstance inusitée, d'une parole obscure, d'un
geste, d'une porte ouverte ou fermée, pour que toute
confiance soit détruite en un instant.
Elle adressait tous ces beaux sermons à Horace, qui
avait l'habitude de se poser pour l'avenir en Othello;
mais, en effet, c'était sur mon coeur que retombaient ces
coups acérés. «Où diable prend-elle tout ce qu'elle dit?
observait Horace. Mon cher, tu la laisses trop aller au
prêche de la salle Taitbout.»
IX.
La situation de Paul Arsène à l'égard de Marthe était
des plus étranges. Soit qu'il n'eût jamais osé lui exprimer
son amour, soit qu'elle n'eût pas voulu le comprendre,
ils en étaient restés, comme au premier jour, dans
les termes d'une amitié fraternelle. Marthe ignorait le
dévouement de ce jeune homme; elle ne savait pas à
quelles espérances il avait dû renoncer pour s'attacher
à son sort. Il ne lui avait pas caché qu'il eût étudié la
peinture; mais il ne lui avait pas dit de quelles admirables
facultés la nature l'avait doué à cet égard; et
d'ailleurs il attribuait son renoncement à la nécessité de
faire venir ses soeurs et de les soutenir. Marthe ne possédait
rien, et n'avait rien voulu emporter de chez
M. Poisson. Elle comptait travailler, et les avances qu'elle
acceptait, elle ne les attribuait qu'à Eugénie. Elle n'eût
pas fui, appuyée sur le bras d'Arsène, si elle eût cru lui
devoir d'autres services que de simples démarches auprès
d'Eugénie, et un asile auprès de ses soeurs, qu'elle
comptait bien indemniser en payant sa part des dépenses.
En se dévouant ainsi, Paul avait brûlé ses vaisseaux, et
il s'était ôté le droit de lui jamais dire: «Voilà ce que
j'ai fait pour vous;» car, dans l'apparence, il n'avait fait
pour elle que ce qui est permis à la plus simple amitié.
Le pauvre enfant était si accablé d'ouvrage, et tenu
de si près par son patron, qu'il ne put aller recevoir ses
soeurs à la diligence. Marthe ne sortait pas, dans la crainte
d'être rencontrée par quelqu'un qui pût mettre M. Poisson
sur ses traces. Nous nous chargeâmes, Eugénie et
moi, d'aller aider au débarquement de Louison et de
Suzanne, nos futures voisines. Louison, l'aînée, était une
beauté de village, un peu virago, ayant la voix haute,
l'humeur chatouilleuse et l'habitude du commandement.
Elle avait contracté cette habitude chez sa vieille tante
infirme, qui l'écoutait comme un oracle, et lui laissait la
gouverne de cinq ou six apprenties couturières, parmi
lesquelles la jeune soeur Suzon n'était qu'une puissance
secondaire, une sorte de ministre dirigeant les travaux,
mais obéissant à la soeur aînée, sans appel. Aussi Louison
avait-elle des airs de reine, et l'insatiable besoin de
régner qui dévore les souverains.
Suzanne, sans être belle, était agréable et d'une organisation
plus distinguée que celle de Louise. Il était facile
de voir qu'elle était capable de comprendre tout ce que
Louise ne comprendrait jamais. Mais Louise était, au-dessus
et autour d'elle, comme une cloche de plomb, pour
l'empêcher de se répandre au dehors et d'en recevoir
quelque influence.
Elles accueillirent nos avances, l'une avec surprise et
timidité, l'autre avec une raideur un peu brutale. Elles
n'avaient aucune idée de la vie de Paris, et ne concevaient
pas qu'il pût y avoir pour Arsène un empêchement
impérieux de venir à leur rencontre. Elles remercièrent
Eugénie d'un air préoccupé, Louise répétant à tout propos:
«C'est toujours bien désagréable que Paul ne soit pas là!
Et Suzanne ajoutant, d'un ton de consternation:
—C'est-il drôle que Paul ne soit pas venu!»
Il faut avouer que, venant pour la première fois de
leur vie de faire un assez long voyage en diligence, se
voyant aux prises avec les douaniers pour l'examen de
leurs malles, ne sachant tout ce que signifiait ce bruit de
voyageurs partants et arrivants, de chevaux qu'on attelait
et dételait, d'employés, de facteurs et de commissionnaires,
il était assez naturel qu'elles perdissent la
tête et ressentissent un peu de fatigue, d'humeur et
d'effroi. Elles s'humanisèrent en voyant que je venais à
leur secours, que je veillais à leurs paquets, et que je
réglais leurs comptes avec le bureau. A peine se virent-elles
installées dans un fiacre avec leurs effets, leurs innombrables
corbeilles et cartons (car elles avaient, suivant
l'habitude des campagnards, traîné une foule d'objets
dont le port surpassait la valeur), que Louison fourra la
main jusqu'au coude dans son cabas, en criant: «Attendez,
Monsieur; attendez que je vous paie! Qu'est-ce
que vous avez donné pour nous à la diligence? Attendez
donc!»
Elle ne concevait pas que je ne me fisse pas rembourser
immédiatement l'argent que je venais de tirer de ma
poche pour elles; et ce trait de grandeur, que j'étais loin
d'apprécier moi-même, commença à me gagner leur considération.
Nous montâmes dans un cabriolet de place, Eugénie
et moi, afin de nous trouver en même temps qu'elles à la
porte de notre domicile commun.
«Ah! mon Dieu! quelle grande maison! s'écrièrent-elles
en la toisant de l'oeil; elle est si haute, qu'on n'en
voit pas le faîte.»
Elle leur sembla bien plus haute lorsqu'il fallut monter
les quatre-vingt-douze marches qui nous séparaient
du sol. Dès le second étage, elles montrèrent de la surprise;
au troisième, elles firent de grands éclats de rire;
au quatrième, elles étaient furieuses; au cinquième,
elles déclarèrent qu'elles ne pourraient jamais demeurer
dans une pareille lanterne. Louise, découragée, s'assit
sur la dernière marche en disant:—«En voilà-t-il une
horreur de pays!»
Suzanne, qui conservait plus d'envie de se moquer
que de s'emporter, ajouta: «Ça sera commode, hein?
de descendre et de remonter ça quinze fois par jour! Il
y a de quoi se casser le cou.»
Eugénie les introduisit tout de suite dans leur appartement.
Elles le trouvèrent petit et bas. Une pièce donnait
sur le prolongement de mon balcon. Louise s'y
avança, et se rejetant aussitôt en arrière, se laissa tomber
sur une chaise.
«Ah! mon Dieu! s'écria-t-elle, ça me donne le vertige;
il me semble que je suis sur la pointe de notre
clocher.»
Nous voulûmes les faire souper. Eugénie avait préparé
un petit repas dans mon appartement, comptant, à ce
moment-là, leur présenter Marthe.
«Vous avez bien de la bonté, monsieur et madame,
dit Louison en jetant un coup d'oeil prohibitif à Suzanne;
mais nous n'avons pas faim.»
Elle avait l'air désespéré; Suzanne s'était hâtée de défaire
les malles et de ranger les effets, comme si c'était
la chose la plus pressée du monde.
«Ah ça! pourquoi donc trois lits? fit observer tout
à coup Louise. Paul va donc demeurer avec nous? A la
bonne heure!
—Non, Paul ne peut pas encore demeurer avec vous,
lui répondis-je. Mais vous aurez une payse, une ancienne
amie, qu'il voulait vous présenter lui-même...
—Tiens! qui donc ça? Nous n'avons pas grand'payse
ici, que je sache. Comment donc qu'il ne nous en a rien
marqué dans ses lettres?...
—Il avait à vous dire là-dessus beaucoup de choses
qu'il vous expliquera lui-même. En attendant, il m'a
chargé de vous la présenter. Elle demeure déjà ici, et,
pour le moment, elle apprête votre souper. Voulez-vous
que je vous l'amène?
—Nous irons bien la voir nous-mêmes, répondit Louison,
dont la curiosité était fortement éveillée; où donc
est-ce qu'elle est, cette payse?»
Elle me suivit avec empressement.
«Tiens! c'est la Marton, cria-t-elle d'une voix âpre
en reconnaissant la belle Marthe. Comment vous en va,
Marton? Vous êtes donc veuve, que vous allez demeurer
avec nous? Vous avez fait une vilaine chose, pas moins,
de vous ensauver avec ce monsieur qui vous a soulevée
à votre père. Mais enfin on dit que vous vous êtes mariée
avec lui, et à tout péché miséricorde!»
Marthe rougit, pâlit, et perdit contenance. Elle ne s'était
pas attendue à un pareil accueil. La pauvre femme
avait oublié ses anciennes compagnes, comme Arsène
avait oublié ses soeurs. Le mal du pays fait cet effet-là
à tout le monde: il transforme les objets de nos souvenirs
en idéalités poétiques, dont les qualités grandissent
à nos yeux, tandis que les défauts s'adoucissent toujours
avec le temps et l'absence, et vont jusqu'à s'effacer dans
notre imagination.
Et puis, lorsque Marthe avait quitté le pays cinq ans
auparavant, Louise et Suzanne n'étaient que des enfants
sans réflexion sur quoi que ce soit. Maintenant c'étaient
deux dragons de vertu, principalement l'aînée, qui avait
tout l'orgueil d'une beauté célèbre à deux lieues à la
ronde et toute l'intolérance d'une sagesse incontestée.
En quittant le terroir où elles brillaient de tout leur éclat,
ces deux plantes sauvages devaient nécessairement (Arsène
ne l'avait pas prévu) perdre beaucoup de leur
charme et de leur valeur. Au village elles donnaient le
bon exemple, rattachaient à des habitudes de labeur et
de sagesse les jeunes filles de leur entourage. A Paris,
leur mérite devait être enfoui, leurs préceptes inutiles,
leur exemple inaperçu; et les qualités nécessaires à leur
nouvelle position, la bonté, la raison, la charité fraternelle,
elles ne les avaient pas, elles ne pouvaient pas les
avoir.
Il était bien tard pour faire ces réflexions. Le premier
mouvement de Marthe avait été de s'élancer dans les bras
de la soeur d'Arsène, le second fut d'attendre ses premières
démonstrations, le troisième fut de se renfermer
dans un juste sentiment de réserve et de fierté; mais
une douleur profonde se trahissait sur son visage pâli,
et de grosses larmes roulaient dans ses yeux.
Je lui pris la main, et, la lui serrant affectueusement,
je la fis asseoir à table; puis je forçai Louise de s'asseoir
auprès d'elle.
—Vous n'avez le droit de lui faire ni questions ni reproches,
dis-je à cette dernière d'un ton ferme qui l'étonna
et la domina tout d'un coup; elle a l'estime de
votre frère et la nôtre. Elle a été malheureuse, le malheur
commande le respect aux âmes honnêtes. Quand
vous aurez refait connaissance avec elle, vous l'aimerez,
et vous ne lui parlerez jamais du passé.
Louison baissa les yeux, interdite et non pas convaincue.
Suzanne, qui l'avait suivie par derrière, cédant à
l'impulsion de son coeur, se pencha vers Marthe pour
l'embrasser; mais un regard terrible de Louise, jeté en
dessous, paralysa son élan. Elle se borna à lui serrer la
main; et Eugénie, craignant que Marthe ne fût mal à
l'aise entre ses deux compatriotes, se plaça auprès d'elle,
affectant de lui témoigner plus d'amitié et d'égards
qu'aux autres. Ce repas fut triste et gêné. Soit par dépit,
soit que les mets ne fussent pas de son goût, Louison ne
touchait à rien. Enfin, Arsène arriva, et, après les premiers
embrassements, devinant, avec le sang-froid qu'il
possédait au plus haut degré, ce qui se passait entre nous
tous, il emmena ses deux soeurs dans une chambre, et
resta plus d'une heure enfermé avec elles.
Au sortir de cette conférence, ils avaient tous le teint
animé. Mais l'influence de l'autorité fraternelle, si peu
contestée dans les moeurs du peuple de province, avait
maté la résistance de Louise. Suzanne, qui ne manquait
pas de finesse, voyant dans Arsène un utile contre-poids
à l'autorité de sa soeur, n'était pas fâchée, je crois, de
changer un peu de maître. Elle fit franchement des amitiés
à Marthe, tandis que Louise l'accablait de politesses
affectées très-maladroites et presque blessantes.
Arsène les envoya coucher presque aussitôt.
«Nous attendrons madame Poisson, dit Louise sans
se douter qu'elle enfonçait un nouveau poignard dans le
coeur de Marthe en l'appelant ainsi.
—Marthe n'a pas voyagé, répondit le Masaccio froidement;
elle n'est pas condamnée à dormir avant d'en
voir envie. Vous autres, qui êtes fatiguées, il faut aller
vous reposer.»
Elles obéirent, et, quand elles furent sorties:
«Je vous supplie de pardonner à mes soeurs, dit-il à
Marthe, certains préjugés de province qu'elles auront
bientôt perdus, je vous en réponds.
—N'appelez point cela des préjugés, répondit Marthe.
Elles ont raison de me mépriser: j'ai commis une faute
honteuse. Je me suis livrée à un homme que je devais
bientôt haïr, et qui n'était pas fait pour être aimé. Vos
soeurs ne sont scandalisées que parce que mon choix
était indigne. Si je m'étais fait enlever par un homme
comme vous, Arsène, je trouverais de l'indulgence, et
peut-être de l'estime dans tous les coeurs. Vous voyez
bien que tous ceux qui approchent d'Eugénie la respectent.
On la considère comme la femme de votre ami,
quoiqu'elle ne se soit jamais fait passer pour telle; et
moi, quoique je prisse le titre d'épouse, tout le monde
sentait que je ne l'étais point. En voyant quel maître farouche
je m'étais donné, personne n'a cru que l'amour
pût m'avoir jetée dans l'abîme.»
En parlant ainsi, elle pleurait amèrement, et sa douleur,
trop longtemps contenue, brisait sa poitrine.
Arsène étouffa des sanglots prêts à lui échapper.
«Personne n'a jamais dit ni pensé de mal de vous,
s'écria-t-il; quant à moi, je saurai bien faire partager à
mes soeurs le respect que j'ai pour vous.
—Du respect! Est-il possible que vous me respectiez,
vous! Vous ne croyez donc pas que je me sois vendu?
—Non! non! s'écria Paul avec force, je crois que vous
avez aimé cet homme haïssable; et où est donc le crime?
Vous ne l'avez pas connu, vous avez cru à son amour;
vous avez été trompée comme tant d'autres. Ah! Monsieur,
ajouta-t-il en s'adressant à moi, vous ne pensez
pas non plus que Marthe ait jamais pu se vendre, n'est-ce
pas?»
J'étais un peu gêné dans ma réponse. Depuis quelques
jours que nous connaissions la situation de Marthe à l'égard
de M. Poisson, nous nous étions déjà demandé plusieurs
fois, Horace et moi, comment une créature si belle
et si intelligente avait pu s'éprendre du Minotaure.
Parfois nous nous étions dit que cet homme, si lourd et
si grossier, avait pu avoir, quelques années auparavant,
de la jeunesse et une certaine beauté; que ce profil de
Vitellius, maintenant odieux, pouvait avoir eu du caractère
avant l'invasion subite et désordonnée de l'embonpoint.
Mais parfois aussi nous nous étions arrêtés à l'idée
que des bijoux et des promesses, l'appât des parures et
l'espoir d'une vie nonchalante avaient enivré cette enfant
avant que l'intelligence et le coeur fussent développés en
elle. Enfin nous pensions que son histoire pourrait bien
ressembler à celle de toutes les filles séduites que les
besoins de la vanité et les suggestions de la paresse précipitent
dans le mal.
Malgré mon empressement à la rassurer, Marthe vit
ce qui se passait en moi. Elle avait besoin de se justifier.
«Écoutez, dit-elle, je suis bien coupable, mais pas
autant que je le parais. Mon père était un ouvrier pauvre
et chagrin, qui cherchait dans le vin, comme tant d'autres,
l'oubli de ses maux et de ses inquiétudes. Vous ne
savez pas ce que c'est que le peuple, Monsieur! non,
vous ne le savez pas! C'est dans le peuple qu'il y a les
plus grandes vertus et les plus grands vices. Il y a là des
hommes comme lui (et elle posait sa main sur le bras
d'Arsène), et il y a aussi des hommes dont la vie semble
livrée à l'esprit du mal. Une fureur sombre les dévore,
un désespoir profond de leur condition alimente en eux
une rage continuelle. Mon père était de ceux-là. Il se
plaignait sans cesse, avec des jurements et des imprécations,
de l'inégalité des fortunes et de l'injustice du sort,
Il n'était pas né paresseux; mais il l'était devenu par découragement,
et la misère régnait chez nous. Mon enfance
s'est écoulée entre deux souffrances alternatives:
tantôt une compassion douloureuse pour mes parents
infortunés, tantôt une terreur profonde devant les emportements
et les délires de mon père. Le grabat où nous
reposions était à peu près notre seule propriété: tous les
jours d'avides créanciers nous le disputaient. Ma mère
mourut jeune par suite des mauvais traitements de son
mari. J'étais alors enfant. Je sentis vivement sa perte,
quoique j'eusse été la victime sur laquelle elle reportait
les outrages et les coups dont elle était abreuvée. Mais il
ne me vint pas dans l'idée d'insulter à sa mémoire et de
me réjouir de l'espèce de liberté que sa mort me procurait.
Je mettais toutes ses injustices sur le compte de la
misère, aussi bien les siennes que celles de mon père.
La misère était l'unique ennemi, mais l'ennemi commun,
terrible, odieux, que, dès les premiers jours de ma vie,
je fus habituée à détester et à craindre.
«Ma mère, en dépit de tout, était laborieuse et me forçait
à l'être. Quand je fus seule et abandonnée à tous mes
penchants, je cédai à celui qui domine l'enfance: je
tombai dans la paresse. Je voyais à peine mon père; il
partait le matin avant que je fusse éveillée, et ne rentrait
que tard le soir lorsque j'étais couchée. Il travaillait vite
et bien; mais à peine avait-il touché quelque argent,
qu'il allait le boire; et lorsqu'il revenait ivre au milieu
de la nuit, ébranlant le pavé sous son pas inégal et pesant,
vociférant des paroles obscènes sur un ton qui ressemblait
à un rugissement plutôt qu'à un chant, je m'éveillais
baignée d'une sueur froide et les cheveux dressés
d'épouvante. Je me cachais au fond de mon lit, et des
heures entières s'écoulaient ainsi, moi n'osant respirer,
lui marchant avec agitation et parlant tout seul dans le
délire; quelquefois s'armant d'une chaise ou d'un bâton,
et frappant sur les murs et même sur mon lit, parce qu'il
se croyait poursuivi et attaqué par des ennemis imaginaires.
Je me gardais bien de lui parler; car une fois, du
vivant de ma mère, il avait voulu me tuer, pour me préserver,
disait-il, du malheur d'être pauvre. Depuis ce
temps, je me cachais à son approche; et souvent, pour
éviter d'être atteinte par les coups qu'il frappait au hasard
dans l'obscurité, je me glissais sous mon lit, et j'y
restais jusqu'au jour, à moitié nue, transie de peur et de
froid.
«Dans ce temps-là, je courais souvent dans les prairies
qui entourent notre petite ville avec les enfants de mon
âge; nous y avons souvent joué ensemble, Arsène; et
vous savez bien que cette enfant, qui traînait toujours un
reste de soulier attaché par une ficelle, en guise de cothurne,
autour de la jambe, et qui avait tant de peine à
faire rentrer ses cheveux indisciplinés sous un lambeau
de bonnet, vous savez bien que cette enfant-là, craintive
et mélancolique jusque dans ses jeux, était aussi pure
et aussi peu vaine que vos soeurs. Mon seul crime, si
c'en est un quand on a une existence si malheureuse,
était de désirer, non la richesse, mais le calme et la douceur
de moeurs que procure l'aisance. Quand j'entrais
chez quelque bourgeois, et que je voyais la tranquillité
polie de sa famille, la propreté de ses enfants, l'élégante
simplicité de sa femme, tout mon idéal était de pouvoir
m'asseoir pour lire ou pour tricoter sur une chaise propre
dans un intérieur silencieux et paisible; et quand je
m'élevais jusqu'au rêve d'un tablier de taffetas noir, je
croyais avoir poussé l'ambition jusqu'à ses dernières limites.
J'appris, comme toutes les filles d'artisan, le travail
de l'aiguille; mais j'y fus toujours lente et maladroite.
La souffrance avait étiolé mes facultés actives;
je ne vivais que de rêverie, heureuse quand je n'étais
pas rudoyée, terrifiée et presque abrutie quand je l'étais.
«Mais comment vous raconterai-je la principale et la
plus affreuse cause de ma faute? Le dois-je, Arsène, et
ne ferai-je pas mieux d'encourir un peu plus de blâme,
que de charger d'une si odieuse malédiction la tête de
mon père?
—Il faut tout dire, répondit Arsène, ou plutôt je vais
le dire pour vous; car vous ne pouvez pas vous laisser
accuser d'un crime quand vous êtes innocente. Moi, je sais
tout, et je viens de le dire à mes soeurs, qui l'ignoraient
encore. Son père, dit-il en s'adressant à nous (pardonnez-lui,
mes amis; la misère est la cause de l'ivrognerie, et
l'ivrognerie est la cause de tous nos vices), ce malheureux
homme, avili, dégradé, privé de raison à coup sûr,
conçut pour sa fille une passion infâme, et cette passion
éclata précisément un jour où Marthe, ayant été remarquée
à la danse sans le savoir, par un commis voyageur,
avait excité le jalousie insensée de son père. Ce voyageur
avait été très-empressé auprès d'elle; il n'avait pas manqué,
comme ils font tous à l'égard des jeunes filles qu'ils
rencontrent dans les provinces, de lui parler d'amour et
d'enlèvement. Marthe l'avait à peine écouté. Dès la nuit
suivante il devait repartir, et la nuit suivante, au moment
où il repartait, il vit une femme échevelée courir sur ses
traces et s'élancer dans sa voiture. C'était Marthe qui
fuyait, nouvelle Béatrix, les violences sinistres d'un nouveau
Cenci. Elle aurait pu, direz-vous, prendre un autre
parti, chercher un refuge ailleurs, invoquer la protection
des lois; mais dans ce cas-là, il fallait déshonorer
son père, affronter la honte d'un de ces procès scandaleux
d'où l'innocent sort parfois aussi souillé dans l'opinion
que le coupable. Marthe crut avoir trouvé un ami,
un protecteur, un époux même; car le voyageur, voyant
sa simplicité d'enfant, lui avait parlé de mariage. Elle
crut pouvoir l'aimer par reconnaissance, et, même après
qu'il l'eut trompée, elle crut lui devoir encore une sorte
de gratitude.
—Et puis, reprit Marthe, mes premiers pas dans la
vie avaient été marqués de scènes si terribles et de dangers
si affreux, que je n'avais plus le droit d'être si difficile.
J'avais changé de tyran. Mais le second, avec ses
jalousies et ses emportements, avait une sorte d'éducation
qui me le faisait paraître bien moins rude que le premier.
Tout est relatif. Cet homme, que vous trouvez si grossier,
et que moi-même j'ai trouvé tel à mesure que j'ai eu des
objets de comparaison autour de moi, me paraissait bon,
sincère, dans les commencements. La douceur exceptionnelle
que j'avais acquise dans une vie si contrainte et
si dure, encouragea et poussa rapidement à l'excès les
instincts despotiques de mon nouveau maître. Je les supportai
avec une résignation que n'auraient pas eue des
femmes mieux élevées. J'étais en quelque sorte blasée
sur les menaces et les injures. Je rêvais toujours l'indépendance,
mais je ne la croyais plus possible pour moi.
J'étais une âme brisée; je ne sentais plus en moi l'énergie
nécessaire à un effort quelconque, et sans l'amitié,
les conseils et l'aide d'Arsène, je ne l'aurais jamais eue.
Tout ce qui ressemblait à des offres d'amour, les simples
hommages de la galanterie, ne me causaient qu'effroi et
tristesse. Il me fallait plus qu'un amant, il me fallait un
ami: je l'ai trouvé, et maintenant je m'étonne d'avoir si
longtemps souffert sans espoir.
—Et maintenant vous serez heureuse, lui dis-je; car
vous ne trouverez autour de vous que tendresse, dévouement
et déférence.
—Oh! de votre part et de celle d'Eugénie, s'écria-t-elle
en se jetant au cou de ma compagne, j'y compte; et
quant à l'amitié de celui-ci, ajouta-t-elle en prenant la
tête d'Arsène entre ses deux mains, elle me fera tout
supporter.»
Arsène rougit et pâlit tour à tour.
«Mes soeurs vous respecteront, s'écria-t-il d'une voix
émue, ou bien...
—Point de menaces, répondit-elle, oh! jamais de menaces
à cause de moi. Je les désarmerai, n'en doutez
pas; et si j'échoue, je subirai leur petite morgue. C'est si
peu de chose pour moi! cela me paraît un jeu d'enfant.
Sois sans inquiétude, cher Arsène. Tu as voulu me sauver,
tu m'as sauvée en effet, et je te bénirai tous les jours
de ma vie.»
Transporté d'amour et de joie, Arsène retourna au
café Poisson, et Marthe alla doucement prendre possession
de son petit lit auprès des deux soeurs, dont les vigoureux
ronflements couvrirent le bruit léger de ses pas.
X.
Les soeurs d'Arsène se radoucirent en effet. Après
quelques jours de fatigue, d'étonnement et d'incertitude,
elles parurent prendre leur parti et s'associer, sans arrière-pensée,
à la compagne qui leur était imposée. Il est
vrai que Marthe leur témoigna une obligeance qui allait
presque jusqu'à la soumission. Les bonnes manières
qu'elle avait su prendre, jointes à sa douceur naturelle
et à une sensibilité toujours éveillée et jamais trop expansive,
rendaient son commerce le plus aimable que j'aie,
jamais rencontré dans une femme. Il n'avait fallu que
deux ou trois jours pour inspirer à Eugénie et à moi une
amitié véritable pour elle. Sa politesse imposait à l'altière
Louison; et lorsque celle-ci éprouvait le besoin de lui
chercher noise, sa voix douce, ses paroles choisies, ses
intentions prévenantes calmaient ou tout au moins mataient
l'humeur querelleuse de la villageoise.
De notre côté, nous faisions notre possible pour réconcilier
Louise et Suzanne avec ce Paris dont le premier
aspect les avait tant irritées. Elles s'étaient imaginé, au
fond de leur village, que Paris était un Eldorado où, relativement,
la misère était ce que l'on considère comme
richesse en province. Jusqu'à un certain point leur rêve
était bien réalisé, car lorsqu'elles allaient en fiacre (je
leur donnai deux ou trois fois ce plaisir luxueux), elles
se regardaient l'une l'autre d'un air ébahi, en disant:
«Nous ne nous gênons pas ici! nous roulons carrosse.»
Et puis, la vue des moindres boutiques leur causait des
éblouissements d'admiration. Le Luxembourg leur paraissait
un lieu enchanté. Mais si la vue des objets nouveaux
vint à bout de les distraire pendant quelques jours,
elles n'en firent pas moins de tristes retours sur leur
condition nouvelle, lorsqu'elles se retrouvèrent dans cette
petite chambre au cinquième où leur vie devait se renfermer.
Quelle différence, en effet, avec leur existence
provinciale! Plus d'air, plus de liberté, plus de causerie
sur la porte avec les voisines; plus d'intimité avec tous
les habitants de la rue; plus de promenade sur un petit
rempart planté de marronniers, avec toutes les jeunes
filles de l'endroit, après les journées de travail; plus de
danses champêtres le dimanche! Aussitôt qu'elles furent
installées au travail, elles virent bien qu'à Paris les jours
étaient trop courts pour la quantité des occupations nécessaires,
et que, si l'on gagnait le double de ce qu'on
gagne en province, il fallait aussi dépenser le double et
travailler le triple. Chacune de ces découvertes était pour
elles une surprise fâcheuse. Elles ne concevaient pas non
plus que la vertu des filles fût exposée à tant de dangers,
et qu'il ne fallût pas sortir seules le soir, ni aller danser
au bal public quand on voulait se respecter. «Ah! mon
Dieu! s'écriait Suzanne consternée, le monde est donc
bien méchant ici?»
Mais cependant elles se soumirent, non sans murmure
intérieur. Arsène les tenait en respect par de fréquentes
exhortations, et elles ne manifestaient plus leur mécontentement
avec la sauvagerie du premier jour. Ce voisinage
de deux filles mal satisfaites et passablement malapprises
eût été assez désagréable, si le travail, remède
souverain à tous les maux quand il est proportionné à
nos forces, ne fût venu tout pacifier. Grâce aux petites
précautions qu'Eugénie avait prises d'avance, l'ouvrage
arrivait; et elle songeait sérieusement, voyant l'estime
et la confiance que lui témoignaient ses pratiques, à
monter un atelier de couturière. Marthe n'était pas fort
diligente, mais elle avait beaucoup de goût et d'invention.
Louison cousait rapidement et avec une solidité cyclopéenne.
Suzanne n'était pas maladroite. Eugénie ferait
les affaires, essaierait les robes, dirigerait les travaux,
et partagerait loyalement avec ses associées. Chacune,
étant intéressée au succès du phalanstère, travaillerait,
non à la tâche et sans conscience, comme font les ouvrières
à la journée, mais avec tout le zèle et l'attention
dont elle était susceptible. Cette grande idée souriait
assez aux soeurs d'Arsène; restait à savoir si le caractère
de Louison s'assouplirait assez pour rendre l'association
praticable. Habituée à commander, elle était bouleversée
de voir que cette fainéante de Marthe (comme elle l'appelait
tout bas dans l'oreille de sa soeur) avait plus de
génie qu'elle pour imaginer un ornement de manche, ou
agencer les parties délicates d'un corsage. Lorsque, fidèle
à ses traditions antédiluviennes, elle taillait à sa guise,
et qu'Eugénie venait bouleverser ses plans et détruire
toutes ses notions, la virago avait bien de la peine à ne
pas lui jeter sa chaise à la tête. Mais une douce parole
de Marthe et un malin sourire de Suzon faisaient rentrer
toute cette colère, et elle se contentait de mugir sourdement,
comme la mer après une tempête.
Pendant qu'on faisait dans nos mansardes cet essai
important d'une vie nouvelle, Horace, retranché dans la
sienne, se livrait à des essais littéraires. Dès que je fus
un peu rendu à la liberté, j'allai le voir; car depuis plusieurs
jours j'étais privé de sa société. Je trouvai son
intérieur singulièrement changé. Il avait arrangé sa petite
chambre garnie avec une sorte d'affectation. Il avait
mis son couvre-pied sur sa table, afin de lui donner un
air de bureau. Il avait placé un de ses matelas dans l'embrasure
de la porte, afin d'intercepter les bruits du voisinage;
et de son rideau d'indienne, roulé autour de lui,
il s'était fait une robe de chambre, ou plutôt un manteau
de théâtre. Il était assis devant sa table, les coudes
en avant, la tête dans ses mains, la chevelure ébouriffée;
et quand j'ouvris la porte, vingt feuillets manuscrits,
soulevés par le courant d'air, voltigèrent autour de lui,
et s'abattirent de tous côtés, comme une volée d'oiseaux
effarouchés.
Je courus après eux, et en les rassemblant j'y jetai un
regard indiscret. Tous portaient en tête des titres différents.
«C'est un roman, m'écriai-je, cela s'appelle la Malédiction,
chapitre 1er! mais non, cela s'appelle le Nouveau René,
Ier chapitre... Eh non! voici Une Déception,
livre Ier. Ah! maintenant, cet autre, le Dernier
Croyant, Ière partie... Eh mais! voici des vers! un poème!
chant Ier, la Fin du monde. Ah! une ballade! la Jolie
Fille du roi maure, strophe 1ère; et sur cette autre
feuille, la Création, drame fantastique, scène 1ère; et
puis voici un vaudeville, Dieu me pardonne! les Truands
philosophes, acte 1er; et par ma foi! encore autre chose!
un pamphlet politique, page Ière. Mais si tout cela marche
de front, tu vas, mon cher Horace, faire invasion dans la
littérature.»
Horace était furieux. Il se plaignit de ma curiosité, et,
m'arrachant des mains tous ces commencements, dont
aucun n'avait été poussé au delà d'une demi-page, il les
froissa, en fit une boule, et la jeta dans la cheminée.
«Quoi! tant de rêves, tant de projets, tant de conceptions
entièrement abandonnées pour une plaisanterie?
lui dis-je.
—Mon cher ami, si tu viens ici pour te divertir, répondit-il,
je le veux bien! Causons, rions tant que tu
voudras; mais si tu me railles avant que mon char soit
lancé, je ne pourrai jamais remettre mes chevaux au
galop.
—Je m'en vais, je m'en vais, dis-je en reprenant mon
chapeau; je ne veux pas te déranger dans le moment
de l'inspiration.
—Non, non, reste, dit-il en me retenant de force;
l'inspiration ne viendra pas aujourd'hui. Je suis stupide,
et tu viens à point pour me distraire de moi-même. Je
suis harassé, j'ai la tête brisée. Il y a trois nuits que je
n'ai dormi, et cinq jours que je n'ai pris l'air.
—Eh bien, c'est un beau courage, et je t'en félicite.
Tu dois avoir quelque chose en train. Veux-tu me le
lire?
—Moi! Je n'ai rien écrit. Pas une ligne de rédaction;
c'est une chose plus difficile que je ne croyais de se
mettre à barbouiller du papier. Vraiment, c'est rebutant.
Les sujets m'obsèdent. Quand je ferme les yeux, je
vois une armée, un monde de créations se peindre et
s'agiter dans mon cerveau. Quand je rouvre les yeux,
tout cela disparaît. J'avale des pintes de café, je fume
des pipes par douzaines, je me grise dans mon propre
enthousiasme; il me semble que je vais éclater comme
un volcan. Et quand je m'approche de cette table maudite,
la lave se fige et l'inspiration se refroidit. Pendant
le temps d'apprêter une feuille de papier et de tailler
ma plume, l'ennui me gagne; l'odeur de l'encre me donne
des nausées. Et puis cette horrible nécessité de traduire
par des mots et d'aligner en pattes de mouches des pensées
ardentes, vives, mobiles comme les rayons du soleil
teignant les nuages de l'air! Oh! c'est un métier, cela
aussi! Où fuir le métier, grand Dieu? Le métier me
poursuivra partout!
—Vous avez donc la prétention, lui dis-je, de trouver
une manière d'exprimer votre pensée qui n'ait pas une
forme sensible? Je n'en connais pas.
—Non, dit-il, mais je voudrais m'exprimer de prime
abord, sans fatigue, mais sans effort, comme l'eau murmure
et comme le rossignol chante.
—Le murmure de l'eau est produit par un travail, et
le chant du rossignol est un art. N'avez-vous jamais entendu
les jeunes oiseaux gazouiller d'une voix incertaine
et s'essayer difficilement à leurs premiers airs? Toute
expression précise d'idées, de sentiments, et même d'instincts,
exige une éducation. Avez-vous donc, dès le premier
essai, l'espoir d'écrire avec l'abondance et la facilité
que donne une longue pratique?»
Horace prétendit que ce n'était ni la facilité ni l'abondance
qui lui manquaient, mais que le temps matériel
de tracer des caractères anéantissait toutes ses facultés.
Il mentait, et je lui offris de sténographier sous sa dictée,
tandis qu'il improviserait à haute voix. Il refusa, et pour
cause. Je savais bien qu'il pouvait rédiger une lettre
spirituelle et charmante au courant de la plume; mais
il me semblait bien que donner une forme tant soit peu
étendue et complète à une idée quelconque demandait
plus de patience et de travail. L'esprit d'Horace n'était
certes pas stérile; il avait raison de se plaindre du trop
d'activité de ses pensées et de la multitude de ses visions;
mais il manquait absolument de cette force d'élaboration
qui doit présider à l'emploi de la forme. Il ne savait pas
travailler; plus tard, j'appris qu'il ne savait pas souffrir.
Et puis ce n'était pas là le principal obstacle. Je crois
que pour écrire il faut avoir une opinion arrêtée et raisonnée
sur le sujet qu'on traite, sans compter une certaine
somme d'autres idées également arrêtées pour appuyer
ses preuves. Horace n'avait d'opinion affermie sur
quoi que ce soit. Il improvisait ses convictions en causant,
à mesure qu'il les développait, et il le faisait d'une
façon assez brillante; aussi en changeait-il souvent, et
le Masaccio, en l'écoutant, avait coutume de répéter
entre ses dents cet axiome proverbial: «Les jours se
suivent et ne se ressemblent pas.»
Pourvu qu'on se borne à des causeries, on peut occuper
et amuser ses auditeurs à ses risques et périls, en
usant de ce procédé. Mais quand on fait de la parole un
emploi plus solennel, il faut peut-être savoir un peu
mieux ce qu'on prétend dire et prouver. Horace n'était
pas embarrassé de le trouver dans une discussion; mais
ses opinions, auxquelles il ne croyait qu'au moment de
les émettre, ne pouvaient pas échauffer le fond de son
coeur, émouvoir son imagination, et opérer en lui ce travail
intérieur, mystérieux, puissant, qui a pour résultat
l'inspiration, comme l'oeuvre des cyclopes, qui était manifestée
par la flamme de l'Etna.
A défaut de convictions générales, les sentiments particuliers
peuvent nous émouvoir et nous rendre éloquents;
c'est en général la puissance de la jeunesse.
Horace ne l'avait pas encore; et n'ayant ni ressenti les
émotions passionnées ni vu leurs effets dans la société;
en un mot, n'ayant appris ce qu'il savait que dans les
livres, il ne pouvait être poussé ni par une révélation
supérieure ni par un besoin généreux, au choix de tel ou
tel récit, de telle ou telle peinture. Comme il était riche
de fictions entassées dans son intelligence par la culture,
et toutes prêtes à être fécondées quand sa vie serait complétée,
il se croyait prêt à produire. Mais il ne pouvait
pas s'attacher à ces créations fugitives qui ne remuaient
pas son âme, et qui, à vrai dire, n'en sortaient pas, puisqu'elles
étaient le produit de certaines combinaisons de
la mémoire. Aussi manquaient-elles d'originalité, sous
quelque forme qu'il voulût les résoudre, et il le sentait;
car il était homme de goût, et son amour-propre n'avait
rien de sot. Alors il raturait, déchirait, recommençait,
et finissait par abandonner son oeuvre pour en essayer
une autre qui ne réussissait pas mieux.
Ne comprenant pas les causes de son impuissance, il
se trompait en l'attribuant au dégoût de la forme. La
forme était la seule richesse qu'il eût pu acquérir dès
lors avec de la patience et de la volonté; mais cela n'aurait
jamais suppléé à un certain fonds qui lui manquait
essentiellement, et sans lequel les oeuvres littéraires les
plus chatoyantes de métaphores, les plus chargées de
tours ingénieux et charmants, n'ont cependant aucune
valeur.
Je lui avais bien souvent répété ces choses, mais sans
le convaincre. Après l'essai que, depuis plus d'un mois,
il s'obstinait à faire, il s'aveuglait encore. Il croyait que
le bouillonnement de son sang, l'impétuosité de sa jeunesse,
l'impatience fiévreuse de s'exprimer, étaient les
seuls obstacles à vaincre. Cependant, il avouait que tout
ce qu'il avait essayé prenait, au bout de dix lignes ou de
trois vers, une telle ressemblance avec les auteurs dont
il s'était nourri, qu'il rougissait de ne faire que des pastiches.
Il me montra quelques vers et quelques phrases
qui eussent pu être signés Lamartine, Victor Hugo, Paul
Courier, Charles Nodier, Balzac, voire Béranger, le plus
difficile de tous à imiter, à cause de sa manière nette et,
serrée; mais ces courts essais, qu'on aurait pu appeler
des fragments de fragments, n'eussent été, dans l'oeuvre
de ses modèles, que des appendices servant d'ornement
à des pensées individuelles, et cette individualité, Horace
ne l'avait pas. S'il voulait émettre l'idée, on était choqué
(et il l'était lui-même) du plagiat manifeste, car cette
idée n'était point à lui: elle était à eux; elle était à tout
le monde. Pour y mettre son cachet, il eût fallu qu'il la
portât dans sa conscience et dans son coeur, assez profondément
et assez longtemps pour qu'elle y subît une
modification particulière; car aucune intelligence n'est
identique à une autre intelligence, et les mêmes causes
ne produisent jamais les mêmes effets dans l'une et dans
l'autre; aussi plusieurs maîtres peuvent-ils s'essayer simultanément
à rendre un même fait ou un même sentiment,
à traiter un même sujet, sans le moindre danger
de se rencontrer. Mais pour qui n'a point subi cette cause,
pour qui n'a pas vu ce fait ni éprouvé ce sentiment par
lui-même, l'individualité, l'originalité, sont impossibles.
Aussi se passa-t-il bien des jours encore sans qu'Horace
fût plus avancé qu'à la première heure. Je dois dire qu'il
y usa en pure perte le peu de volonté qu'il avait amassée
pour sortir de l'inaction. Quand il fut harassé de fatigue,
abreuvé de dégoût, presque malade, il sortit de sa retraite,
et se répandit de nouveau au dehors, cherchant
des distractions et voulant même essayer, disait-il, des
passions, pour voir s'il réveillerait par là sa muse engourdie.
Cette résolution me fit trembler pour lui. S'embarquer
sans but sur cette mer orageuse, sans aucune expérience
pour se préserver, c'est risquer plus qu'on ne pense. Il
s'était aventuré de même dans la carrière littéraire; mais
comme là il ne devait pas trouver de complice, le seul
désastre qu'il eût éprouvé, c'était un peu d'encre et de
temps perdu. Mais qu'allait-il devenir, aveugle lui-même,
sous la conduite de l'aveugle dieu?
Son naufrage ne fut pas aussi prompt que je le craignais.
En fait de passions, ne se perd pas qui veut. Horace
n'était point né passionné. Sa personnalité avait
pris de telles dimensions dans son cerveau, qu'aucune
tentation n'était digne de lui. Il lui eût fallu rencontrer
des êtres sublimes pour éveiller son enthousiasme; et,
en attendant, il se préférait, avec quelque raison, à tous
les êtres vulgaires avec lesquels il pouvait établir des
rapports. Il n'y avait pas à craindre qu'il risquât sa précieuse
santé avec des prostituées de bas étage. Il était
incapable de rabaisser son orgueil jusqu'à implorer celles
qui ne cèdent qu'à des offres considérables ou à des démonstrations
d'engouement qui raniment leur coeur éteint
et réveillent leur curiosité blasée. Il faisait profession
pour celles-là d'un mépris qui allait jusqu'à l'intolérance
la plus cruelle. Il ne comprenait pas le sens religieux et
vraiment grand de Marion Delorme. Il aimait l'oeuvre
sans être pénétré de la moralité profonde qu'elle renferme.
Il se posait en Didier, mais seulement pour une
scène, celle où l'amant de Marion, étourdi de sa découverte,
accable cette infortunée de ses sarcasmes et de ses
malédictions; et, quant au pardon du dénouement, il disait
que Didier ne l'eût jamais accordé s'il n'eût dû avoir,
une minute après, la tête tranchée.
Ce qu'il y avait à craindre, c'est que, s'adressant à
des existences plus précieuses, il ne les flétrît ou ne les
brisât par son caprice ou son orgueil, et qu'il ne remplît
la sienne propre de regrets ou de remords. Heureusement
cette victime n'était pas facile à trouver. On ne trouve
pas plus l'amour, quand on le cherche de sang-froid et
de parti pris, qu'on ne trouve l'inspiration poétique dans
les mêmes conditions. Pour aimer, il faut commencer
par comprendre ce que c'est qu'une femme, quelle protection
et quel respect on lui doit. A celui qui est pénétré
de la sainteté des engagements réciproques, de l'égalité
des sexes devant Dieu, des injustices de l'ordre social et
de l'opinion vulgaire à cet égard, l'amour peut se révéler
dans toute sa grandeur et dans toute sa beauté; mais à
celui qui est imbu des erreurs communes de l'infériorité
de la femme, de la différence de ses devoirs avec les
nôtres en fait de fidélité; à celui qui ne cherche que des
émotions et non un idéal, l'amour ne se révélera pas.
Et, à cause de cela, l'amour, ce sentiment que Dieu a
fait pour tous, n'est connu que d'un bien petit nombre.
Horace n'avait jamais remué dans sa pensée cette
grande question humaine. Il riait volontiers de ce qu'il
ne comprenait pas, et, ne jugeant le saint-simonisme
(alors en pleine propagande) que par ses côtés défectueux,
il rejetait tout examen d'un pareil charlatanisme. C'était
son expression; et si elle était méritée à beaucoup d'égards,
ce n'était du moins sous aucun rapport sérieux à
lui connu. Il ne voyait là que les habits bleus et les fronts
épilés des pères de la nouvelle doctrine, et c'en était
assez pour qu'il déclarât absurde et menteuse toute l'idée
saint-simonienne. Il ne cherchait donc aucune lumière,
et se laissait aller à l'instinct brutal de la priorité masculine
que la société consacre et sanctifie, sans vouloir
tremper dans aucun pédantisme, pas plus, disait-il, dans
celui des conservateurs que dans celui des novateurs.
Avec ces notions vagues et cette absence totale de
dogme religieux et social, il voulait expérimenter l'amour,
la plus religieuse des manifestations de notre vie morale,
le plus important de nos actes individuels par rapport à
la société! Il n'avait ni l'élan sublime qui peut réhabiliter
l'amour dans une intelligence hardie, ni la persistance
fanatique, qui peut du moins lui conserver une
apparence d'ordre et une espèce de vertu en suivant les
traditions du passé.
Sa première passion fut pour la Malibran.
Il allait quelquefois au parterre des Italiens; il emprunta
de l'argent, et y alla toutes les fois que la divine
cantatrice paraissait sur la scène. Certes, il y avait de
quoi allumer son enthousiasme, et j'aurais désiré que
cette adoration continue occupât plus longtemps son
imagination. Elle l'eût préparé à recevoir des impressions
plus durables et plus complètes. Mais Horace ne
savait pas attendre. Il voulut réaliser son rêve, et il fit
des folies pour madame Malibran, c'est-à-dire qu'il s'élança
sous les roues de sa voiture (après l'avoir guettée
à la sortie), sans toutefois se laisser faire aucun mal;
puis il jeta un ou deux bouquets sur la scène; puis enfin
il lui écrivit une lettre délirante, comme il avait écrit
quelques semaines auparavant à madame Poisson. Il ne
reçut pas plus de réponse cette fois que l'autre, et il
ignora de même le sort de sa lettre, si on l'avait méprisée,
si on l'avait reçue.
Je craignais que ce premier échec ne lui causât un vif
chagrin. Il en fut quitte pour un peu de dépit. Il se moqua
de lui-même pour avoir cru un instant que «l'orgueil
du génie s'abaisserait jusqu'à sentir le prix d'un hommage
ardent et pur.» Je le trouvai un jour écrivant une
seconde lettre qui commençait ainsi: «Merci, femme,
merci! vous m'avez désabusé de la gloire;» et qui finissait
par: «Adieu, Madame! soyez grande, soyez enivrée
de vos triomphes! et puissiez-vous trouver, parmi les
illustres amis qui vous entourent, un coeur qui vous
comprenne, une intelligence qui vous réponde!»
Je le déterminai à jeter cette lettre au feu, en lui disant
que probablement madame Malibran en recevait de semblables
plus de trois fois par semaine, et qu'elle ne perdait
plus son temps à les lire. Cette réflexion lui donna
à penser.
«Si je croyais, s'écria-t-il, qu'elle eût l'infamie de
montrer ma première lettre et d'en rire avec ses amis,
j'irais la siffler ce soir dans Tancrède; car enfin elle
chante faux quelquefois!
—Votre sifflet serait couvert sous les applaudissements,
lui dis-je; et s'il parvenait jusqu'aux oreilles de
la cantatrice, elle se dirait, en souriant: «Voici un de
mes billets doux qui me siffle; c'est le revers du bouquet
d'avant-hier.» Ainsi votre sifflet serait un hommage de
plus au milieu de tous les autres hommages.»
Horace frappa du poing sur sa table.
«Faut-il que je sois trois fois sot d'avoir écrit cette
lettre! s'écria-t-il; heureusement j'ai signé d'un nom de
fantaisie, et si quelque jour j'illustre le nom obscur que
je porte, elle ne pourra pas dire: «J'ai celui-là dans
mes épluchures.»
XI.
Horace abandonna pour quelques instants les lettres
et l'amour, et vint, après ces premières crises, se reposer
sur le divan de mon balcon, en regardant d'un air
de sultan les quatre femmes de nos mansardes, et en me
cassant des pipes, selon son habitude.
Forcé de m'absenter une partie de la journée pour mes
études et pour mes affaires, il fallait bien le laisser étendu
sur mon tapis; car, pour le tirer de sa superbe indolence,
il eût fallu lui signifier que cela me déplaisait; et,
en somme, cela n'était pas. Je savais bien qu'il ne ferait
pas la cour à Eugénie, que les soeurs d'Arsène lui casseraient
la figure avec leurs fers à repasser s'il s'avisait de
trancher du jeune seigneur libertin avec elles; et comme
je l'aimais véritablement, j'avais du plaisir à le retrouver
quand je rentrais, et à lui faire partager notre modeste
repas de famille.
Quant à Marthe, elle ne paraissait pas plus faire de lui
une mention particulière dans ses secrètes pensées, que
lorsqu'elle était l'objet de ses oeillades au comptoir du
café Poisson. Il lui rendait désormais la pareille, ne lui
pardonnant pas d'avoir méprisé sa déclaration, que, dans
le fait, elle n'avait pas reçue. Cependant il était toujours
frappé, malgré lui, de son exquise manière d'être, de sa
conversation sobre, sensée et délicate. Elle embellissait
à vue d'oeil. Toujours mélancolique, elle n'avait plus
cette expression d'abattement que donne l'esclavage.
M. Poisson l'avait déjà remplacée, et ne lui causait plus
de crainte. Elle prenait avec nous l'air de la campagne
le dimanche; et sa santé, longtemps altérée, se consolidait
par le régime doux et sain que je lui prescrivais, et
qu'elle observait avec une absence de caprices et de révoltes
rare chez une femme nerveuse. Sa présence attirait
bien chez moi quelques amis de plus que par le
passé; Eugénie se chargeait d'éconduire ceux dont la
sympathie était trop visiblement improvisée. Quant aux
anciens, nous leur pardonnions d'être un peu plus assidus
que de coutume. Ces petites réunions, où des étudiants
hardis et espiègles dans la rue prenaient tout à
coup, sous nos toits, des manières polies, une gaieté
chaste et un langage sensé, pour complaire à d'honnêtes
filles et à des femmes aimables, avaient quelque chose
d'utile et de beau en soi-même. Il aurait fallu avoir le
coeur froid et de l'esprit farouche pour ne pas goûter,
dans cet essai de sociabilité bienveillante et pure, un
plaisir d'une certaine élévation. Tous s'en trouvaient
bien. Horace y devenait moins personnel et moins âpre.
Nos jeunes gens y prenaient l'idée et le goût de moeurs
plus douces que celles dont ailleurs ils recevaient l'exemple.
Marthe y oubliait l'horreur de son passé; Suzanne
y riait de bon coeur, et s'y faisait un esprit plus juste que
celui de la province. Louison y progressait moins que les
autres; mais elle y acquérait la puissance de contenir sa
rude franchise, et, quoique toujours farouche dans son
rigorisme, elle n'était pas fâchée d'être traitée comme
une dame par des jeunes gens dont elle s'exagérait peut-être
beaucoup l'élégance et la distinction.
Insensiblement Horace trouva un grand charme dans
la société de Marthe. Ne pouvant pas savoir si elle avait
jamais reçu sa lettre, il eut l'esprit de se conduire comme
un homme qui ne veut pas se faire repousser deux fois.
Il lui témoigna une sorte de sympathie dévouée qui pouvait
devenir de l'amour si on n'en arrêtait pas brusquement
le progrès, et qui, en cas de résistance soutenue,
était une réparation de bon goût pour le passé.
Cette situation est la plus favorable au développement
de la passion. On y franchit de grandes distances d'une
manière insensible. Quoique mon jeune ami ne fût disposé,
ni par nature, ni par éducation, aux délicatesses de
l'amour, il y fut initié par le respect dont il ne put se
défendre. Un jour, il parla d'instinct le langage de la
passion, et fut éloquent. C'était la première fois que
Marthe entendait ce langage. Elle n'en fut pas effrayée
comme elle s'était attendue à l'être; elle y trouva même
un charme inconnu, et, au lieu de le repousser, elle
s'avoua surprise, émue, demanda du temps pour comprendre
ce qui se passait en elle, et lui laissa l'espérance.
Confident d'Horace, je l'étais indirectement d'Arsène
par l'intermédiaire d'Eugénie. Je m'intéressais à l'un et
à l'autre; j'étais l'ami de tous deux; si j'estimais davantage
Arsène, je puis dire que j'avais plus d'amitié et
d'attrait pour Horace. Entre ces deux poursuivants de la
Pénélope dont j'étais le gardien, j'eusse été assez embarrassé
de me prononcer, si j'avais eu un conseil à
donner. Mon affection me défendait de nuire à l'un des
deux; mais Eugénie éclaira ma conscience.
«Arsène aime Marthe d'un amour éternel, me dit-elle,
et Horace n'a pour Marthe qu'une fantaisie. Dans
l'un elle trouvera, quoi qu'elle fasse, un ami, un protecteur,
un frère; l'autre se jouera de son repos, de son
honneur peut-être; et l'abandonnera pour un nouveau
caprice. Que votre amitié pour Horace ne soit pas puérile.
C'est à Marthe que vous devez votre sollicitude
tout entière. Malheureusement elle semble écouter cet
écervelé avec plaisir; cela m'afflige, et je crois que plus
je dis de mal de lui, plus elle en pense de bien. C'est à
vous de l'éclairer: elle croira plus en vous qu'en moi.
Dites-lui qu'Horace ne l'aime pas et ne l'aimera jamais.»
Cela était bien difficile à prouver et bien téméraire à
affirmer. Qu'en savions-nous après tout? Horace était
assez jeune pour ignorer même l'amour; mais l'amour
pouvait opérer une grande crise en lui, et mûrir tout à
coup son caractère. Je convins que ce n'était pas à la
noble Marthe de courir les hasards d'une pareille expérience,
et je promis de tenter le moyen qu'Eugénie me
suggéra, qui était de mener Horace dans le monde pour
le distraire de son amour, ou pour en éprouver la force.
Dans le monde! me dira-t-on, vous, un étudiant, un
carabin? Eh! mon Dieu oui. J'avais, avec plusieurs nobles
maisons, des relations, non pas assidues, mais régulières
et durables, qui pouvaient toujours me mettre
en rapport, à ma première velléité, avec ce que le faubourg
Saint-Germain avait de plus brillant et de plus
aimable. J'avais un unique habit noir qu'Eugénie me
conservait avec soin pour ces grandes occasions, des
gants jaunes qu'elle faisait servir trois fois à force de les
frotter avec de la mie de pain, du linge irréprochable,
moyennant quoi je sortais environ une fois par mois de
ma retraite; j'allais voir les anciens amis de ma famille,
et j'étais toujours reçu à bras ouverts, quoiqu'on sût fort
bien que je ne me piquais pas d'un ardent légitimisme.
Le mot de l'énigme, et pardonnez-moi, cher lecteur, de
n'avoir pas songé plus tôt à vous le dire, c'est que j'étais
né gentilhomme et de très-bonne souche.
Fils unique et légitime du comte de Mont..., ruiné,
avant de naître, par les révolutions, j'avais été élevé par
mon respectable père, l'homme le plus juste, le plus
droit et le plus sage que j'aie jamais connu. Il m'avait
enseigné lui-même tout ce qu'on enseigne au collège; et,
à dix-sept ans, j'avais pu aller chercher à Paris avec lui
mon diplôme de bachelier ès-lettres. Puis nous étions
revenus ensemble dans notre modeste maison de province,
et là il m'avait dit:—Tu vois que je suis attaqué
d'infirmités très-graves; il est possible qu'elles
m'emportent plus tôt que nous ne pensons, ou du moins
qu'elles affaiblissent ma mémoire, ma volonté et mon
jugement. Je veux employer ce peu de lucidité qui me
reste à causer sérieusement avec toi de ton avenir, et
t'aider à fixer tes idées.
«Quoi qu'en disent les gens de notre classe qui ne peuvent
se consoler de la perte du régime de la dévotion et
de la galanterie, le siècle est en progrès et la France
marche vers des doctrines démocratiques que je trouve
de plus en plus équitables et providentielles, à mesure
que j'approche du terme où je retournerai nu vers celui
qui m'a envoyé nu sur la terre. Je t'ai élevé dans le sentiment
religieux de l'égalité des droits entre tous les
hommes, et je regarde ce sentiment comme le complément
historique et nécessaire du principe de la charité
chrétienne. Il sera bon que tu pratiques cette égalité en
travaillant, selon tes forces et tes lumières, pour acquérir
et maintenir ta place dans la société. Je ne désire point
pour toi que cette place soit brillante. Je te la désire indépendante
et honorable. Le mince héritage que je te
laisserai ne servira guère qu'à te donner les moyens
d'acquérir une éducation spéciale; après quoi tu te soutiendras
et tu soutiendras ta famille, si tu en as une, et
si cette éducation a porté ses fruits. Je sais bien que les
nobles de notre entourage me blâmeront beaucoup, dans
les commencements, de donner à mon fils une profession,
au lieu de le placer sous la protection d'un gouvernement.
Mais un jour n'est pas loin peut-être où ils
regretteront beaucoup d'avoir rendu les leurs propres
uniquement à profiter des faveurs de la cour. Moi, j'ai
appris dans l'émigration quelle triste chose c'est qu'une
éducation de gentilhomme, et j'ai voulu t'enseigner
d'autres arts que l'équitation et la chasse. J'ai trouvé en
toi une docilité affectueuse dont je te remercie au nom
de l'amour que je te porte, et tu me remercieras encore
plus un jour de l'avoir mise à l'épreuve.»
Je passai deux ans près de lui, occupé à compléter
mes premières études, et à développer les idées dont il
m'avait donné le germe. Il me fit examiner les éléments
de plusieurs sciences, afin de voir pour laquelle je me
sentirais le plus d'aptitude. J'ignore si c'est la douleur de
le voir continuellement souffrir sans pouvoir le soulager
qui m'influença, mais il est certain qu'une vocation prononcée
me poussa vers l'étude de la médecine.
Lorsque mon père s'en fut bien assuré, il voulut m'envoyer
à Paris; mais il était dans un si déplorable état de
santé, que j'obtins de lui de rester encore quelques mois
pour le soigner. Nous marchions, hélas! vers une éternelle
séparation. Son mal empirait toujours; les mois et
les saisons se succédaient sans lui apporter aucun soulagement,
mais sans rien ôter à son courage. À chaque
redoublement de la maladie, il voulait me renvoyer, disant
que j'avais quelque chose de plus important à faire
que de soigner un moribond, mais il céda à ma tendresse,
et me permit de lui fermer les yeux. Un moment
avant que d'expirer, il me fit renouveler le serment que
je lui avais fait bien des fois d'entreprendre sur-le-champ
mes éludes.
Je tins religieusement ma promesse, et, malgré la
douleur dont j'étais accablé, je poussai activement les
préparatifs de mon départ. Il avait lui-même mis ordre à
mes affaires, en affermant sa propriété pour neuf ans,
afin que j'eusse un revenu assuré pendant mes années
de travail à Paris. Et c'est ainsi que j'existais depuis
quatre ans, vivant de mes trois mille francs de rente, et
voyant approcher l'époque de mes examens sans avoir
rien négligé pour obéir aux dernières volontés du meilleur
des pères, et sans avoir interrompu mes anciennes
relations avec celles de nos connaissances pour lesquelles
il avait eu de l'estime et de l'affection.
De ce nombre était la comtesse de Chailly, qui, dans
sa jeunesse, malgré la différence des fortunes, avait eu,
disait-on, pour mon père des sentiments fort tendres.
Une amitié loyale avait survécu à cet amour, et mon
père, en mourant, m'avait dit: «N'abandonne jamais
cette personne-là; c'est la meilleure femme que j'aie
rencontrée dans ma vie.»
Elle était effectivement aussi bonne que spirituelle.
Quoique fort riche, elle n'avait aucune vanité, et quoique
fort bien née, elle n'avait aucun préjugé aristocratique.
Elle possédait plusieurs châteaux, l'un desquels
touchait à la petite propriété de mon père, et c'est dans
celui-là qu'elle passait les étés de préférence. Elle avait,
en outre, un petit hôtel dans la rue de Varennes, et,
comme elle aimait la causerie, elle y rassemblait une
société assez agréable. L'étiquette et la morgue en étaient
bannies; on y voyait des gens du monde, tous appartenant
à l'ancienne noblesse ou à l'opinion légitimiste, et
en même temps quelques gens de lettres et des artistes
de toutes les opinions. On pouvait professer là les idées
les plus nouvelles; mais le juste-milieu et la bourgeoisie
parvenue ne trouvaient point grâce devant madame de
Chailly; elle s'arrangeait mieux, comme toutes les carlistes,
des opinions républicaines et de la pauvreté fière
et discrète.
Cette année-là elle avait été retenue à Paris par des
affaires importantes, et quoique la saison fût avancée,
elle ne se disposait pas encore à partir. Son cercle était
fort restreint, et l'élément artiste et littéraire, qui ne va
guère à la campagne qu'en automne (quand il y va),
donnait plus dans son salon que l'élément noble. Elle
m'accorda gracieusement la faveur de lui présenter un
de mes amis, et un soir je lui menai Horace.
Celui-ci m'avait demandé fort ingénument des instructions
sur la manière de se présenter dans le monde, et
de s'y tenir convenablement. Ce n'était pas tout à fait la
première l'ois qu'il lui arrivait de voir des personnes de
cette classe; mais il n'ignorait pas qu'on a plus d'indulgence
à la campagne qu'à Paris, et il tenait beaucoup à
ne pas avoir l'air d'un rustre dans le salon de madame
de Chailly. Il se faisait de ce qu'il appelait cette partie
une sorte de fête; il se promettait d'observer, d'examiner
et de recueillir des faits pour son prochain roman;
et cependant il éprouvait bien quelques angoisses à l'idée
de glisser sur un parquet bien ciré, d'écraser la patte
d'un petit chien, de heurter lourdement quelque meuble,
en un mot de faire le personnage ridicule de la comédie
classique.
Quand il eut mis son bel habit, son plus beau gilet, des
gants jaune-paille, et quand il eut brossé son chapeau,
Eugénie, qui fondait de grandes espérances de salut
pour Marthe de ce début parmi les comtesses, s'amusa
à ajuster sa cravate avec plus de distinction qu'il ne savait
le faire; elle lui fit rentrer deux pouces de manchette,
lui apprit à ne pas mettre son chapeau sur
l'oreille, et sut, en un mot, lui donner un air presque
comme il faut. Il se prêta de fort bonne grâce à ses corrections,
s'émerveillant de cette délicatesse de tact qui
faisait deviner à une femme du peuple mille petites
choses de goût dont il ne se fût jamais avisé tout seul, et
s'étonna de l'indifférence, peut-être affectée, avec laquelle
Marthe assistait à ces préparatifs. Au fond,
Marthe s'inquiétait beaucoup de cette fantaisie d'aller
dans le monde, et quoiqu'elle ne se fût point avoué
qu'elle aimait Horace, elle avait le coeur serré d'une
épouvante secrète. Il y eut un moment où Horace, riant
aux éclats, et faisant la répétition de son entrée, s'approcha
d'elle d'une manière comique, lui attribuant le
rôle de la comtesse de Chailly. A ce moment-là, Marthe,
frappée du salut respectueux qu'il lui adressait, devint
Tremblante, et se tournant vers moi;
«Vraiment, dit-elle, est-ce ainsi qu'on salue les
grandes dames?
—Ce n'est pas mal, répondis-je, mais c'est encore un
peu leste; madame de Chailly est une personne âgée.
Recommencez-moi cela, Horace. Et puis, tenez, quand
vous vous retirerez, madame de Chailly vous invitera
certainement à revenir; elle vous adressera quelques paroles
très-cordiales, et il est possible qu'elle vous tende la
main, parce qu'elle a coutume d'être extrêmement maternelle
pour mes amis. Vous devez alors prendre cette
main du bout de vos doigts, et l'approcher de vos lèvres.
—Comme cela?» dit Horace en essayant de baiser la
main de Marthe.
Marthe retira vivement sa main. Sa figure exprimait
une vive souffrance.
«Comme cela, en ce cas? dit Horace en prenant la
grosse main rouge de Louison, et en baisant son propre
pouce.
—Voulez-vous bien finir vos bêtises? s'écria Louison
toute scandalisée. On a bien raison de dire que le plus
beau monde est le plus malhonnête. Voyez-vous ça! cette
vieille comtesse qui se fait baiser les mains par des jeunes
gens! Ah çà! n'y revenez plus; je ne suis pas comtesse,
moi, et je vous campe le plus beau soufflet....
—Tout doux, ma colombe, répondit Horace en pirouettant,
on n'a pas envie de s'y exposer. Allons, Théophile,
partons-nous? Je me sens tout à fait à l'aise, et tu
vas voir comme je saurai prendre des airs de marquis.
Je vais bien m'amuser.»
Il fit son entrée beaucoup mieux que je ne m'y attendais.
Il traversa une douzaine de personnes pour saluer
la maîtresse de maison, sans gaucherie, et avec un air
qui n'avait rien de trop dégagé ni de trop humble. Sa
figure frappa tout le monde, et la vicomtesse de Chailly,
belle-fille de ma vieille comtesse, ne lui témoigna, chose
merveilleuse, aucune des méfiances hautaines qu'elle
avait en général pour les nouveaux venus.
On venait de prendre le café, on passa au jardin, et
l'on s'y distribua en deux groupes: l'un qui se promena
avec la belle-mère, active et enjouée, l'autre qui s'assit
autour de la bru, romanesque et nonchalante.
C'était un petit jardin à l'ancienne mode, avec des
arbres taillés, des statues malingres, et un mince filet
d'eau qu'on faisait jaillir quand la vicomtesse l'ordonnait.
Elle prétendait aimer ce bruit d'eau fraîche sous
le feuillage quand la nuit tombait, parce qu'alors,
ne voyant plus ce bassin misérable et cette eau verdâtre,
elle pouvait se figurer être à la campagne auprès
d'une eau libre et courante à travers les prés.
En parlant ainsi, elle s'étendit sur une causeuse qu'on
lui roula du salon sur le gazon un peu jauni du tapis vert.
Un petit arbre exotique se penchait sur sa tête avec de
faux airs de palmier. Sa cour, composée de ce qu'il y
avait de plus jeune et de plus galant dans la société de
ce jour-là, s'assit autour d'elle; et l'on échangea, dans
une béatitude un peu guindée, une foule de jolis propos
qui ne signifiaient rien du tout. Ce groupe n'eût pas été
celui que j'aurais choisi, si la nécessité de surveiller Horace
dans sa première apparition ne m'eût forcé d'écouter
l'esprit cherché de la vicomtesse, bien inférieur,
selon moi, à l'esprit chercheur de sa belle-mère. Je craignais
qu'Horace n'en fût bientôt las; mais, à ma grande
surprise, il y trouva un plaisir extrême, quoique son rôle
y fut assez délicat et difficile à remplir.
En effet, ce n'était pas une petite épreuve pour son
aplomb et son bon sens. Il était évident que, dès le premier
coup d'oeil, la vicomtesse avait pris une sorte d'intérêt
à pénétrer en lui, pour savoir si son ramage se
rapportait à son plumage. Au lieu de le tenir à distance
jusqu'à ce qu'il eût fait preuve d'esprit à la pointe
de l'épée, elle lui facilitait avec une complaisance sournoise
l'occasion de montrer d'emblée s'il était un homme
de sens ou un sot. Elle mit tout de suite la conversation
sur des sujets où il était infaillible qu'il émettrait son
sentiment, et l'attaqua indirectement sur la littérature,
en jetant à la tête du premier venu cette question insidieuse:
«Avez-vous lu la dernière pièce de vers de
M. de Lamartine?
—Est-ce à moi, Madame, que ce discours s'adresse?
demanda un jeune poëte monarchique et religieux qui
s'était assis presque à ses pieds d'un air contemplatif.
—Comme vous voudrez,» répliqua la vicomtesse en
faisant voltiger avec le vent de son éventail ses longues
touffes de cheveux châtains roulés en spirales légères.
Le jeune poëte déclara qu'il trouvait les dernières
Méditations très-faibles. Depuis qu'il avait perdu l'espoir
d'imiter M. de Lamartine, il le rabaissait avec
amertume.
La vicomtesse lui fit un peu sentir qu'elle connaissait
son motif, et Horace, encouragé par un regard distrait
qu'elle laissa tomber sur lui, hasarda quelques syllabes.
Des trois ou quatre autres personnes qui le guettaient,
trois au moins étaient, de fondation, les adorateurs de
la vicomtesse, et par conséquent se sentaient assez mal
disposés pour le nouveau venu, dont la crinière avantageuse
et la parole accentuée annonçaient quelque prétention
à la supériorité. On prit généralement parti
contre lui, et même avec assez de malice, espérant qu'il
se fâcherait et dirait quelque sottise.
L'attente ne fut qu'à moitié remplie. Il s'emporta, parla
beaucoup trop haut, et mit plus d'obstination et d'âpreté
qu'il n'était de bon goût et de bonne compagnie de le
faire; mais il ne dit point les sottises auxquelles on s'attendait.
Il en dit d'autres auxquelles on ne s'attendait pas, mais
qui donnèrent la plus haute idée de son esprit à la vicomtesse
et même à ses adversaires; car dans un certain
monde superficiel et ennuyé, on vous pardonne plus aisément
un paradoxe qu'une platitude, et, en faisant preuve
d'originalité, on est certain d'être approuvé par plus
d'une femme blasée.
Dirai-je toute ma pensée à cet égard? Je le dois à la
vérité. Dussé-je être accusé de trahir les miens, ou du
moins de me séparer d'intentions de la classe où je suis
né, je suis forcé de déclarer ici que, sauf quelques exceptions,
la société légitimiste était encore, en 1831, d'une
médiocrité d'esprit incroyable. Cette ancienne causerie
française, qu'on a tant vantée, est aujourd'hui perdue
dans les salons. Elle est descendue de plusieurs étages;
et si l'on veut trouver encore quelque chose qui y ressemble,
c'est dans les coulisses de certains théâtres ou
dans certains ateliers de peinture qu'il faut aller la chercher.
Là, vous entendez un dialogue plus trivial, mais
aussi rapide, aussi enjoué, et beaucoup plus coloré que
celui de l'ancienne bonne compagnie. Cela seul pourra
donner à un étranger quelque idée de la verve et de la
moquerie dont notre nation a eu si longtemps le monopole.
Pour ne parler que de l'esprit qui se consomme
abondamment dans les mansardes d'étudiant ou d'artiste,
je puis bien dire qu'on en débite en une heure,
entre jeunes gens animés par la fumée des cigares, de
quoi défrayer tous les salons du faubourg Saint-Germain
pendant un mois. Il faut l'avoir entendu pour le croire.
Moi qui, sans prévention et sans parti pris, passais fréquemment
d'une société à l'autre, j'étais confondu de la
différence, et je m'étonnais souvent de voir certain bon
mot faire le tour d'un salon comme un joyau précieux
qu'on se passait de main en main, qui avait tant traîné
chez nous que personne n'eût voulu le ramasser. Je ne
parle pas de la bourgeoisie en général: elle a bien prouvé
qu'elle avait plus d'esprit de conduite que la noblesse;
quant à de l'esprit proprement dit, elle n'en a qu'à la seconde
génération. Les parvenus de ce temps-ci ont poussé
à l'ombre de l'industrie, dans l'atmosphère pesante des
usines, l'âme toute préoccupée de l'amour du gain, et
toute paralysée par une ambition égoïste. Mais leurs enfants,
élevés dans les écoles publiques, avec ceux de la
petite bourgeoisie, qui, à défaut d'argent, veut parvenir,
elle aussi, par les voies de l'intelligence, sont en général
incomparablement plus cultivés, plus vifs et plus
fins que les héritiers étiolés de l'aristocratie nobiliaire.
Ces malheureux jeunes gens, hébétés par des précepteurs
dont on enchaîne la liberté intellectuelle, à force de
prescriptions religieuses et politiques, sont rarement
intelligents, et jamais instruits. L'absence de cour, la
perte des places et des emplois, le dépit causé par les
triomphes d'une aristocratie nouvelle, achèvent de les
effacer; et leur rôle, qui commence pourtant à devenir
meilleur à mesure qu'ils le comprennent et l'acceptent,
était, à l'époque de mon récit, le plus triste qu'il y eût
en France.
Je n'ai rien dit du peuple, et le peuple français, surtout
celui des grandes villes, passe pour infiniment spirituel.
Je conteste l'épithète. L'esprit n'existe qu'à la condition
d'être épuré par un goût que le peuple ne peut pas avoir,
ce goût lui-même étant le résultat de certains vices de
civilisation qui ne sont pas ceux du peuple. Le peuple
n'a donc pas d'esprit, selon moi. Il a mieux que cela: il
a la poésie, il a le génie. Chez lui la forme n'est rien, il
n'use pas son cerveau à la chercher; il la prend comme
elle lui vient. Mais ses pensées sont pleines de grandeur
et de puissance, parce qu'elles reposent sur un principe
de justice éternelle, méconnu par les sociétés et conservé
au fond de son coeur. Quand ce principe se fait jour,
quelle qu'en soit l'expression, elle saisit et foudroie
comme l'éclair de la vérité divine.
XXII.
Horace parla beaucoup. Emporté comme il l'était toujours
par le feu de la discussion, il défendit ses auteurs
romantiques, qu'on lui contestait en masse et en détail.
Il rompit des lances pour tous, et fut vivement soutenu
par la vicomtesse de Chailly, qui se piquait d'éclectisme
en matière d'art et de belles-lettres. Il faut avouer que
les adversaires furent bien faibles, et je ne concevais pas
comment Horace pouvait perdre son temps et ses paroles
à leur tenir tête.
La vieille comtesse, qui passait et repassait avec ses
amis dans une allée voisine, m'appela d'un signe.
«Tu as un ami bien bruyant, me dit-elle: qu'a-t-il
donc à tempêter de la sorte? Est-ce que ma belle-fille le
raille? Prends garde à lui. Tu sais qu'elle est fort
cruelle, et qu'elle abuse de son esprit avec ceux qui n'en
ont pas.
—Rassurez-vous, chère maman, lui répondis-je (j'avais,
depuis mon enfance, l'habitude de l'appeler ainsi),
il a de l'esprit tout autant qu'il lui en faut pour se défendre,
et même pour se faire goûter.
—Oui-da! m'aurais-tu amené un homme dangereux?
Il est fort bien de sa personne, et il me parait fort romantique.
Heureusement Léonie n'est pas romanesque.
Mais appelle-le un peu ici, que je jouisse à mon tour de
son esprit.»
J'arrachai Horace (à son grand déplaisir ) à l'auditoire
qu'il avait captivé, et je restai un peu derrière la charmille
pour écouter ce qu'on dirait de lui.
«C'est un drôle de corps que ce petit monsieur-là,
dit la vicomtesse en reprenant le jeu de son éventail.
—C'est un fat, répondit le poëte légitimiste.
—Un fat! c'est être bien sévère, dit le vieux marquis
de Vernes; je crois que présomptueux serait un mot
plus juste. Mais c'est un jeune homme de beaucoup de
mérite, qui pourra devenir homme d'esprit s'il voit le
monde.
—Pour de l'esprit, il en a, reprit la vicomtesse.
—Parbleu! il en a à revendre, dit le marquis; mais
il manque de tact et de mesure.
—Il m'amusait, reprit-elle; pourquoi donc maman
s'en est-elle emparée? Vous ne vous prononcez pas, monsieur
de Meilleraie? dit-elle à un jeune dandy qu'elle
avait l'air de subjuguer.
—Mon Dieu! Madame, répondit celui-ci avec une
aigreur froide, vous vous prononcez tellement vous-même,
que je ne puis que baisser la tête et dire amen.»
La vicomtesse Léonie de Chailly n'avait jamais été
belle; mais elle voulait absolument le paraître, et à force
d'art elle se faisait passer pour jolie femme. Du moins
elle en avait tous les airs, tout l'aplomb, toutes les allures
et tous les privilèges. Elle avait de beaux yeux verts d'une
expression changeante qui pouvait, non charmer, mais
inquiéter et intimider. Sa maigreur était effrayante et ses
dents problématiques; mais elle avait des cheveux superbes,
toujours arrangés avec un soin et un goût remarquables.
Sa main était longue et sèche, mais blanche
comme l'albâtre, et chargée de bagues de tous les pays
du monde. Elle possédait une certaine grâce qui imposait
à beaucoup de gens. Enfin, elle avait ce qu'on peut
appeler une beauté artificielle.
La vicomtesse de Chailly n'avait jamais eu d'esprit;
mais elle voulait absolument en avoir, et elle faisait croire
qu'elle en avait. Elle disait le dernier des lieux communs
avec une distinction parfaite, et le plus absurde des paradoxes
avec un calme stupéfiant. Et puis elle avait un
procédé infaillible pour s'emparer de l'admiration et des
hommages: elle était d'une flagornerie impudente avec
tous ceux qu'elle voulait s'attacher, d'une causticité impitoyable
pour tous ceux qu'elle voulait leur sacrifier.
Froide et moqueuse, elle jouait l'enthousiasme et la
sympathie avec assez d'art pour captiver de bons esprits
accessibles à un peu de vanité. Elle se piquait de savoir,
d'érudition et d'excentricité. Elle avait lu un peu de
tout, même de la politique et de la philosophie; et vraiment
c'était curieux de l'entendre répéter, comme venant
d'elle, à des ignorants ce qu'elle avait appris le
matin dans un livre ou entendu dire la veille à quelque
homme grave. Enfin, elle avait ce qu'on peut appeler une
intelligence artificielle.
La vicomtesse de Chailly était issue d'une famille de
financiers qui avait acheté ses titres sous la régence;
mais elle voulait passer pour bien née, et portait des
couronnes et des écussons jusque sur le manche de ses
éventails. Elle était d'une morgue insupportable avec les
jeunes femmes, et ne pardonnait pas à ses amis de faire
des mariages d'argent. Du reste, elle accueillait assez
bien les jeunes gens de lettres et les artistes. Elle tranchait
avec eux de la patricienne tout à son aise, affectant
devant eux seulement de ne faire cas que du mérite.
Enfin, elle avait une noblesse artificielle, comme tout le
reste, comme ses dents, comme son sein, et comme son
coeur.
Ces femmes-là sont plus nombreuses qu'on ne pense
dans le monde, et qui on a vu une les a toutes vues. Horace
joignait au plaisir de la nouveauté une ingénuité si
complète, qu'il prit au sérieux la vicomtesse à la première
parole, et que la tête lui en tourna.
«Mon cher, c'est une femme adorable! me disait-il
en revenant le soir dans les longues rues désertes du
faubourg Saint-Germain; c'est un esprit, une grâce, un
je ne sais quoi qui n'a pas de nom pour moi, mais qui
me pénètre comme un parfum. Quel bijou précieux
qu'une femme ainsi travaillée, ainsi façonnée à plaire
par de longues études! Tu appelles cela de la coquetterie?
Soit! va pour la coquetterie! C'est bien beau et
bien aimable, dans tous les cas. C'est toute une science,
cela, et une science au profit des autres. Je ne sais vraiment
pas pourquoi l'on médit des coquettes: une femme
qui est occupée d'un autre soin que celui de plaire n'est
plus une femme à mes yeux. Certainement, voici la première
femme véritable que je rencontre.
—Il y a pourtant des hommes à qui la vicomtesse déplaît,
et, pour mon compte...
—C'est qu'elle veut déplaire à ces hommes-là: elle ne
les trouve pas dignes de la moindre attention. Elle a du
discernement.
—Grand merci de l'application,» repris-je. Il ne m'entendit
même pas; il avait la cervelle remplie de la vicomtesse.
Il ne se gêna pas pour en parler devant Marthe le
lendemain, et dit contre les femmes simples et sévères
des choses si dures, qu'elle en fut offensée et alla travailler
dans une autre chambre.
«Cela marche à merveille, me dit tout bas Eugénie;
l'épreuve a réussi mieux que je n'espérais. Il a pris feu
comme un brin de paille; j'espère que Marthe est
guérie.»
Arsène vint, et trouva Marthe plus affectueuse et plus
gaie que de coutume, quoiqu'elle souffrît horriblement.
Il nous annonça que sa présence au café Poisson n'étant
plus nécessaire, il changeait de condition.
«Ah! ah! lui dit Horace, vous allez reprendre la
peinture?
—Peut-être le ferai-je plus tard, répondit le Masaccio;
mais pas maintenant. Mes soeurs n'ont pas encore
assez d'ouvrage assuré pour l'année. Est-ce que vous ne
pourriez pas me faire placer quelque part comme employé,
pour tenir une comptabilité quelconque? dans une
régie de théâtre, dans une administration d'omnibus,
que sais-je? Vous avez des connaissances, vous autres!
—Mon cher, dit Horace, vous n'écrivez ni assez bien
ni assez vite. Et puis, savez-vous la tenue des livres?
—J'apprendrai, dit Arsène.
—Il ne doute de rien, dit Horace. Moi, si j'ai un conseil
à vous donner, c'est de persévérer dans la condition
que vous venez d'essayer; vous vous en acquittez fort
bien. Seulement vous avez un peu de fatigue. Servez
dans une bonne maison, au lieu de servir dans un café;
vous gagnerez beaucoup, et vous ne travaillerez guère.
Si Théophile le veut, il peut vous placer chez quelque
grand seigneur, ou seulement chez quelque brave dame
du faubourg Saint-Germain. Est-ce que la comtesse ne le
prendrait pas pour domestique, si tu le lui recommandais?
Réponds donc, Théophile!
—C'est assez de domesticité comme cela, répondit
Arsène, qui comprenait fort bien l'intention qu'avait Horace
de le rabaisser aux yeux de Marthe; j'y reviendrai
si je ne puis trouver mieux. Mais puisque c'est un état
qu'on méprise...
—Qu'est-ce qui se permet de le mépriser? s'écria
Louison tout en feu, en suivant la direction involontaire
qu'avait prise le regard de Paul; est-ce que c'est vous,
Marton, qui méprisez mon frère?
—Cousez donc! dit le Masaccio à Louison d'un ton
sévère, pour faire baisser ses yeux menaçants levés sur
Marthe.
—Mais enfin, reprit-elle, je trouve un peu drôle qu'on
te méprise: je ne sais pas où on prend ce droit-là, et je
ne vois pas en quoi mademoiselle Marton...»
Marthe regarda Arsène d'un air triste, et lui tendit la
main pour l'apaiser. Il était prêt à éclater contre sa
soeur.
«Elle est folle,» dit-il en haussant les épaules, et il
s'assit auprès de Marthe en tournant le dos à Louison,
dont les yeux se remplirent de larmes.
«C'est qu'aussi c'est indigne! s'écria-t-elle aussitôt
qu'il fut parti. Voyez-vous, monsieur Théophile, je ne
peux pas supporter cela de sang-froid. Mademoiselle
Marthe et M. Horace, qui s'entendent fort bien, je vous
assure, ne font pas autre chose que de déconsidérer mon
frère.
—Vous êtes folle, répliqua Eugénie, et votre frère,
qui vous l'a dit, vous connaît bien. Jamais Marthe
n'a dit un mot de Paul qui ne fût à son honneur et à sa
louange.
—Je ne suis pas folle, s'écria Louison en sanglotant,
et je veux que vous me jugiez tous. Je ne l'aurais pas dit
devant lui, de crainte d'amener une querelle; mais puisqu'il
n'est plus là, et que voici les coupables (elle désignait
alternativement Marthe, qui l'écoutait avec une
pitié douloureuse, et Horace, qui, le dos étendu sur
la commode et les jambes sur le dossier d'une chaise,
ne daignait pas l'interrompre), je dirai ce que j'ai entendu,
pas plus tard qu'avant-hier, lorsque monsieur
et madame causaient en tête-à-tête, comme ça leur arrive
assez souvent, Dieu merci! elle dans une chambre,
nous dans l'autre; avec ça que c'est commode pour
s'entendre sur l'ouvrage! On va, on vient, ça promène;
et, comme dit cet autre, les amoureux ont du temps à
perdre.
—Charmant! charmant! dit Horace en se soulevant
sur son coude et en la regardant avec un calme plein de
mépris: eh bien, poursuivez, fille d'Hérodias! Je verrai
ensuite à vous donner ma tête sur un plat pour votre
souper. Qu'ai-je dit? voyons, parlez donc, puisque vous
écoutez aux portes.
—Oui, que j'écoute aux portes quand j'entends le
nom de mon frère! Et vous disiez comme cela que c'était
bien dommage qu'il se fût fait valet, et qu'il était perdu.
Et mademoiselle Marton, au lieu de vous traiter comme
vous le méritiez pour ce mot-là, disait d'un petit air
étonné:—Comment donc? comment donc, perdu?—Oui,
que vous avez dit: il aurait beau changer de condition,
maintenant, il lui resterait toujours quelque
chose de laquais, un cachet de honte qui ne s'efface pas.
Enfin comme pour dire, le voilà marqué comme un
galérien.
—Si vous aviez écouté un peu plus longtemps, dit
Marthe avec une douceur angélique, vous auriez entendu
ma réponse: j'ai dit que quand cela serait vrai, Arsène
ennoblirait la plus vile des conditions.
—Et quand vous auriez dit cela, est-ce beau? N'est-ce
pas avouer que mon frère est dans une condition vile? Je
voudrais bien savoir comment étaient faits vos ancêtres,
et si nous n'avons pas tous été élevés à travailler pour
vivre.»
Je coupai court à cette querelle, qui eût pu durer toute
la nuit; car il n'y a pas de gens plus difficiles à convaincre
que ceux qui ne comprennent pas la valeur des mots, et
qui en altèrent le sens dans leur imagination. J'envoyai
coucher les deux soeurs, leur donnant tort, selon ma
coutume, et les menaçant, pour la première fois, de me
plaindre à Paul des amères tracasseries qu'elles suscitaient
à leur compagne.
«Oui, oui! faites cela, répondit Louison en sanglotant
sur le ton le plus aigu; ce sera humain de votre
part! Ce ne sera pas difficile car il en est si bien coiffé,
de cette Marton, que quand nous aurons assez travaillé
pour la nourrir, il nous mettra à la porte au premier mot
qu'elle lui dira contre nous. Allez, allez, Messieurs,
Mesdames, et vous, Marton! ce n'est pas beau de mettre
la guerre entre frères et soeurs; vous vous en repentirez
au jugement dernier! J'en appelle au jugement de
Dieu!»
Elle sortit d'un air tragique, entraînant Suzanne, nous
jetant des imprécations, et poussant les portes avec
fracas.
«Vous avez là pour compagnes d'abominables diablesses,
dit Horace en rallumant son cigare avec tranquillité.
Paul Arsène vous a rendu, mes pauvres amis,
un étrange service. Il a déchaîné l'enfer dans votre intérieur.
—Quant à nous, nous n'en prendrions guère de souci
personnel, répondit Eugénie; ce sont des nuages qui passent.
Mais c'est bien cruel pour toi, Marthe; et si tu m'en
croyais, il y aurait un remède à toutes les persécutions
dont tu es victime.
—Je sais ce que tu veux dire, ma bonne Eugénie, dit
Marthe en soupirant; mais sois sûre que cela est impossible.
D'ailleurs je serais encore bien plus odieuse aux
soeurs d'Arsène, si...
—Si quoi? demanda Horace, voyant qu'elle n'achevait
pas sa phrase.
—Si elle l'épousait, dit Eugénie. Voilà ce qu'elle s'imagine;
mais elle se trompe.
—Si vous l'épousiez? s'écria Horace, oubliant tout à
coup la vicomtesse et revenant aux sentiments que naguère
Marthe lui avait inspirés; vous, épouser Arsène!
Qui donc a pu avoir une pareille idée?
—C'est une idée fort raisonnable, reprit Eugénie, qui
voulait saper de plus en plus dans sa base leur naissante
inclination. Ils sont du même pays, de la même condition,
et à peu de chose près du même âge. Ils se sont
aimés dès leur enfance, et ils s'aiment encore. C'est un
scrupule de délicatesse qui empêche Marthe de dire oui.
Mais je le sais, moi, et je le lui dirai clairement, parce
que le moment est venu de parler. C'est l'unique désir,
l'unique pensée d'Arsène.»
L'attente d'Eugénie fut dépassée par l'effet que produisit
cette déclaration. Marthe, devenue aux yeux
d'Horace la fiancée de Paul Arsène, tomba si bas dans
sa pensée, qu'il rougit d'avoir pu l'aimer. Humilié,
blessé, et se croyant joué par elle, il prit son chapeau,
et, le mettant sur sa tête avant que de sortir:
«Si vous parlez affaires, dit-il, je suis de trop, et je
vais voir Odry, qui joue ce soir dans l'Ours et le Pacha.»
Marthe resta atterrée. Eugénie lui parla encore d'Arsène;
elle ne répondit pas, voulut se lever pour sortir,
et tomba évanouie au milieu de la chambre.
«Ma pauvre amie, dis-je à Eugénie en l'aidant à relever
sa compagne, nul ne peut détourner la destinée!
Tu as cru pouvoir préserver celle-ci. Il n'est déjà plus
temps: Horace est aimé!»
More History
|